AMICUS CURIAE SPONTANÉ Section du contentieux Article R.625-3 du Code de la jus
AMICUS CURIAE SPONTANÉ Section du contentieux Article R.625-3 du Code de la justice administrative CREDOF / Projet de recherches sur la justiciabilité des droits sociaux Mars 2010 Réf. N°322326 requête du Gisti et de la FAPIL c/ ministères de l’Immigration et du Logement Intervenants : Cimade, AFVS, DAL et observations de la HALDE Objet : décret n° 2008-908 du 8 septembre 2008 relatif aux conditions de permanence de la résidence des bénéficiaires du droit à un logement décent et indépendant et modifiant le code de la construction et de l'habitation (R.300-1 Code de la construction et l’habitation) Le Centre de recherches et d’études sur les droits fondamentaux de l’Université de Paris Ouest-Nanterre la Défense (CREDOF)1 a eu connaissance d’une requête introduite en novembre 2008 contre le décret du 8 septembre 2008. Il prévoit : « Art.R. 300-2. ― Pour remplir les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 doivent soit être titulaires d'une carte de résident ou de tout autre titre de séjour prévu par les traités ou accord internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, soit justifier d'au moins deux années de résidence ininterrompue en France sous couvert de l'un ou l'autre des titres de séjour suivants, renouvelé au moins deux fois (…) ». Le CREDOF travaille dans le cadre d’un contrat financé par l’Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion sociale, la DREES-MiRe et la Mission Recherche Droit et Justice pendant deux années sur la question précise de la justiciabilité des droits sociaux (« La justiciabilité des droits sociaux : droit des pauvres, pauvres droits ? », sous la direction de la Pr. Diane Roman2). Après plus d’une année de travail, plusieurs conclusions commencent à s’imposer sur cette question, à laquelle la loi et le décret sur le droit au logement opposable confèrent aujourd’hui une particulière actualité. Ces conclusions seront ici développées autour de deux points : la justiciabilité des droits sociaux, et donc l’étendue de la compétence des juges à leur égard, d’une part (I), l’universalité des droits sociaux, d’autre part (II). 1 http://credof.u-paris10.fr/. 2 http://droits-sociaux.u-paris10.fr/. Ce projet est financé par la Mission Droit et justice (http://www.gip- recherche-justice.fr/) et l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (http://www.onpes.gouv.fr/). I. SUR LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS SOCIAUX La question de l’opposabilité du droit au logement doit être replacée dans le contexte plus général de la justiciabilité des droits sociaux et de la compétence des juges - quels qu’ils soient : judicaires, administratifs ou constitutionnels - à adopter une décision sur le fondement des droits dits sociaux (quel que soit le contentieux dans lequel elle s’inscrit : action en responsabilité, recours en annulation, question de conventionnalité ou de constitutionnalité d’un acte juridique). La doctrine française oppose classiquement les libertés individuelles dites de première génération, ou encore « droits de », et les droits sociaux, dits de deuxième génération, ou « droits à ». Cette doctrine a longtemps considéré que cette opposition relative à l’objet des droits ou à leur temporalité s’accompagnerait d’une différence de statut et de régime juridique. Schématiquement : - les libertés individuelles seraient porteuses d’une obligation d’abstention pour les autorités publiques ou pour les tiers privés. En cas de violation de cette dernière, les individus pourraient saisir le juge compétent pout obtenir réparation ou annulation de l’acte illégal, inconventionnel ou inconstitutionnel. - les droits sociaux, à l’inverse, seraient porteurs d’une obligation d’action de la part des autorités publiques, notamment par le biais de la définition de politiques publiques. En cas de violation de celle-ci, les juges seraient incompétents, dans la mesure où leur décision s’apparenterait à une injonction adressée à l’administration ou au législateur, et porterait donc atteinte à la séparation des pouvoirs. Cette opposition est également étayée par deux autres arguments. 1. l’abstraction et le caractère programmatique des droits sociaux. Contrairement aux droits civils et politiques, qui seraient de véritables droits subjectifs directement invocables, les droits sociaux ne pourraient acquérir une pleine valeur normative et être invoqués devant un juge que s’ils sont précisés par une loi, laquelle fonderait alors le recours ; 2. le coût de l’effectivité des droits sociaux. Assurer l’effectivité des droits sociaux coûte cher. Il revient aux autorités politiques et non au juge de faire supporter la charge de ce coût à l’Etat. Aucun de ces arguments ne résiste à l’examen. Depuis plus de vingt ans, une partie de la doctrine française, et surtout internationale, a remis en cause les effets juridiques classiquement associés à la distinction entre libertés individuelles et droits sociaux3. Cette doctrine parvient à la conclusion selon laquelle l’opposition entre libertés individuelles et droits sociaux est artificielle. Ces deux types de normes sont porteurs des 3 V. par exemple, C. GREWE et F. BENOIT-ROHMER, Les droits sociaux ou la démolition de quelques poncifs, Presses universitaires de Strasbourg, 2003 ; G. J. H. VAN HOOF, « The legal nature of economic, social and cultural rights : A rebuttal of some traditional views », in : P. ALSTON, K. TOMASEVSKI (dir.), The right to food, Utrecht, SIM, 1984, voir spéc. p. 97 ; O. DE SCHUTTER, « Les générations des droits de l’homme et l’interaction des systèmes de protection : les scenarios du système européen de protection des droits fondamentaux », in : OMIJ (dir.), Juger les droits sociaux, PULIM, p. 13 ; D. ROMAN, « Les droits sociaux, entre "injusticiabilité" et "conditionnalité" : éléments pour une comparaison », RIDC, 2009, n° 2, pp. 285-314 mêmes propriétés juridiques. Tous deux peuvent justifier des abstentions et des actions de la part des autorités publiques ; leur garantie peut dans les deux cas être assurée par les juges. La seule limite du contrôle exercé par ces derniers trouve sa source dans la séparation des pouvoirs, ou dans les règles, législatives ou constitutionnelles, de répartition des compétences, mais celle-ci n’est pas liée au caractère individuel ou social des droits. Chacun d’entre eux peut, dans la limite énoncée, être justiciable. Ce mouvement trouve un écho certain au sein du Conseil de l’Europe et de la Cour européenne des droits de l’Homme – notamment à travers la jurisprudence relative aux obligations positives -, des organes spécialisés de l’ONU ou encore, sur le continent américain, de la Cour interaméricaine des droits de l’Homme. Les arguments sont multiples. 1. Les droits sociaux ne sont pas plus abstraits que les droits civils et politiques. Il est impossible d’établir une distinction rigoureuse entre des droits civils et politiques, d’une part, et des droits économiques et sociaux, d’autre part, sur le fondement de la plus ou moins grande précision ou abstraction des énoncés qui les expriment. Les notions d’égalité, de liberté, de droit de propriété ou de droit au logement débouchent sur des difficultés d’interprétation similaires. Se fonder sur la généralité et l’abstraction des énoncés affirmant des droits sociaux pour dénier leur effet direct est donc artificiel. 2. Les droits sociaux sont des droits subjectifs au même titre que les droits civils, et porteur des mêmes types d’obligations. Tout sujet de droit peut, sur le fondement des droits sociaux comme sur celui des droits civils et politiques, exiger d’un autre sujet de droit une action, une abstention ou une permission d’action en vue de garantir le libre exercice de ses intérêts. En d’autres termes, tout droit ou liberté est porteur « d’obligations positives et négatives ». Comme le précise le droit international, tout droit ou liberté implique à l’égard des tiers publics ou privés a) une obligation de respecter (de ne pas s’immiscer dans l’exercice du droit garanti), b) une obligation de protéger (de ne pas permettre d’atteintes), c) une obligation de réaliser (de fournir les moyens d’un exercice effectif du droit)4. Par exemple, la liberté d’aller et venir, liberté de type individuel, implique : a) de ne pas arrêter arbitrairement les personnes, b) de les protéger contre les enlèvements, c) de construire des infrastructures routières, de mettre en place des réseaux de transports collectifs… De même, le droit au respect de l’intégrité physique impose de : a) s’abstenir de provoquer la mort, b) de protéger contre la criminalité, c) de lutter contre les épidémies. Le droit au logement, analysé habituellement comme un droit social, implique : a) le droit au maintien dans le logement pour les occupants à titre normal, toute expulsion ou non renouvellement du bail étant à ce titre strictement encadré, b) la protection contre des privations arbitraires du logement, c) la définition de politiques publiques d’accès au logement. 4 V. notamment, à la suite des travaux du Comité des droits sociaux du PIDESC, O. DE SCHUTTER, « Les générations des droits de l’homme et l’interaction des systèmes de protection : les scenari du système européen de protection des droits fondamentaux », in : OMIJ (dir.), Juger les droits sociaux, PULIM, p. 13. 3. Les lacunes de la doctrine juridique. Le défaut de techniques assurant la garantie effective des droits économiques et sociaux repose simplement sur un retard des sciences juridiques uploads/S4/ amicus-curiae-credof.pdf
Documents similaires









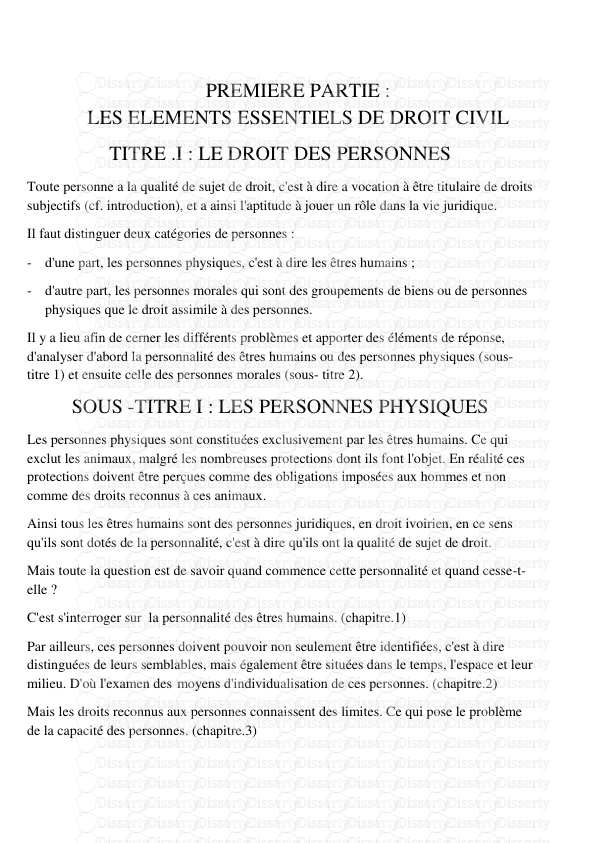
-
99
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 13, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.2514MB


