4- Autonomie institutionnelle Se pose ici une question cruciale. De quel degré
4- Autonomie institutionnelle Se pose ici une question cruciale. De quel degré d'autonomie jouissent les forces policières pour valider leur système d'identification des toxicomanes ? Les comportements policiers sont-ils soumis au contrôle d'une instance gouvernementale indépendante ? Dans un régime démocratique, cette question équivaut à se demander si la police a besoin d'aller au-delà de ses présomptions pour chercher des preuves admissibles en justice. La réponse est négative. Les institutions policières ont la possibilité de contourner le pouvoir judiciaire. Cette possibilité dérive de l'existence de l'Édit sur l'ébriété et autres intoxications, applicable dans la ville de Buenos Aires, et des dispositions similaires dans les provinces, incluses dans les Codes en matière correctionnelle (Códigos de faltas) respectifs. Les lois fédérales sur les drogues punissent la détention des substances interdites, mais pas directement leur consommation. Pour le droit pénal moderne, c'est inadmissible d'accorder simultanément aux toxicomanes la qualité de malades et de contrevenants. La loi punit, en principe, des faits délictueux, pas une condition jugée pathologique. Ce serait un scandale juridique de condamner quelqu'un parce qu'il n'est pas « normal ». C'est pourquoi l'utilisation des drogues n'entre dans le domaine de la justice pénale que par l'entremise d'un fait matériel, la possession d'un produit interdit, ou d'une action publique, la consommation ostentatoire. Ces subtilités légales posent des problèmes à l'action policière. Pour accuser quiconque d'avoir violé la Loi sur les drogues, la police doit obligatoirement présenter aux juges le corpus delictum ou des preuves d'exhibitionnisme, et ce, selon des procédures précises. Cependant, les attributions des forces policières en matière de justice correctionnelle permettent aux policiers d'incriminer et de juger des inculpés sans avoir à chercher des preuves matérielles. Pour l'application de l'édit sur l'ébriété, les présomptions des agents suffisent. Les individus ne sont donc pas jugés pour ce qu'ils ont fait, mais en vertu de leurétat aux yeux des policiers. Et c'est le chef de la police lui-même qui rend les sentences et qui veille à l'exécution des peines. a) Juger les intoxiqués L'analyse de l'édit sur l'ébriété de la PFA et de son application sur le terrain permet de mesurer l'impact du pouvoir policier sur la détermination du phénomène toxicomaniaque. Le texte de cette ordonnance, dont je reproduis ci-dessous les paragraphes essentiels, date de 1932. Il a été promulgué par le chef de la PFA avec de nombreuses autres dispositions visant « à défendre la tranquillité des passants de classe moyenne, et à contrôler la propreté des rues, le silence nocturne et la mesure des divertissements (Cerdos & Peces, juillet 1984, p. 37) ». En effet, l'ébriété et les intoxications sont sanctionnées au même titre que le vagabondage, les désordres et les scandales dans la voie publique. En même temps, toutes les activités susceptibles de provoquer de telles contraventions sont réglementées, comme les bals et les fêtes populaires (cf. Benítez, 1986). L'édit sur l'ébriété et autres intoxications reflète clairement cette préoccupation policière d'atteindre des modes de vie et des attitudes que les normes de droit n'avaient pas prévu de sanctionner. Édit de la Police fédérale argentine (PFA) concernant l'ébriété et autres intoxications (15-7-1932). Article trois - Est coupable d'une infraction et passible soit d'une amende de 1.500 $ à 3.000 $, soit d'un emprisonnement de 15 à 30 jours, quiconque se trouve sous l'effet d'alcaloïdes ou de narcotiques dans [un endroit public, dans la rue, dans une place, un café, un cabaret, une épicerie, un bar ou tout autre débit de boissons]. [...] Article quatre - Est coupable d'une infraction et passible soit d'une amende de 900 $ à 1500 $, soit d'un emprisonnement de 9 à 15 jours, quiconque utilise des alcaloïdes ou des narcotiques à l'intérieur d'un immeuble privé et provoque ainsi l'intervention de la police. De cette façon, la vie des particuliers est soumise en tout temps aux critères d'ordre de la police, peu importe que les gestes reprochés soient posés en public ou dans l'intimité, ou qu'ils nuisent ou non à un tiers. Comme je l'ai expliqué dans l'introduction de cette section, l'application des édits dépend d'un code de procédure tout aussi particulier, sanctionné plus tard, en 1956. En fait, le Règlement de procédure en matière de contraventions aux édits de la police (RRPF 6) suppose des mécanismes d'enquête et de recours « qui empiètent sur l'ensemble des principes du droit pénal et de la procédure pénale (Zaffaroni, 1986a : 19) ». Parmi les exceptions générales qu'y figurent, il convient de retenir celles-ci : l'âge de responsabilité pénale baisse à 14 ans (art. 14), les peines de détention sont purgées dans les commissariats (art. 23), les preuves doivent être « faciles et rapides » (art. 138) et, enfin, la confession de l'inculpé, sans la présence de son avocat, suffit comme preuve (art. 155) 128 . Mais la dérogation à la procédure pénale ordinaire prévue par le RRPF 6 est encore plus flagrante dans le cas des individus accusés d'avoir consommé des substances interdites. Ceux qui ne sont pas aptes à subir un procès pénal ne peuvent pas êtres jugés par le chef de police, à moins qu'ils soient des toxicomanes (art. 6). Les toxicomanes récidivistes, « connus de la police », écopent de la peine maximale et perdent la possibilité de payer une amende compensatoire, c'est-à-dire qu'ils ont à subir 30 jours d'emprisonnement sans sursis (art. 43). Pour recevoir la « qualification de toxicomane », il suffit de l'avis du policier intervenant et du responsable du poste de police (art. 45 et 104) 129 . Les policiers n'ont pas à respecter leurs juridictions respectives pour interpeller ou arrêter des toxicomanes (art. 89). Les mineurs ne doivent pas être conduits aux commissariats pour ne pas « les déprimer », sauf s'ils sont intoxiqués (art. 94). Les militaires, les diplomates, les fonctionnaires et les policiers intoxiqués doivent être obligatoirement examinés par un médecin légiste (art. 149) et remis illico en liberté (art. 181). Des formulaires spéciaux sont prévus pour enregistrer les antécédents des toxicomanes (art. 161). Ces exceptions sont encore plus notables que celles qui ont été prévues à l'endroit de tous les autres « indésirables et amoraux » dont la punition exige - selon la PFA - des prévisions spéciales, à savoir les prostituées, les voleurs à la tire, les mendiants, les « pédérastes passifs ou actifs », les proxénètes et même les « vendeurs d'alcaloïdes ». La police réserve ainsi aux individus qualifiés de toxicomanes un régime de procédure qui les place très concrètement au même rang que les parias. Cela n'a rien d'imaginaire ni d'irréfléchi : les policiers ont à suivre des procédés bien réels et bien réglementés. Ce pouvoir peut être considéré arbitraire à la lumière des garanties que la Constitution nationale assure aux citoyens dont la liberté est menacée par une instance gouvernementale. Sauf que l'arbitraire, dans ce cas- ci, n'est pas de l'ordre du caprice. Le pouvoir policier circule à l'intérieur d'un dispositif institutionnel bien établi et donne lieu à des pratiques précises. Ce sont elles qui déterminent ce qu'est la toxicomanie, qui est un toxicomane et, conséquemment, le traitement qu'il mérite. Il semble donc juste d'affirmer, a contrario sensu, que sans ce travail de dépistage, de qualification et d'insertion dans le système correctionnel géré par la police, les utilisateurs ne sont pas des toxicomanes. Le lecteur étranger sera surpris par l'ampleur des pouvoirs dont disposent les institutions policières en Argentine et par la manière dont elles sont parvenues à réguler la pratique d'un pouvoir discrétionnaire. Certains Argentins en sont tout aussi émus et n'ont pas hésité à critiquer l'existence des édits. Cependant, ils n'ont pas pu empêcher l'application constante des édits, qui est devenue particulièrement intense dans la période post-dictatoriale. La police semble pouvoir résister à toutes les critiques dont elle a été l'objet. Les critiques à l'endroit des institutions policières sont de deux genres. Il y a, en premier lieu, des critiques « politiques ». Les édits violent l'équilibre des pouvoirs propres à une république : le chef de la police - dépendant de l'exécutif - édicte des normes, juge les contrevenants et exécute les sentences (Gentili, 1995 ; Schmirgeld, 1986). Que le Congrès ait converti les édits en loi de la Nation et ait enlevé à la PFA le droit d'en promulguer desnouveaux ne change pas la situation : c'est une instance administrative qui impose les peines, suivant ses propres procédures, par rapport à des comportements qu'elle considère comme répréhensibles. Cette situation est tolérée, voire encouragée, par la Cour suprême. Cette dernière a déclaré que le contrôle exercé par les tribunaux correctionnels - auprès desquels il faut interjeter l'appel d'une sentence policière - était suffisamment efficace 130 . Cependant, il a été démontré que le contrôle juridique des « procès » menés par la police n'existe pas dans la pratique. Les avis d'appel doivent être donnés aux tribunaux 24 heures après la prononciation de la sentence, ce qui est impossible à cause des démarches administratives à faire et du manque d'avocats compétents dans la matière (Gentili, 1995 ; Zaffaroni, 1986a, b). Chiffres à l'appui : le taux d'appel des sentences uploads/S4/ aureano-g-la-construccion-politica-de-la-toxicomania-en-la-argentina-post-autoritara-parte-2.pdf
Documents similaires









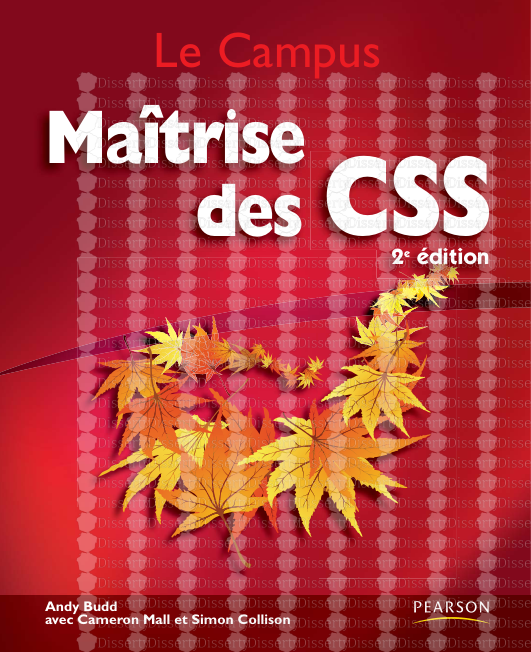
-
177
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 05, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 1.1640MB


