1 Bamodi SIMAGA, MD-PhD, Physiologie, Enseignant chercheur, Maitre-assistant, F
1 Bamodi SIMAGA, MD-PhD, Physiologie, Enseignant chercheur, Maitre-assistant, FMOS/USTTB. PHYSIOLOGIE CARDIOVASCULAIRE Faculté de médecine et d’odontostomatologie (FMOS) PHYSIOLOGIE CARDIOVASCULAIRE Notes de cours réparées par Bamodi SIMAGA, MD – PhD Physiologie et explorations fonctionnelles cardiorespiratoires Enseignant chercheur Maitre-assistant FMOS / USTTB Université des Sciences de Techniques et de Technologies de Bamako (USTTB) 2 Bamodi SIMAGA, MD-PhD, Physiologie, Enseignant chercheur, Maitre-assistant, FMOS/USTTB. PHYSIOLOGIE CARDIOVASCULAIRE Chapitre II Electrophysiologie cardiaque Introduction I. Organisation anatomo-histologique A. Anatomie B. Histologie 1. Tissu nodal 2. Myocarde C. Innervation extrinsèque 1. Sympathique 2. Parasympathique II. Electrophysiologie cardiaque A. Propriétés électrophysiologiques des cellules nodales 1. Automaticité 2. Excitabilité 3. Conductibilité B. Excitation 1. Activité électrique spontanée 2. Conduction de l’influx excitateur 3. Facteur modifiant l’activité spontanée C. Couplage excitation contraction 1. Période réfractaire III. Régulation de l’activité électrique du cœur A. Rôle du système nerveux autonome 1. Système nerveux parasympathique 2. Système nerveux sympathique IV. Explorations fonctionnelles A. Electrocardiogramme (ECG) 1. Enregistrement 1.2. Matériel 1.3. Conditions d’enregistrement 2. Analyse de l’ECG B. Applications cliniques 3 Bamodi SIMAGA, MD-PhD, Physiologie, Enseignant chercheur, Maitre-assistant, FMOS/USTTB. PHYSIOLOGIE CARDIOVASCULAIRE Introduction : Le fonctionnement cardiaque comprend deux phases : la phase électrique et la phase mécanique. Les phénomènes électriques précèdent toujours les phénomènes mécaniques. La succession de ces évènements et leurs synchronisations sont assurée par la disposition anatomique particulière des cellules myocardiques et des cellules ayant les propriétés de décharges électriques spontanées à intervalle de temps réguliers et de la propagation de l’influx au muscle cardiaque en les excitant. Il s’agit de cellules d’un tissu spécial intracardiaque, appelé tissu nodal qui représente en moyenne 1 ℅ des cellules cardiaques. Le tissu nodal est caractérisé par des propriétés fondamentales : l’excitabilité et la conductibilité. Le cœur isolé et perfusé continue à battre tant qu’on lui apporte les éléments nutritifs nécessaires à son fonctionnement. I. Organisation anatomo-histologique : A. Anatomie : La genèse et la propagation de l’influx excitateur à l’ensemble du myocarde est assurée par une entité particulière : le tissu nodal. Il est organisé en : un nœud sino-auriculaire ou nœud sinusal, un nœud auriculo-ventriculaire, des faisceaux de communications internodales de Backman, un réseau de conduction intraventriculaire à partir du nœud auriculo-ventricu- laire, le faisceau de His, les branches d’Aschoff Tawara ainsi que le réseau de Pur- kinje. Le nœud sinusal se trouve à la face antérieure de la jonction oreillette droite veine cave supérieure. En forme de croissant lunaire, il mesure 15/5 mm. Il est vascularisé par une branche de l’artère coronaire droite. Trois voies préférentielles de conduction est établit entre les deux nœuds, les faisceaux de Backman. Ils comprennent le faisceau antérieur, le faisceau moyen et le faisceau postérieur. Le nœud auriculo-ventriculaire est situé à la partie inféro-antéro-médial du septum inter auriculaire, entre l'ostium du sinus coronaire et l’insertion du feuillet septale des valves tricuspides. Il est plus petit que le nœud atrial, avec une dimension de l’ordre de 3/2/1 mm. Il est vascularisé par une branche de l’artère coronaire droite. Le tronc du Faisceau de His prolonge le nœud auriculo-ventriculaire. Il parcourt le septum interventriculaire sur sa face droite en se dirigeant en avant et un peu vers le bas et en traversant le plancher fibreux central qui sépare l’étage auriculaire de l’étage ventriculaire, pour ensuite, se diviser en ses deux branches, presque à cheval sur le bord supérieur de la portion musculaire du septum interventriculaire. Il mesure environ 10 mm de long et 2 mm de large. Il est 4 Bamodi SIMAGA, MD-PhD, Physiologie, Enseignant chercheur, Maitre-assistant, FMOS/USTTB. PHYSIOLOGIE CARDIOVASCULAIRE vascularisé par la branche septale de l'artère interventriculaire postérieure et une branche de l’artère coronaire droite. La branche droite du Faisceau de His ou branche droite d’Aschoff Tawara : longue et étroite, chemine d'abord sous l'endocarde septal droit, puis dans le myocarde septal commun, puis suit la bandelette ansiforme, sur la face droite du septum interventriculaire, et se termine au niveau du pilier antérieur du ventricule droit. Elle est vascularisée par des branches de l’artère septale issue de l'interventriculaire antérieur (IVA). La branche gauche du Faisceau de His ou branche gauche d’Aschoff Tawara : courte et large, traverse la cloison interventriculaire et apparait sur la face gauche du septum interventriculaire au-dessous de la commissure entre la sigmoïde antéro droite et postérieure. Elle est vascularisée par l’artère interventriculaire antérieure et l’artère coronaire droite. Elle se divise a mis chémin en deux hémibranches : l’hémibranche antéro-supérieure, assez longue et fine, se termine dans le pilier antérieur du ventricule gauche. Elle est vascularisée par l'artère interventriculaire anté- rieure, l’hémibranche postéro-inférieure, courte et large se termine dans le pilier postérieur du ventricule gauche. Elle est vascularisée par l'artère interventriculaire postérieure. Le réseau de Purkinje termine les branches droite et gauche d’Aschoff Tawara. Il s’agit de fines branches de ramification sous endocardique qui terminent les voies de conduction et les relient au myocarde. Il existe aussi des voies accessoires inconstantes de conduction qui établit un contact entre le myocarde auriculaire et ventriculaire comme une seule voie de passage possible, qui normalement sont séparés par un anneau fibreux. Figure 1 : Organisation anatomo fonctionnelle du tissu nodal. 5 Bamodi SIMAGA, MD-PhD, Physiologie, Enseignant chercheur, Maitre-assistant, FMOS/USTTB. PHYSIOLOGIE CARDIOVASCULAIRE Figure 2 : Tissu nodal. B. Histologie : 1. Tissu nodal : Le tissu nodal est constitué principalement de deux types de cellules : les cellules nodales proprement dites et les cellules de transitions. Les cellules nodales sont des petites cellules rondes ou ovoïdes accolées les unes aux autres sans membrane basale et disposées en petit amas limités par une membrane basale. Les cellules de transition sont plus longues et plus fines que les myocytes auriculaires. Cependant, leur morphologie se rapproche progressivement de celle des myocytes au fur et à mesure que l’on s’éloigne du centre du nœud sino-auriculaire. Les cellules transitionnelles ont au moins deux fonctions : d’une part, elles constituent un réseau d’interconnexion entre les amas de cellules no- dales, qui vraisemblablement permet de synchroniser l’électrogénèse sinusale, d’autre part elles assurent la liaison anatomique et fonctionnelle des cellules nodales avec les myocytes auriculaires, les isolants les unes des autres. En outre il existe les fibroblastes et les fibres de collagène qui constituent le tissu de soutient des nœuds et contribuent à isoler les cellules nodales des myocytes cardiaques, de sorte que les cellules de transition sont le seul lien électrique entre les cellules nodales proprement dites et les cardiomyocytes. Cependant 1. le nœud sino-auriculaire : est essentiellement constitué de cellules nodales propre- ment dites collées les unes aux autres sans membrane basale, formant un amas. De ces cellules nodales partent les cellules transitionnelles qui forment les faisceaux interno- daux, 2. le nœud auriculo-ventriculaire : possède les mêmes types de cellules qu’au niveau du nœud sino-auriculaire. Par contre dans ce nœud les cellules nodales sont soit isolées, 6 Bamodi SIMAGA, MD-PhD, Physiologie, Enseignant chercheur, Maitre-assistant, FMOS/USTTB. PHYSIOLOGIE CARDIOVASCULAIRE soit regroupées en de très petits amas disséminés à travers tout le nœud et elles tendent à s’agréger à l’approche de la zone de jonction avec le faisceau de His, le tout étant encerclé par les cellules transitionnelles. 3. le tronc et les branches du faisceau de His : sont principalement constitués de cellules transitionnelles disposées longitudinalement et parallèlement les unes aux autres, chacune étant gainée de collagène, ce qui les isole d’une extrémité à l’autre. 4. le réseau de Purkinje est fait de cellules transitionnelles. Figure 3 : Organisation histologique des nœuds, principalement faite de cellules nodales proprement dites. Figure 4 : Organisation histologique des faisceaux, principalement faite de cellules de transition. 2. Myocyte cardiaque : Les cellules musculaires cardiaques sont des cellules striées possédant un noyau unique. Elles se divisent puis se recombinent avant de diverger à nouveau. Elles possèdent des propriétés intermédiaires entre celles du muscle strié squelettique et celles du muscle lisse. Elles sont reliées entre elles par des jonctions appelées stries scalariformes, composées de segments longitudinal et transversal : la composante transversale, représentée par le disque Z est constituée des desmosomes et de fascia adherens, 7 Bamodi SIMAGA, MD-PhD, Physiologie, Enseignant chercheur, Maitre-assistant, FMOS/USTTB. PHYSIOLOGIE CARDIOVASCULAIRE la composante longitudinale est uniquement constituée de GAP jonctions qui assure le passage des ions et des petites molécules entre les cellules adjacentes. Les myofibrilles cardiaques possèdent de surcroit les mêmes protéines contractiles (filaments d’actine et de myosine) que dans le muscle squelettique et leurs organisations fonctionnelles sont identiques. Ces filaments s’intercalent et glissent les uns sur les autres au cours des phénomènes de contraction. Les cardiomyocytes possèdent un noyau central, à la différence des cellules musculaires striées squelettiques aussi quelques différences comme : la présence de tubules T au niveau des disques Z, un réticulum sarcoplasmique moins étendu que celui du muscle strié squelettique, le diade du cardiomyocyte correspond à l’association du tubule T à une citerne de réti- culum sarcoplasmique contre deux citernes de réticulum sarcoplasmique pour un tubule T dans le muscle strié squelettique, un grand nombre de mitochondries dans le cardiomyocyte. La cellule musculaire cardiaque est uploads/S4/ chapitre-ii-1-phy-cv.pdf
Documents similaires
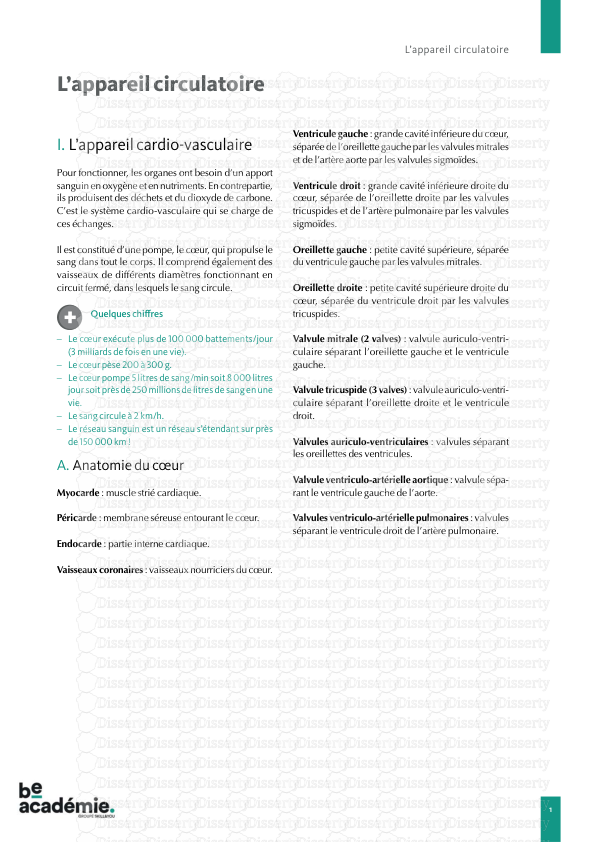









-
54
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 18, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 1.3588MB


