1 Centre Perelman de Philosophie du Droit Université Libre de Bruxelles http://
1 Centre Perelman de Philosophie du Droit Université Libre de Bruxelles http://www.philodroit.be Concilier le management avec les valeurs du judiciaire Série des Workings Papers du Centre Perelman de Philosophie du Droit n°2012/04 2 Comment citer cette étude? Benoit Frydman, Concilier le management avec les valeurs du judiciaire? Working Papers du Centre Perelman de Philosophie du Droit, 2012/04, http://wwwphilodroit.be 3 Concilier le management avec les valeurs du judiciaire Benoit Frydman Professeur ordinaire à l’ULB Directeur du Centre Perelman de Philosophie du Droit Nous souhaitons tous et les magistrats les premiers une justice efficace. Mais pourquoi nous en remettons nous aujourd'hui aux techniques du management pour produire cette efficacité ? Après tout, avant le management, il y avait déjà une organisation du pouvoir judiciaire et une administration de la justice, dont les principes sont d'ailleurs soigneusement prescrits par notre Code judiciaire. Sans doute cette organisation, cette administration ne sont plus jugées satisfaisantes quant à leurs performances, dans un contexte caractérisé à la fois par l'explosion multiforme de la demande de justice et par la limitation sinon la pénurie des moyens mobilisés pour la rendre. Au-delà même de la justice, la vogue du « nouveau management public » touche tous les services publics. Elle vise à transposer aux administrations des techniques mises au point dans l'entreprise privée pour accroître les rendements et la qualité en maîtrisant les coûts. On se gardera bien cependant de considérer ce nouveau management comme une panacée. De nombreuses critiques s'élèvent en effet, y compris de la part des spécialistes et des managers eux-mêmes, jusqu’au sein des entreprises privées, pour dénoncer la surcharge des coûts, des rapports et des appareils qu’il entraine, avec des résultats souvent contestés. Mais je ne m'appesantirai ici sur ces critiques. Le nouveau management est en marche; il est aux portes de nos palais de justice; en réalité, il y a déjà établi ses quartiers. Aussi je voudrais examiner si ce nouveau management et les techniques qu'il apporte avec lui sont compatibles avec les valeurs du judiciaire et, plus précisément, avec les principes et les règles fondamentales de son organisation et de son fonctionnement, ou comment le rendre compatible avec ces principes et ces règles auxquels il ne saurait être question, à mon sens du moins, de déroger. Cette compatibilité ne va pas de soi car le management constitue un mode de normativité et de gouvernement des hommes qui diffère fondamentalement et concurrence la gouvernance par le droit (rule of law) qui définit notre Etat de droit, dont le pouvoir 4 judiciaire est précisément le gardien1. Il y a donc, dans le projet d'introduire la logique managériale dans le cœur même de l'appareil constitutionnellement chargé de veiller à l'application et au respect du droit, quelque chose qui pourrait ressembler à un cheval de Troie et qui contribue à expliquer une certaine hostilité, en tout cas une certaine défiance à l'égard de l'importation de ces normes nouvelles. Ceci n'est en définitive guère surprenant. Que diraient les hommes politiques si on leur demandait d'adopter les recettes du nouveau management au Parlement et à la gouvernance des sénateurs et des députés ? Cependant, si l’on admet, ce qui parait évident, que la justice, bien que séparée constitutionnellement de l'exécutif, requiert bien elle aussi une « administration », alors il est raisonnable que cette administration soit gérée de la manière la plus efficace et la moins onéreuse possible, dans le respect des principes fondamentaux qui l'organisent, sans lesquels la justice n'est pas la justice, au sens du moins au sens où nous l'entendons. Je voudrais évoquer ici quatre de ces principes fondamentaux que toute réforme ou initiative managériale doit impérativement respecter. Le premier c'est le principe, fondateur de l'Etat de droit, de l'indépendance du pouvoir judicaire à l'égard des autres pouvoirs2. Ce principe exige que le management de la justice (le management étant une technique de gouvernement des personnes, de « conduite des conduites », d'exercice d'un pouvoir d'influence et de contrôle qui régit et transforme les comportements et oriente les actions des gens) soit exercé par le pouvoir judiciaire lui-même, par une autorité établie en son sein ou en tout cas indépendante du pouvoir exécutif en général et du ministre de la Justice en particulier. Dans les pays qui, comme la Belgique, ont une conscience et une tradition fortes de l'indépendance du judiciaire, toutes les réformes managériales initiées par ou depuis l'exécutif ont été vouées à l'échec. Le management de la justice doit donc nécessairement pour réussir être un " auto-management", ce qui n'est pas si simple à penser ni à réaliser dès que les autres pouvoirs tiennent fermement serrés les cordons de la bourse, arme suprême du management. Ces difficultés expliquent peut-être en partie les hésitations des réformes passées, traduites notamment par la multiplication des organes et 1 Sur cette question, le lecteur peut se référer à notre étude précédente : « Le management comme alternative à la procédure », publiée dans B. Frydman et E. Jeuland dir., Le nouveau management et l’indépendance des juges, Paris, Dalloz, 2011, pp. 101-110. 2 Voyez sur ce principe, le célèbre arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 1996, dit « arrêt spaghetti », dessaisissant le juge Connerotte de l’instruction de l’affaire Dutroux. Pour une analyse de cet arrêt et du principe, on peut lire notamment : B. Frydman, « La démocratie en quête de principes », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 1997.39, pp. 150-166. 5 autres commissions en charge de tel ou tel aspect du management de la justice. Pourtant, si l’on considère les structures en place, une institution récente semble toute désignée et comme créée expressément pour remplir cette fonction : c’est le Conseil supérieur de la justice, à la fois par son statut d’autorité indépendante de la justice, par les compétences importantes qu’il exerce en matière de recrutement, nomination, évaluation et promotion des magistrats et par les moyens dont il est doté en matière d’audit, de surveillance de la gestion, d’enquêtes et de traitement des plaintes. Il s’agit d’ailleurs d’un modèle qui tend à se dégager progressivement au niveau européen3. Le deuxième principe concerne aussi l'indépendance mais sous un autre aspect : c'est l'indépendance du juge en tant qu'auteur d'un acte juridictionnel. Or ce principe, tout aussi fondamental, est concurrencé, voire dans certains cas directement menacé par la logique managériale qui tend normalement à renforcer les rapports hiérarchiques. Il y a là un risque de confusion toujours dangereux pour la justice et qui a existé de tout temps, se manifestant notamment à l’occasion de certaines affaires récentes, où des magistrats consultent, sur une décision à prendre ou l'orientation à donner sur un délibéré, d'autres magistrats, certes supérieurs dans la pyramide judiciaire, mais qui peuvent être amenés à connaître de la même affaire dans le cadre de l'exercice d'une voie de recours légal. Il vaut mieux à cet égard observer une certaine prudence, voire une certaine réserve par rapport à la glorification sans nuance de la « transparence », valeur cardinale du nouveau management. La valeur qui domine l’administration de la justice, c’est le principe de publicité, laquelle est tout autre chose que la transparence, notamment en tant qu’elle est tout à fait compatible avec le secret, parfois nécessaire en matière de justice, mais auquel le management est décidément allergique4. Par ailleurs, le principe d'indépendance du juge rend difficilement acceptables certains indicateurs (pourtant largement utilisés dans des systèmes étrangers) qui font dépendre l'évaluation d'un juge, et donc l’évolution de son traitement ou de sa carrière, du taux de recours contre ses décisions ou pire encore du taux de réformation de celles-ci par la juridiction supérieure. Troisième principe qui doit être respecté et que les recettes du management, fussent- elles nouvelles, ne peuvent contredire ni même discrètement court-circuiter : la légalité de la 3 Voyez notamment le cas des Pays-Bas analysé dans le présent ouvrage. 4 Sur la notion de transparence et ce qui la distingue de la publicité, on peut lire B. Frydman, « La transparence, un concept opaque ? », Journal des tribunaux, 2007, pp. 300-301 (numéro spécial 125ème anniversaire). 6 procédure. La justice doit être rendue au terme d'une procédure fixée par la loi et non pas, même pour des raisons d'efficacité, sur la base d'impératifs de gestion interne. Il faut donc se montrer très vigilant par rapport aux procédures, organes, formulaires et autres logiciels que le nouveau management met en place en parallèle avec les procédures et les règles établies par la loi, afin d'éviter non seulement la redondance néfaste à l'efficacité, mais également que les règles légales et les motifs qu'ils les ont inspirées ne soient contournés ou détournés de leur fin5. Car le management (et c’est d’une certaine manière une de ses forces) n’a pas besoin de réforme législative, pour modifier les comportements. J'ai été ainsi frappé par les paroles du ministre Stefaan De Clerck lorsque, venu présenter son projet de réforme du système judiciaire à l'ULB le 1er mars 2010, il nous assurait que sa réforme serait « purement managériale » et que « pas un article du Code judiciaire ne serait uploads/S4/ concilier-les-management-avec-les-valeurs-du-judiciaire.pdf
Documents similaires







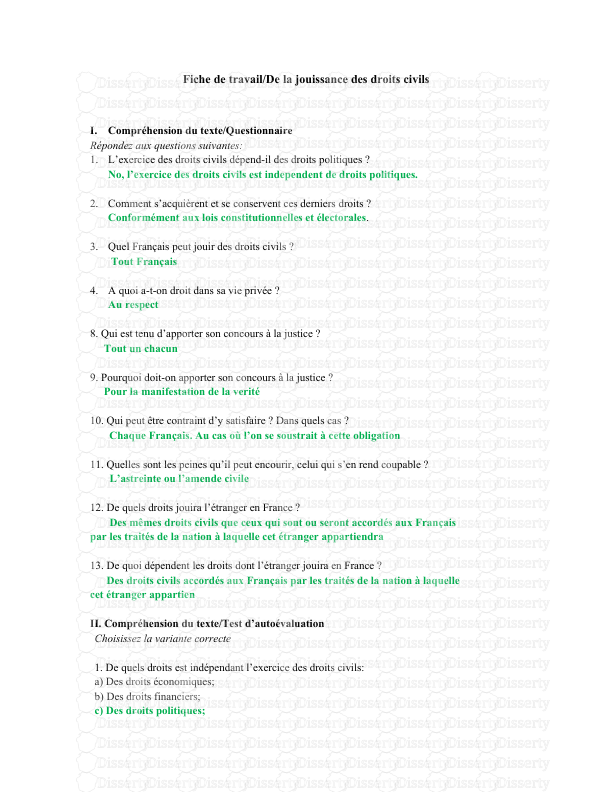


-
99
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 02, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.2786MB


