VOTRE DOCUMENT SUR LABASE-LEXTENSO.FR - 16/05/2020 11:14 | UNIVERSITE DE SAVOIE
VOTRE DOCUMENT SUR LABASE-LEXTENSO.FR - 16/05/2020 11:14 | UNIVERSITE DE SAVOIE Droit et développement durable Issu de Revue du droit public - n°2 - page 453 Date de parution : 01/03/2008 Id : RDP2008-2-005 Réf : RDP 2008, p. 453 Auteur : Par Alexandre Touzet, Chargé d'enseignement, Université d'Evry Val d'Essonne SOMMAIRE I. _ LA SPÉCIFICITÉ JURIDIQUE DE LA NOTION DE DÉVELOPPEMENT DURABLE A. _ Droit de l'environnement et développement durable B. _ Droit de la nature et développement durable C. _ Droit international et développement durable II. _ LA DENSITÉ JURIDIQUE DE LA NOTION DE DÉVELOPPEMENT DURABLE A. _ Une notion portée par le droit international B. _ Une notion reconnue dans les différents systèmes juridiques C. _ Une notion reconnue en droit interne III. _ L'EFFECTIVITÉ DE LA NOTION DE DÉVELOPPEMENT DURABLE A. _ Développement durable et organisation administrative B. _ Développement durable et politiques publiques C. _ Développement durable et norme opposable La notion de développement durable est de plus en plus utilisée pour justifier des politiques publiques, illustrer le comportement « civique » d'une entreprise ou mobiliser le citoyen pour la sauvegarde de la planète. Pour autant, la doctrine envisage peu ce concept et s'accorde le plus souvent pour relever voire dénoncer son imprécision. Pour Chantal Cans, « il s'agit d'une locution dont nul texte n'a pu, jusqu'à présent, offrir une définition concise » et qui « induit une approche nébuleuse des réalités, voire des politiques qu'elle prétend régir »1. Le développement durable apparaît ainsi comme un concept « incantatoire » : « il y a peu de notions qui soient aussi souvent invoquées et aussi rarement précisées »2. Au-delà de l'imprécision de cette notion, les motivations de son utilisation sont parfois critiquées au regard de sa facilité, de son caractère incantatoire ou mercantile. Le développement durable ferait « partie du dictionnaire des idées reçues contemporaines »3. Un rapport parlementaire précise que « la formule a ainsi spectaculairement pris le pas sur le concept. Le développement durable n'est plus un guide pour les politiques, c'est un enjeu pour un discours »4. Enfin, son utilisation dans la sphère des entreprises « constitue tout le moins une récupération, et bien souvent une imposture »5. Sans partager une critique systématique, il convient de s'interroger sur la véritable portée de cette notion et plus particulièrement son insertion dans le droit positif. Préalablement, les contours de ce concept doivent être précisés et replacés dans un contexte historique. L'histoire du développement durable ne saurait se confondre avec celle de la protection de l'environnement. Pour une partie de la doctrine, il convient de voir dans la gestion forestière les prémisses de cette notion6. En 1661, Louis XIV confie à son ministre Colbert une mission visant à réformer la foresterie. Il ne s'agit pas à l'époque de protéger l'environnement mais d'assurer l'approvisionnement en bois de la marine7. La réglementation appliquée (bois en futaie, encadrement des coupes et de la vente du bois...) illustre la volonté d'assurer la pérennité d'une ressource pour satisfaire aux besoins futurs. Inspiré de ces méthodes, Hans Carl von Carlowitz (1645-1714), dans son ouvrage Sylvicultura oeconomica, appelle à une maîtrise de la consommation domestique du bois afin de pourvoir aux besoins des nouvelles générations. Il invite les États à partager les connaissances car il s'agit d'un progrès essentiel pour l'humanité. La gestion du bois doit permettre une utilisation « continuelle » de la ressource8. Son ouvrage constitue une première approche du développement durable : la protection de l'environnement, les obligations envers les nouvelles générations et l'utilisation du terme « durable » pour qualifier la gestion forestière qu'il appelle de ses voeux9. Toutefois, il faut attendre le XXe siècle pour envisager une approche globale du développement durable. Au début des années soixante-dix, une vive réflexion s'engage sur les dangers d'une croissance incontrôlée. Un rapport remis au Club de Rome, « the limits to Growth », dénonce les impasses d'un modèle économique qui se caractérise par l'augmentation de la consommation et du nombre de consommateurs ainsi que par une utilisation accrue des ressources naturelles et une pollution consubstantielle10. Cette étude suscite une vive réaction qui est accentuée par une traduction lapidaire du titre (Halte à la croissance ?)11. Or, la croissance doit être, selon ce rapport, orientée en favorisant la localisation de celle-ci dans les pays en voie de développement et en encourageant la production de biens non-polluants. En 1972 à Stockholm, la conférence des Nations unies sur « l'environnement humain » marque une prise de conscience. Le principe 1 de la déclaration finale expose notamment que « l'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures ». Cette conférence constitue une « matrice environnementale » car elle suscite la création du Programme des Nations unies pour l'environnement et l'adoption ultérieure de textes sectoriels (faune et flore, couche d'ozone...). En 1983, l'ONU créait la Commission mondiale sur l'environnement et le développement durable qui doit analyser la situation et faire des propositions. Cette commission publie une contribution « notre avenir à tous » dit rapport « Brundtland » qui définit le développement durable, démontre l'unité des questions liées à la croissance et à l'environnement et les trois axes de ce défi à savoir l'appréhension du développement dans le temps, l'équité sociale et la protection de l'environnement. Le sommet de la Terre de Rio en 1992 formalise sur le plan interétatique cette problématique et adopte un plan d'action à travers son agenda 21. S'agissant de la définition du développement durable, il est possible de se rapporter au principe 3 de la déclaration de Rio : « le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l'environnement des générations présentes et futures ». 1/12 L'expression « développement soutenable » est également employée par une partie de la doctrine car elle constitue une juste traduction de l'expression anglaise « sustainable development » et intègre, outre la problématique de la durée, la question de l'équité. Pour Raphaël Romi, l'objectif est « d'éviter ou à tout le moins de freiner l'irréversible détérioration des ressources naturelles et des rapports humains »12. Le développement durable intègre ainsi la question de la protection de l'environnement mais ne se réduit pas à celle-ci. Il repose sur trois « piliers » qui démontre la globalité de cette approche : l'économie, le social et l'environnemental13. Ce modèle concilie l'efficacité économique, l'équité sociale et la satisfaction des besoins humains ainsi que la protection de l'environnement. Pour Gertrude Pieratti et Jean-Luc Prat, le développement durable est gouverné par trois principes : « le principe d'intégration », « les principes relatifs à l'équité » et « le principe de l'utilisation durable »14. Le principe d'intégration implique de prendre en compte la question de l'environnement pour envisager l'ensemble des décisions. Cette préoccupation doit notamment pénétrer de façon transversale les politiques publiques. Le principe d'équité conduit à envisager le développement de façon équilibrée en préservant des potentialités pour les générations futures et en veillant à une meilleure répartition géographique du développement pour une même génération. La durabilité implique une gestion sur le long terme des ressources. La notion de développement durable a fait l'objet de nombreuses autres approches théoriques qui ne seront pas envisagées dans le présent article15. En effet, l'objet du présent article porte sur les relations établies entre la notion de développement durable et le droit. Pour ce faire, il convient de s'interroger sur la spécificité de la notion de développement durable dans le champ juridique (I). La densité juridique du développement durable (II), c'est-à-dire sa reconnaissance en droit international, comparé et interne, sera envisagée. Cette reconnaissance sera toutefois examinée à l'aune de l'effectivité de la notion de développement durable (III). I. _ LA SPÉCIFICITÉ JURIDIQUE DE LA NOTION DE DÉVELOPPEMENT DURABLE Étudier la relation entre le développement durable et le droit conduit à démontrer la spécificité juridique de la notion de développement durable. En effet, cette dernière doit être distinguée du droit de l'environnement (A) et du droit de la nature (B). Le développement durable présente également une certaine originalité au regard du droit international (C). A. _ Droit de l'environnement et développement durable Droit de l'environnement et développement durable ne se confondent pas totalement bien que certaines approches soient communes. Ainsi, le caractère pluridisciplinaire est partagé. Le droit de l'environnement est, pour Raphaël Romi, « un droit carrefour » qui investit le droit interne et le droit international, le droit public comme le droit privé16. Dans le même sens, Michel Prieur évoque « un droit de caractère horizontal »17. Le développement durable bénéficie également d'une reconnaissance internationale (principe 3 de la déclaration de Rio) et nationale (Charte de l'environnement de 200418). Il mobilise des institutions internationales, nationales et locales de droit public (institutions internationales, États et collectivités territoriales) comme de droit privé (ONG, entreprises transnationales, nationales uploads/S4/ droit-et-developpement-durable-16-05-2020-11-14-36.pdf
Documents similaires



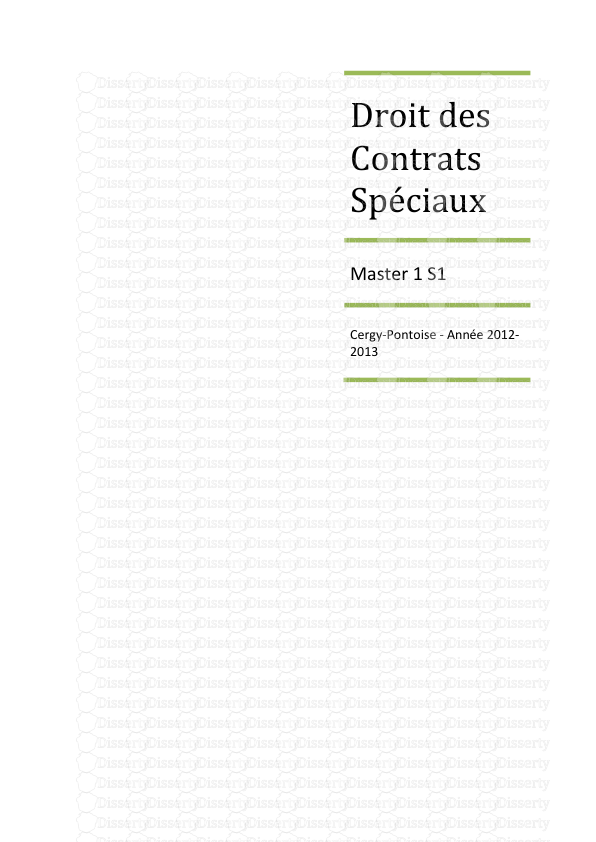






-
33
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 04, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.3028MB


