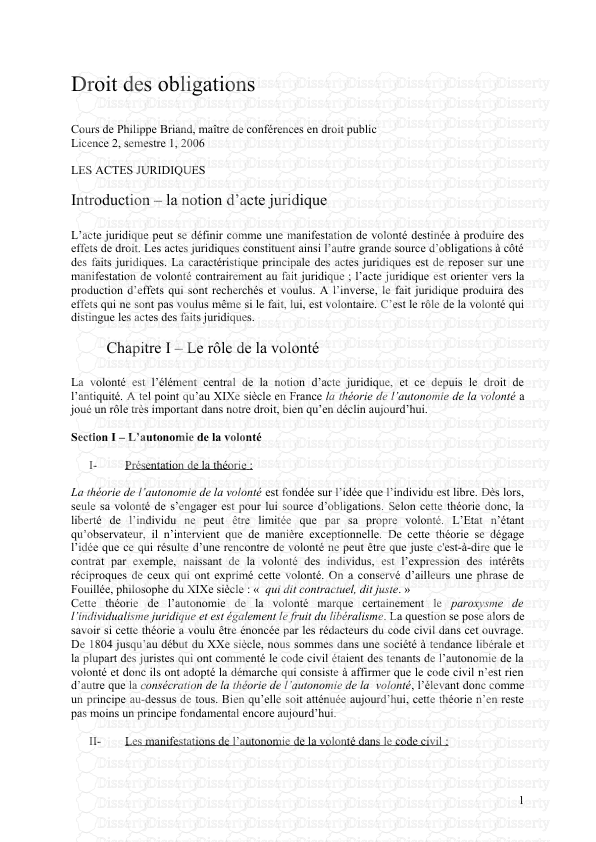Droit des obligations Cours de Philippe Briand, maître de conférences en droit
Droit des obligations Cours de Philippe Briand, maître de conférences en droit public Licence 2, semestre 1, 2006 LES ACTES JURIDIQUES Introduction – la notion d’acte juridique L’acte juridique peut se définir comme une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. Les actes juridiques constituent ainsi l’autre grande source d’obligations à côté des faits juridiques. La caractéristique principale des actes juridiques est de reposer sur une manifestation de volonté contrairement au fait juridique ; l’acte juridique est orienter vers la production d’effets qui sont recherchés et voulus. A l’inverse, le fait juridique produira des effets qui ne sont pas voulus même si le fait, lui, est volontaire. C’est le rôle de la volonté qui distingue les actes des faits juridiques. Chapitre I – Le rôle de la volonté La volonté est l’élément central de la notion d’acte juridique, et ce depuis le droit de l’antiquité. A tel point qu’au XIXe siècle en France la théorie de l’autonomie de la volonté a joué un rôle très important dans notre droit, bien qu’en déclin aujourd’hui. Section I – L’autonomie de la volonté I- Présentation de la théorie : La théorie de l’autonomie de la volonté est fondée sur l’idée que l’individu est libre. Dès lors, seule sa volonté de s’engager est pour lui source d’obligations. Selon cette théorie donc, la liberté de l’individu ne peut être limitée que par sa propre volonté. L’Etat n’étant qu’observateur, il n’intervient que de manière exceptionnelle. De cette théorie se dégage l’idée que ce qui résulte d’une rencontre de volonté ne peut être que juste c'est-à-dire que le contrat par exemple, naissant de la volonté des individus, est l’expression des intérêts réciproques de ceux qui ont exprimé cette volonté. On a conservé d’ailleurs une phrase de Fouillée, philosophe du XIXe siècle : « qui dit contractuel, dit juste. » Cette théorie de l’autonomie de la volonté marque certainement le paroxysme de l’individualisme juridique et est également le fruit du libéralisme. La question se pose alors de savoir si cette théorie a voulu être énoncée par les rédacteurs du code civil dans cet ouvrage. De 1804 jusqu’au début du XXe siècle, nous sommes dans une société à tendance libérale et la plupart des juristes qui ont commenté le code civil étaient des tenants de l’autonomie de la volonté et donc ils ont adopté la démarche qui consiste à affirmer que le code civil n’est rien d’autre que la consécration de la théorie de l’autonomie de la volonté, l’élevant donc comme un principe au-dessus de tous. Bien qu’elle soit atténuée aujourd’hui, cette théorie n’en reste pas moins un principe fondamental encore aujourd’hui. II- Les manifestations de l’autonomie de la volonté dans le code civil : 1 L’autonomie de la volonté trouve son prolongement dans 4 principes fondamentaux de notre code civil : - le consensualisme - la liberté contractuelle - la force obligatoire du contrat - l’effet relatif des conventions A) Le consensualisme (≠ formalisme) Cela signifie que la volonté se suffit à elle-même pour faire naitre des obligations, autrement dit, il n’est pas nécessaire pour que l’engagement soit valable que les partis ce soient pliés à un formalisme particulier. Ainsi, par exemple, l’écrit n’est pas une condition de validité du contrat, seule la réunion des volontés suffit. Dans notre droit donc, le consensualisme est la règle et le formalisme est l’exception. L’autonomie de la volonté est le fait qu’à elle seule elle est susceptible de créer des effets de droit (transfert de droit de propriété). Cependant, l’article 1341 dit qu’au-delà d’une certaine somme la preuve par témoin est irrecevable (1500 € depuis le 01/01/05). Malgré l’existence du contrat, celle-ci pourra pas être prouvé autrement que par écrit (l’écrit est requis ad processionem et ad probationem mais pas ad validitatem). B) La liberté contractuelle Puisque la validité d’un contrat dépend de la volonté des personnes, elles sont libres de ne pas s’engager, et si elles s’engagent, elles sont libres de prévoir les caractéristiques de la relation contractuelle (dans le cadre du respect des bonnes mœurs et de l’ordre public, art.6). Le contrat demeure soumis aux lois qui lui étaient applicables à sa conclusion et donc aucune nouvelle loi ne viendra interférer a posteriori dans les termes du contrat (sauf exceptions). C) La force obligatoire du contrat Les parties sont libres de s’engager mais si elles s’engagent, elles doivent se tenir à leur engagement, la loi y contribuant en conférant une force à l’engagement valablement formé (art. 1134 al 1er - Les conventions légalement formées [« une brèves histoire politique des interprétations de l’article 1134 du code civil » Dalloz 2002, partie chroniques p. 901] tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites). Ceci a pour conséquence que seules les parties au contrat, mais d’une manière conjointe, peuvent défaire ce qu’elles ont fait (art. 1134 al. 2). Autre conséquence : le contrat et son contenu s’impose non seulement aux parties mais aussi au juge, dans le sens, qu’il ne peut pas le dénaturer ; le juge en somme est au service du contrat. D) L’effet relatif des conventions Ce principe signifie que le contrat ne peut pas produire d’effet à l’égard des tiers, c'est-à-dire que les effets du contrat se produisent dans la sphère des parties au contrat (art. 1165 - Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers, […] »). Section 2 – Le déclin de l’autonomie de la volonté 2 Du fait de la loi qui vient s’imposer aux parties du contrat fait passer au second plan la volonté des parties et ce depuis 30 ou 40 ans… I- Les raisons du déclin : Dès le XIXe siècle, un certain nombre de penseurs s’écartent du mouvement libéral et vont s’opposer à Fouillé, notamment Lacordaire : « Entre le fort et le faible, c’est la liberté qui asservit, la loi qui libère. » La plus grande liberté laissée aux contractants sera en toute circonstance de nature à profiter à l’un d’eux au détriment de l’autre. Elle profitera en effet au contractant en situation de domination, et cette liberté viendra donc se retourner contre le plus faible. Lacordaire dit que cette liberté qu’on prône souvent est un leurre du type « du renard dans la poulailler. » La liberté selon lui crée des inégalités et ce qui va venir rééquilibrer le rapport contractant, c’est la loi. Les grands principes de liberté demeure valables entre deux particuliers par exemple, mais, là où ils volent en éclats, c’est entre des rapports hiérarchiques avec un déséquilibre initial. La tendance du droit du XXe siècle a été une tendance au rééquilibrage contractuel. Le législateur va donc intervenir de plus en plus souvent réduisant le principe de l’autonomie de la volonté. II- Les manifestations du déclin : Tout d’abord, dans certains cas, le législateur intervient pour limiter ou supprimer la liberté contractuelle. Le législateur impose parfois une obligation de conclure un contrat (contrat d’assurance auto). Il intervient aussi parfois pour supprimer la liberté de choisir son cocontractant (droit de préemption, droit de se porter acquéreur avant tout autre, accordé à une catégorie d’individus – cas du locataire à qui le bailleur délivre un congé pour vendre ou encore le cas de l’interdiction refus de vente à un consommateur ou la prestation d’un service sauf motif légitime dans la cadre du code de la consommation [art. L122-20]). Lorsque le législateur porte atteinte à la liberté contractuelle, ne porte-t-il pas atteinte à un droit fondamental ? Le conseil constitutionnel n’a jamais vraiment affirmé que la liberté contractuelle était un principe à valeur constitutionnelle. Dans une décision du 3 août 1994, le conseil constitutionnelle dit qu’aucune norme à valeur constitutionnelle ne garanti le principe de la liberté contractuelle puis dans une décision du 30 décembre 1996, il dit que la liberté contractuelle n’est cependant pas étrangère au socle contractuel. Ensuite, le législateur peut intervenir dans la forme du contrat. Le principe reste le consensualisme mais l’écrit est souvent rendu obligatoire par la loi pour protéger le contractant le plus faible (forme du contrat, taille des caractères… - ex. crédit à la consommation). Dans d’autres circonstances, le législateur peut intervenir pour définir le contenu du contrat lorsqu’il interdit certaines clauses comme celles dites « abusives ». Le législateur remet en cause parfois le principe de la force obligatoire du contrat c'est-à-dire dans certaines hypothèses le législateur va permettre au juge de modifier le contrat (ex. lois relatives au surendettement des ménages – lois Neyerts – hypothèse de l’art. 1152 al.2 – dans le cas d’une clause pénale, le juge peut modérer ou augmenter la peine en cas de peine excessive ou dérisoire). Chapitre II- Classification des manifestations de volonté Section I – Les manifestations unilatérales de volonté 3 Cas dans lequel une manifestation de volonté émane d’un individu et un seul dans le but de produire des effets de droit. I- La sphère d’efficacité des manifestations unilatérales de volonté : A) Les manifestations unilatérales de volonté ayant un effet déclaratif Dans ce type de circonstances, une situation juridique uploads/S4/ droitdesobligations.pdf
Documents similaires










-
89
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 27, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.3061MB