Cours de l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées Année 2010 - 2011 SEANCE 1 :
Cours de l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées Année 2010 - 2011 SEANCE 1 : LA NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF Les contrats publics revêtent une importance déterminante pour les personnes publiques en tant que moyen de leurs interventions publiques dans l'économie. Cela s’observe : - sur le plan quantitatif, du fait du nombre des contrats passés quotidiennement par les administrations nationales ou locales et des multiples formules contractuelles susceptibles d'être employées ; - sur le plan qualitatif, dans la mesure où l'usage du contrat est devenu si courant, qu'il a profondément transformé les méthodes de l'administration elle-même, à tel point qu'il est désormais convenu de parler d'« administration contractuelle » pour désigner une nouvelle forme de gestion des intérêts collectifs, moins arbitraire et plus consensuelle. Cela n’implique pas que l'administration recourt systématiquement aux contrats : un grand nombre de ses actes prennent, en effet, la forme du contrat mais n'en restent pas moins par leur nature juridique des actes administratifs unilatéraux. Les contrats publics constituant un mécanisme essentiel d'organisation de la vie juridique, il n'est pas étonnant que l’Union européenne ait fortement influé sur eux et que le droit des contrats publics ait désormais d'importantes sources communautaires. 1 Cours de l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées Année 2010 - 2011 Chapitre 1 : L’identification du contrat administratif Les difficultés tenant à l’identification du lien contractuel existent pour tous les contrats de l’administration. Le contrat administratif présente un particularisme par rapport au contrat de droit privé. En effet, la présence d’une personne publique, dotée de prérogatives de puissance publique, a parfois fait douter certains de la nature authentiquement contractuelle de ces contrats, au point de les assimiler à de véritables règlements. S’agissant des contrats entre personnes publiques, ces incertitudes apparaissent d’autant plus grandes. Il conviendra donc de préciser les indices permettant de conclure à la nature contractuelle d’une convention (section 1) avant d’identifier les éléments nécessaires à la qualification administrative de la convention (section 2). Section 1 : La nature contractuelle de l’acte juridique Pour identifier cette nature, il convient de se référer aux éléments intrinsèquement caractéristiques d’un contrat (§ 1), avant de différencier le contrat d’autres catégories d’actes de droit administratif (§ 2). § 1 : Les éléments caractéristiques d’un contrat Aux termes de l’article 1101 du Code civil, le contrat est « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». Il résulte de cette définition : - que le contrat est une convention, c'est-à-dire un acte juridique formé par l’accord de deux ou plusieurs volontés individuelles ; - que toute convention, tout accord en vue de produire un effet juridique n’est pas un contrat au sens strict du terme. A- Le contrat est créateur d’obligations juridiques Le contrat, créateur de droits et obligations auxquels il assujettit, modifie l’ordonnancement juridique. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre de certaines politiques publiques, la contractualisation de certaines mesures apparaît essentielle. C’est le cas de certaines mesures 2 Cours de l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées Année 2010 - 2011 d’incitation par lesquelles l’administration accorde des avantages fiscaux ou financiers à des entreprises qui s’engagent à mener une action conforme aux objectifs du gouvernement. Dans cette hypothèse, il semble qu’il s’agisse bien de véritables contrats dans la mesure où, en contrepartie de l’avantage alloué, l’entreprise prend un engagement ferme et précis qui en est la condition. Si cet engagement n’est pas respecté, des sanctions contractuelles pourront être infligées et le contrat lui-même résilié (V. concl. Braibant G. sous CE, 2 mars 1973, Syndicat national du commerce en gros des équipements, pièces pour véhicules et outillages, AJDA, 1973, p. 323). La création d’obligations juridiques est une exigence qui permet de distinguer le contrat des actions concertées, lesquelles reposent seulement sur la discussion, la négociation et le rapprochement des partenaires. Cette condition permet également d’écarter de la sphère contractuelle « les simples déclarations d’intention, les actes de courtoisie ou de complaisance ». Ces accords de volontés n’obligent pas juridiquement parce que les intéressés n’ont pas voulu établir entre eux un rapport juridique permettant d’exiger l’exécution d’une obligation. De tels accords n’ont qu’une valeur morale ou politique (par exemple, les actes par lesquels l’Etat et des syndicats envisagent l’avenir d’une entreprise en difficulté ou de mettre fin à un conflit social). B- Le contrat est un accord de volontés La régularité d’un contrat suppose avant tout l’existence d’une volonté de contracter, c’est-à-dire l’existence d’un consentement des parties. S’il fait défaut, un lien contractuel ne peut être établi. Cela suppose un consentement libre et éclairé. Le fait qu’il ait été donné par erreur ou extorqué par dol ou violence (pour une clause ou pour l’ensemble du contrat) emporte nullité des dispositions affectées par le vice. Pour qu’un contrat soit considéré comme conclu, il est nécessaire qu’il y ait accord des parties sur les éléments essentiels dudit contrat (comme par exemple, un accord sur le prix des prestations : CE, 20 mars 1987, Société des Etablissements Louis Mehault c/ Commune de Guer, RDP, 1988, p. 1415). Le contrat doit permettre l’existence d’un accord entre des volontés distinctes, qui expriment un échange de consentements et non leur simple juxtaposition. 3 Cours de l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées Année 2010 - 2011 § 2 : Les éléments distinctifs On s’attachera ici à distinguer le contrat de l’acte unilatéral d’une part, et des actions concertées d’autre part. A- La distinction entre l’unilatéral et le contractuel Le professeur Truchet a souligné que « la volonté de l’administration de mettre un gant de velours à sa main de fer fait que l’on s’y retrouve mal entre l’unilatéral et le contractuel » (TRUCHET D., Le contrat administratif, qualification juridique d’un accord de volontés, in Le droit contemporain des contrats, Economica, 1987, p. 158). Un acte juridique unilatéral est une manifestation de volonté émanant d’un individu qui entend créer certains effets de droit sans secours d’une autre volonté. Au regard de cette définition, la distinction entre l’unilatéral et le contractuel semble évidente : le contrat suppose régir les relations réciproques de ses auteurs alors que l’acte unilatéral confère des droits ou impose des obligations à des tiers (par rapport à son édiction). Mais la pratique se révèle beaucoup plus complexe. En effet, tout acte ressemblant à un contrat n’en constitue pas forcément un, et il existe souvent quelques difficultés à procéder à cette identification alors que celle-ci s’avère nécessaire. En premier lieu, on constate que le choix entre l’acte unilatéral et le contrat n’est pas toujours libre. En effet, en dépit du principe de liberté contractuelle qui permet à l’administration d’opter pour la démarche contractuelle au détriment du procédé unilatéral, il est des hypothèses dans lesquelles l’administration n’est pas libre de donner à son action la forme qu’elle désire. Ainsi, il existe des hypothèses où le recours au procédé contractuel est nécessaire et indispensable. C’est le cas lorsque la conclusion d’un contrat est imposée par l’administration par certains textes : par exemple dans l’hypothèse de contrats d’assurance (Art. L. 1142-2 du Code de la santé publique sur l’obligation d’assurance des établissements de santé). 4 Cours de l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées Année 2010 - 2011 A l’inverse, le recours au contrat peut être proscrit. C’est le cas lorsque des textes imposant l’édiction de réglementations dans un domaine spécifié. Sur ce fondement, le Conseil d’Etat a déclaré nulle une convention destinée à satisfaire les objectifs de la police des installations classées pour la protection de l’environnement (CE, 8 mars 1985, Association Les Amis de la Terre, AJDA, 1985, p. 382, obs. MOREAU J. ; RFDA, 1985, p. 363, concl. JEANNENEY P- A.). De façon plus générale, pour réaliser certaines opérations, l’autorité administrative ne peut parfois agir que par la voie de l’action unilatérale et ce, en raison de la nature de la compétence qui lui a été conférée. C’est ainsi qu’il est fait interdiction à l’autorité de police d’user du procédé contractuel dès lors que l’autorité signataire n’a pas reçu compétence pour signer le contrat (CE, 23 mai 1958, Consorts Amoudruz, AJDA, 1958, p. 309). En second lieu, les effets juridiques attachés à l’acte unilatéral et au contrat doivent être différenciés. Certains effets ne s’attachent qu’aux contrats. Ceux-ci lient les parties qui les ont signés et tiennent lieu de loi entre elles (force obligatoire du contrat). En conséquence, le juge est lié par leurs dispositions et doit les interpréter suivant la commune intention des parties. En outre, le principe de l’effet relatif domine la matière contractuelle. Cela a pour conséquence que les contrats ne valent qu’entre les cocontractants et n’engagent pas, sauf cas particuliers, les tiers. Eu égard ces différents éléments, se pose donc la question de savoir s’il s’agit bien de la conclusion d’un véritable contrat. On observe, tout d’abord, la proximité de l’acte unilatéral et du contrat dans la mesure où certains actes unilatéraux interviennent dans la périphérie du contrat (actes détachables). Ensuite, on constate que l’acte unilatéral s’immisce dans les clauses uploads/S4/ reprise-cours-seance-1-yrg.pdf
Documents similaires

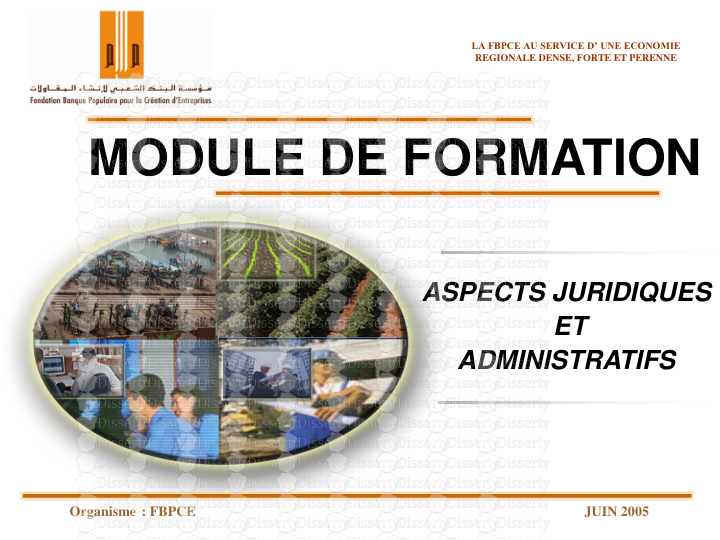








-
48
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 28, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.2104MB


