3- ÉLÉMENTS DE BASE SUR LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE Qu'est-ce que le dro
3- ÉLÉMENTS DE BASE SUR LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE Qu'est-ce que le droit international humanitaire? Part importante du droit international public , le droit international humanitaire (ou droit humanitaire) est l'ensemble des règles qui, en temps de conflit armé, visent, d'une part, à protéger les personnes qui ne participent pas ou ne participent plus aux hostilités et, d'autre part, à limiter les méthodes et moyens de faire la guerre. Plus exactement, par droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, le CICR entend les règles internationales, d'origine conventionnelle ou coutumière, qui sont spécialement destinées à régler les problèmes humanitaires découlant directement des conflits armés, internationaux ou non, et restreignent, pour des raisons humanitaires, le droit des parties au conflit d'utiliser les méthodes et moyens de guerre de leur choix ou protègent les personnes et les biens affectés, ou pouvant être affectés par le conflit. Genève et la Haye Le droit international humanitaire (ci-après DIH), ou droit des conflits armés, ou droit de la guerre (cf. «Terminologie» ci-dessous) comprend deux branches distinctes: - le droit de Genève, ou droit humanitaire proprement dit, qui tend à sauvegarder les militaires hors de combat, ainsi que les personnes qui ne participent pas aux hostilités, en particulier la population civile; - le droit de La Haye, ou droit de la guerre, qui fixe les droits et obligations des belligérants dans la conduite des opérations militaires et limite le choix des moyens de nuire à l'ennemi. Ces deux branches du DIH ne sont toutefois pas totalement séparées dans la mesure où certaines règles du droit de La Haye ont pour effet de protéger les victimes des conflits, et certaines règles du droit de Genève de limiter l'action des belligérants au cours des hostilités. Avec l'adoption des Protocoles additionnels de 1977, dans lesquels ces deux branches du DIH ont été réunies, cette distinction n'a plus, aujourd'hui, qu'une valeur historique et didactique. Qui s'oppose à qui? Le conflit armé international oppose les forces armées d'au moins deux États (à noter que la guerre de libération nationale a été élevée au rang de conflit armé international). Le conflit armé non international oppose, sur le territoire d'un État, les forces armées régulières à des groupes armés identifiables, ou des groupes armés entre eux. Les troubles intérieurs se caractérisent par une profonde perturbation de l'ordre interne résultant d'actes de violence qui ne présentent toutefois pas les particularités d'un conflit armé (émeutes, luttes de factions entre elles ou contre le pouvoir en place...). Grotius et le droit des gens «Droit des gens» est l'expression utilisée par la doctrine classique et qui est synonyme, dans l'usage courant d'aujourd'hui, de celle de «droit international public» ou «droit international». Celui-ci se définit comme l'ensemble des règles juridiques régissant les relations entre les États, ainsi qu'avec les autres sujets de la société internationale. Juriste et diplomate, Grotius (cf. Index) est le père du droit des gens. À la suite de la 1 Réforme qui divisait alors la chrétienté en Europe, il a estimé que le droit n'était plus désormais l'expression de la justice divine, mais celle de la raison humaine, qu'il ne précédait plus l'action, mais en découlait. D'où la nécessité de trouver un autre principe d'unité pour les relations internationales. Le droit des gens fournira ce principe. Dans son ouvrage Droit de la guerre et de la paix, Grotius énumère des règles qui sont parmi les plus solides bases du droit de la guerre. Terminologie Les expressions «droit international humanitaire», «droit des conflits armés» et «droit de la guerre» peuvent être considérées comme équivalentes et le choix de l'une ou de l'autre dépendra essentiellement des habitudes et du public. Ainsi, les organisations internationales, les universités ou encore les États utiliseront plutôt celle de «droit international humanitaire» (ou «droit humanitaire»), tandis qu'au sein des forces armées les deux autres expressions sont plus couramment en usage. Quelle est l'origine du droit humanitaire? Pour répondre à cette question.... d'autres questions. Quel était le droit en vigueur dans les conflits armés avant l'avènement du droit humanitaire contemporain ? Il y a tout d'abord eu des règles non écrites, fondées sur la coutume qui ont réglementé les conflits armés. Puis, progressivement, sont apparus des traités bilatéraux plus ou moins élaborés (des cartels) que les belligérants ratifiaient parfois... après la bataille; il y avait également des règlements que les États édictaient pour leurs troupes (cf. le «Code de Lieber» ci-dessous). Le droit alors applicable dans les conflits armés était donc limité dans le temps et dans l'espace en ce sens qu'il ne valait que pour une bataille ou un conflit précis. Ces règles variaient aussi selon l'époque, le lieu, la morale, les civilisations... Qui sont les précurseurs du droit humanitaire contemporain ? Deux hommes ont joué un rôle essentiel dans sa création: Henry Dunant et Guillaume-Henri Dufour. Dunant en a formulé l'idée dans "Un Souvenir de Solférino", publié en 1862. Quant au général Dufour, fort de ses expériences d'homme de guerre, il lui a apporté très tôt un soutien moral et actif, notamment en présidant la Conférence diplomatique de 1864. Dunant: «Dans des occasions extraordinaires, comme celles qui réunissent (...) des princes de l'art militaire, appartenant à des nationalités différentes, ne serait-il pas à souhaiter qu'ils profitent de cette espèce de congrès pour formuler quelque principe international, conventionnel et sacré, lequel, une fois agréé et ratifié, servirait de base à des Sociétés de secours pour les blessés dans les divers pays de l'Europe?». Dufour (à Dunant): «Il faut que l'on voie par des exemples aussi palpitants que ceux que vous rapportez ce que la gloire des champs de bataille coûte de tortures et de larmes...» Comment l'idée est-elle devenue réalité ? Lorsque le gouvernement suisse, sous l'impulsion des cinq membres fondateurs du CICR, a convoqué en 1864 une conférence diplomatique à laquelle seize États participèrent et adoptèrent la «Convention de Genève pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne». 2 En quoi ce droit innovait-il ? La Convention de Genève de 1864 posait les bases de l'essor du droit humanitaire contemporain. Les principales caractéristiques de ce traité sont notamment: • des normes permanentes, écrites, d'une portée universelle et protégeant les victimes des conflits; • un traité multilatéral, ouvert à l'ensemble des États; • l'obligation de prodiguer des soins sans discrimination aux militaires blessés et malades; • le respect et la signalisation, par un emblème (une croix rouge sur fond blanc), du personnel sanitaire, ainsi que du matériel et des équipements sanitaires. LE DROIT HUMANITAIRE AVANT LA LETTRE Prétendre que la fondation de la Croix-Rouge, en 1863, comme l'adoption de la première Convention de Genève, en 1864, ont marqué le point de départ de tout le processus d'édification du droit international humanitaire tel qu'on le connaît aujourd'hui serait une erreur. En effet, de même qu'il n'y a pas de société, quelle qu'elle soit, sans règles de vie, il n'y a pas eu de guerre sans quelques normes, vagues ou précises, pour présider au déclenchement des hostilités, à leur conduite et à la fin de celles-ci. «Dans l'ensemble, on peut trouver dans les méthodes de guerre des peuples primitifs l'illustration des divers genres de lois internationales de la guerre actuellement connues: lois qui distinguent différentes catégories d'ennemis; règles définissant les circonstances, les formalités et le droit de commencer et de terminer une guerre; règles prescrivant des limites aux personnes, aux saisons, aux lieux, ainsi qu'à la conduite de la guerre; et même des règles qui mettent la guerre hors la loi.» (Quincy Wright). Les premières lois de la guerre ont été proclamées déjà quelques millénaires avant notre ère par les grandes civilisations: «Je prescris ces lois afin d'empêcher que le fort n'opprime le faible.» (Hammourabi, roi de Babylone). Nombre de textes anciens tels le Mahâbhârata, la Bible, le Coran contiennent des règles prônant le respect de l'adversaire. Par exemple, le Viqâyet, texte écrit à l'apogée du règne sarrasin en Espagne, vers la fin du XIIIe siècle, comporte un véritable code des lois de la guerre. La Convention de 1864 codifie donc et renforce, sous la forme d'un traité multilatéral, des lois et coutumes de la guerre, anciennes, fragmentaires et éparses, protégeant les blessés et le personnel soignant (cf. ci-dessous). LE CODE DE LIEBER De l'origine des conflits à l'avènement du droit humanitaire contemporain, on a recensé plus de 500 cartels, codes de conduite, convenants et autres textes dont le but était de réglementer les hostilités. Parmi eux, le Code dit de Lieber ou «Instructions de Lieber». Ce Code, entré en vigueur en avril 1863, est important dans la mesure où il a constitué le premier essai de codification des lois et coutumes de la guerre existant à cette époque. Mais, contrairement à la première Convention de Genève adoptée une année plus tard, ce Code n'avait pas valeur de traité, car il était destiné aux seules forces armées nordistes des États-Unis engagées dans la Guerre de Sécession. De la Seconde Guerre mondiale à la Conférence diplomatique de 1949 par Jean Pictet Dans les années qui précédèrent la conflagration, le CICR, uploads/S4/ elements-de-base-sur-le-droit-humanitaire 1 .pdf
Documents similaires



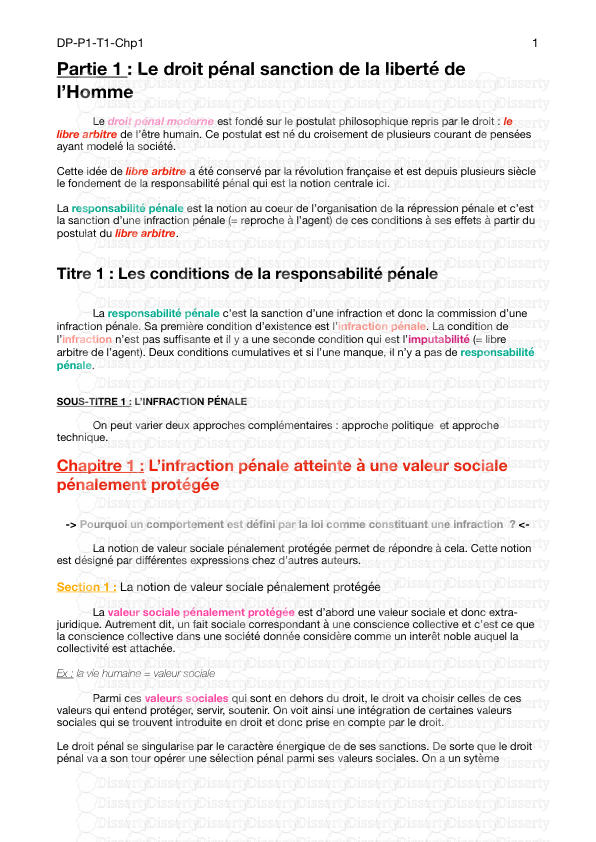






-
68
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 26, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.1717MB


