Exploration hémodynamique et angiographie cardiaque F Fernandez A Lafont C Guér
Exploration hémodynamique et angiographie cardiaque F Fernandez A Lafont C Guérot R é s u m é. – Le cathétérisme et l’angiographie cardiaques permettent, grâce à l’emploi de moyens adéquats : la mesure des pressions existant tant dans les différentes cavités du cœur, oreillettes et ventricules droits et gauches, que dans les gros vaisseaux qui lui sont proches, aorte, veines caves, artère pulmonaire (AP) et ses branches ; le calcul des débits et des résistances qui s’opposent au flux sanguin dans le système vasculaire, résistances proprement dites, estimées comme le rapport des pressions sur les débits et résistances qui résultent de la distensibilité vasculaire (élastance artérielle) ; le diagnostic et la quantification des insuffisances et des rétrécissements valvulaires ; l’étude morphologique des cavités cardiaques et des vaisseaux ; la détection et la quantification des courts-circuits anormaux ; l’évaluation de la fonction cardiaque, systolique et diastolique (fonction pompe, contractilité, qualité de la relaxation et distensibilité ventriculaire) et enfin d’analyser la réponse à certains stimuli, épreuves d’effort, pharmacodynamiques ou autres. Elles conduisent ainsi à établir un diagnostic et une évaluation correcte d’un grand nombre de cardiopathies. Mais ces deux techniques permettent aussi (sujets qui ne seront pas développés ici) l’étude du métabolisme myocardique, le prélèvement de biopsies myocardiques ventriculaires (droites ou gauches), la réalisation de valvuloplasties, l’artériographie et l’angioplastie coronaires ainsi que l’étude et parfois le traitement de certains troubles du rythme. Les progrès réalisés par l’imagerie cardiaque non invasive, échocardiographie, scintigraphie, épreuves d’effort et autres, ont limité considérablement les indications des explorations invasives. Mais les connaissances exposées ici sont importantes pour la cardiologie. Seront discutés successivement les indications actuelles de ces deux techniques, les voies d’abord, les incidents et accidents, le choix des sondes, les renseignements fournis par le trajet des cathéters et par l’enregistrement des pressions, leurs caractéristiques normales et pathologiques, l’étude du cycle cardiaque, les méthodes de mesure du débit cardiaque et de reconnaissance des courts-circuits, le calcul des surfaces valvulaires et des résistances, ainsi que, dans un deuxième temps, les systèmes radiologiques, la nature des rayons X, les substances de contraste, les incidences, les méthodes de calcul des volumes cavitaires et d’analyse de la cinétique ventriculaire gauche et le diagnostic des cardiopathies sur les cinéangiographies. Cathétérisme et angiocardiographie Le cathétérisme cardiaque consiste dans le passage d’une sonde (tige, creuse ou pleine), dans les cavités cardiaques et les vaisseaux proches, dans un but diagnostique ou thérapeutique. L’angiocardiographie enregistre sur un dispositif adéquat les images obtenues au cours de l’injection, à travers une sonde, d’un produit de contraste, opaque aux rayons X, dans un endroit choisi du système circulatoire, afin d’établir un diagnostic. Ces deux techniques, introduites dans la médecine il y a près de 50 ans, ont été à l’origine du développement de la cardiologie. Elles permettent : Francisco Fernandez : Praticien hospitalier. Antoine Lafont : Praticien hospitalier universitaire. Claude Guérot : Professeur des Universités, médecin des Hôpitaux, chef de service. Service de cardiologie, hôpital Boucicaut, 78, rue de la Convention, 75730 Paris cedex 15, France. Toute référence à cet article doit porter la mention : Fernandez F, Lafont A et Guérot C. Exploration hémodynamique et angiographie cardiaque. Encycl Méd Chir (Elsevier, Paris), Cardiologie-Angéiologie, 11-002-A-30, 1998, 18 p. – la mesure des pressions et des débits ; – la quantification des résistances du système vasculaire, des insuffisances et des rétrécissements valvulaires ; – l’étude morphologique et fonctionnelle des cavités cardiaques, particulièrement du ventricule gauche, de l’aorte et des artères pulmonaires ; – la détection des communications et courts-circuits anormaux ; – la quantification de ces shunts ; – l’étude de la fonction cardiaque, systolique et diastolique ; – l’étude du métabolisme myocardique ; – le prélèvement de biopsies myocardiques, pour examen histologique ; – le traitement de certaines cardiopathies. Entre 1945 et 1975, ces deux procédés ont occupé une place privilégiée dans la cardiologie ; ils ont été la pierre de touche des autres techniques et permis le progrès de la chirurgie et l’approfondissement de nos connaissances. Depuis, le développement extraordinaire des capacités diagnostiques de l’échocardiographie et d’autres moyens non invasifs, l’explosion de l’informatique, la disparition quasi totale des cardiopathies congénitales et rhumatismales des services de cardiologie d’adultes, le changement des modes de vie et des conditions sociales, le vieillissement de la population, et l’augmentation, probablement réelle, des maladies par athérosclérose et des possibilités de traitement interventionnel (c’est-à-dire énergique, par action 11-002-A-30 ENCYCLOPÉDIE MÉDICO-CHIRURGICALE 11-002-A-30 © Elsevier, Paris mécanique sur une partie du corps en vue de la modifier) par voie percutanée transluminale, des lésions des artères coronaires, ont abouti à ce que ce soit surtout des patients souffrant d’une insuffisance coronaire qui occupent actuellement les services de cardiologie. Le nombre de cathétérismes effectués pour évaluer l’importance d’une valvulopathie, le stade évolutif d’une cardiomyopathie, la réponse à un traitement ou autre est aujourd’hui restreint. Il est habituel de nommer cathétérisme, ou cathétérisme droit, l’exploration des cavités droites du cœur, oreillette et ventricule droits, AP et ses branches et de faire référence à l’exploration du cœur gauche sous les dénominations de cathétérisme gauche ; le terme angiographie sous-entendant l’opacification sélective d’une cavité déterminée, oreillette ou ventricule droits, AP, oreillette ou ventricule gauches ou aorte sus-sigmoïdienne. Indications et contre-indications de l’exploration hémodynamique et angiographique Le besoin d’effectuer une exploration hémodynamique et angiocardiographique pour établir le diagnostic ou évaluer l’importance d’une cardiopathie est devenu aujourd’hui un fait rare. Dans la plupart des cas, les méthodes non invasives ont largement remplacé ces deux techniques sanglantes. Il en reste toutefois, à notre avis, un certain nombre d’indications : – les cardiopathies valvulaires dont l’estimation est difficile, sténoses ou insuffisances mitrales, aortiques, tricuspides ou pulmonaires, ainsi que les cardiopathies valvulaires complexes, mitroaortiques et mitrotricuspidiennes. La plupart des cardiopathies congénitales entrent dans ce cadre ; – les myocardiopathies primitives ou secondaires, très souvent moins dans un but diagnostique que pour faire une évaluation et choisir un traitement ; – les rétrécissements mitraux, afin d’effectuer une valvuloplastie mitrale percutanée. Le cathétérisme cardiaque est par ailleurs nécessaire : – pour la surveillance des paramètres hémodynamiques dans les unités de soins intensifs ; pour l’évaluation des effets thérapeutiques d’une drogue ou d’une intervention ; – pour obtenir des biopsies endomyocardiques afin de faire un diagnostic étiologique ou dans le cadre du dépistage d’un rejet d’une greffe cardiaque ; – pour le diagnostic des embolies pulmonaires. L’attitude est diverse en ce qui concerne la convenance ou non de faire un cathétérisme droit chez les patients valvulaires, dont le vice est connu, qui doivent être opérés, et qui sont envoyés pour une artériographie coronaire. Contre-indications Elles sont devenues exceptionnelles. La seule contre-indication absolue serait le refus d’un patient pleinement responsable, ou des personnes le représentant devant la loi. Il existe, en revanche, de nombreuses contre-indications relatives. Si l’exploration n’est pas une urgence, toutes les conditions qui augmentent les risques et qui peuvent être corrigées (fièvre, anémie, intoxication digitalique, insuffisance rénale sévère, taux de prothrombine inférieur à 30 %, troubles du rythme...) sont des contre-indications relatives. L’âge physiologique avancé et les tares viscérales accroissent les risques. L’existence d’extrasystoles ventriculaires ou de lambeaux de tachycardie augmente les probabilités de déclenchement d’une crise de tachycardie ou de fibrillation ventriculaire comme conséquence des excitations mécaniques dues à la sonde. Incidents et accidents Le cathétérisme et l’angiocardiographie s’accompagnent, dans certains cas, d’incidents et d’accidents [17, 25, 47]. Les risques dépendent de la voie d’abord choisie, de la nature de l’exploration, de l’état clinique du patient, du type des lésions et de certains facteurs tels qu’un âge supérieur à 70 ans, une fraction d’éjection inférieure à 30 %, une insuffisance rénale ou respiratoire, un diabète, une hypertension artérielle pulmonaire (HTAP), une sténose du tronc commun de la coronaire gauche et autres. La mort au cours des explorations hémodynamique et angiographique est devenue exceptionnelle. Elle est habituellement la conséquence : – d’un choc cardiogénique consécutif à un infarctus du myocarde, un malaise vagal ou à l’angiographie sélective ventriculaire gauche, chez des patients en situation critique ; – d’un trouble du rythme grave, tachycardie ou fibrillation ventriculaire ou arrêt cardiaque irréversible ; – d’une myocardiographie avec ou sans tamponnade. La perforation du cœur ou des vaisseaux est extrêmement rare, en dehors des tentatives de cathétérisme transseptal et des valvuloplasties percutanées. Les troubles du rythme sont fréquents : extrasystoles auriculaires ou ventriculaires, bradycardies vagales. Les malaises vagaux s’annoncent en général par des bâillements répétés, des sueurs ; le patient devient pâle et se sent angoissé. La bradycardie et l’hypotension suivent. Il faut, dès les premiers symptômes, injecter de l’atropine de 0,5 à 1 mg en intraveineux (IV) et mettre en place une perfusion de soluté à grosses molécules. Les complications cérébrovasculaires dues à des embolies sont aujourd’hui, avec l’emploi systématique des anticoagulants, très rares. Les rétrécissements aortiques calcifiés peuvent être à l’origine d’embolies calcaires. La migration de cristaux de cholestérol, à partir des plaques d’athérosclérose ulcérées, serait relativement fréquente au cours du passage des sondes dans les artères, et des angiographies et angioplasties, surtout chez les sujet âgés [28]. Cependant, les manifestations cliniques de ces embolies, qui peuvent toucher tous uploads/S4/ exploration-hemodynamique-et-angiographie-cardiaque.pdf
Documents similaires






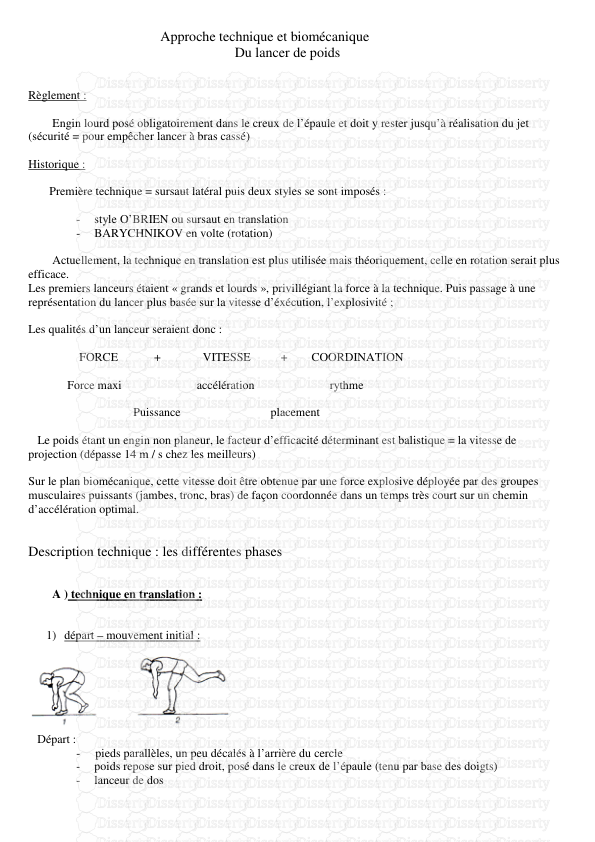



-
45
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 28, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.5064MB


