UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS (PARIS-II) -o-O-o- Première année de Master – M1 – Dr
UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS (PARIS-II) -o-O-o- Première année de Master – M1 – Droit public Année universitaire 2011-2012 -o-O-o- DROIT DES CONTRATS PUBLICS Cours du Professeur Gilles J. GUGLIELMI -o-O-o- DOSSIER DE TRAVAUX DIRIGÉS Second semestre 2011 - 2012 Document élaboré par Gilles Guglielmi et Julien Martin, mis à jour au 1er janv. 2012 Utilisation strictement réservée à l'université Panthéon-Assas 1 TRAVAUX DIRIGÉS MODE D’EMPLOI BUT DES SÉANCES DE TRAVAUX DIRIGÉS : 1°) Préparer les étudiants à l’examen final ; 2°) Tenir compte, dans l’évaluation pédagogique de chaque étudiant, des ses aptitudes, de la régularité et de l’approfondissement de son travail, des progrès qu’il accomplit. En conséquence : Avant de venir en séance, 1. Dotez-vous des connaissances nécessaires - Réunissez les connaissances sur le thème de chaque fiche (cours d’amphithéâtre, manuel) - Comprenez-les - Apprenez-les (en faisant des fiches si nécessaire) 2. Préparez chaque thème de travaux dirigés - Lisez tous les documents (fiche et recueils) - Comprenez-les - Trouvez leur apport dans le thème de droit constitutionnel étudié - Pour les plus importants seulement, faites une fiche 3. Entraînez-vous à l’examen Aux périodes indiquées par vos chargés de travaux dirigés, - Faites des commentaires de décision - Faites des plans détaillés - Faites des cas pratiques - Faites des synthèses de documents MODALITÉS DU CONTRÔLE DES CONNAISSANCES Art. 1er: La présence et la participation aux séances de travaux dirigés sont obligatoires. Art. 2: Le contrôle continu des connaissances est placé sous l’entière responsabilité des chargés de travaux dirigés. Art. 3: La note de contrôle continu est déterminée en fonction de la participation de l’étudiant aux diverses activités individuelles ou collectives, écrites ou orales, organisées dans le cadre de son groupe. Cette notation tient compte des aptitudes manifestées par l’étudiant, des progrès qu’il aura faits, de son assiduité et de sa participation régulière aux séances de travaux dirigés. Art. 4: La note de contrôle continu se compose : 1°) pour un tiers de la note attribuée à une “ étude de cas ” (collectif par équipes de 7 à 8 étudiants). Cette note peut être différenciée en fonction du volume et de la qualité du travail fourni par chacun, et de la difficulté des situations et des objectifs initiaux ; 2°) pour deux-tiers de la note attribuée par le chargé de travaux dirigés à des travaux dont il choisira la nature, en veillant à ce que ces travaux préparent l’étudiant à l’épreuve finale du second semestre et lui donnent l’occasion de pratiquer différents types d’épreuves (dissertation, cas pratique, commentaire de décision, commentaire et synthèse de documents). Art. 5: L’épreuve finale de partiel portera à la fois sur les connaissances exposées en cours magistral et sur les savoir-faire acquis en travaux dirigés, arrêtés à la date de l’épreuve. Elle engagera tant la connaissance des principes fondamentaux de la théorie des contrats, que la maîtrise de l’histoire et de l'analyse des évolutions jurisprudentielles. A l’épreuve finale du second semestre, seul est autorisé le corpus des grandes décisions à condition qu’il soit vierge de toute annotation. 2 Fiche n°1 L’INSTITUTION JURIDIQUE DU CONTRAT BIBLIOGRAPHIE MARTIN (J.), Les sources de droit privé du droit des contrats administratifs, Thèse dactylographiée, Paris II, 2 tomes, 2008. BECHILLON (D. de), « Le contrat comme norme de droit positif », RFDA 1992, p. 15. DRAGO (R.), « La notion d’obligation : droit public et droit privé », APD n° 44, 2000, pp. 46-47. GAUDEMET (Y.), « Prolégomènes pour une théorie des obligations en droit administratif français », in Nonagesimo anno, Mélanges en hommage à Jean GAUDEMET, PUF, 1999, p. 613. « Pour une nouvelle théorie générale du droit des contrats administratifs : mesurer les difficultés d'une entreprise nécessaire », RDP 2010, p. 313. WALINE (M.), « La théorie civile des obligations et la jurisprudence du Conseil d’Etat », in Etudes juridiques offertes à L. JULLIOT DE LA MORANDIÈRE, Dalloz, 1964, pp. 634-645. WALINE (J.), « La théorie générale du contrat en droit civil et en droit administratif », in Etudes offertes à J. GHESTIN, Le contrat au début du 21e siècle, LGDJ, 2001, pp. 978 et s. RÉFÉRENCES ET DOCUMENTS Référence 1 : Conclusions COMBREXELLE (extraits) sur CE 28 juin 1996, Krief, JCP-G 1996, II, 22704 Référence 2 : CE, 19 décembre 2007, Sté Campenon Bernard et a., RDP 2008, p. 1159, concl. N. BOULOUIS, note S. BRACONNIER, JCP, éd. G, 2008.II.10113, note J. MARTIN, RJEP mai 2008, p. 16, note P. TERNEYRE et J. GOURDOU, AJDA 2008, p. 814, note J.-D. DREYFUS Référence 3 : CAA Paris, 14 octobre 2008, Fonds de développement des archipels et Société EMGT, sera mentionné aux Tables du Lebon Référence 4 : CE, 29 décembre 2008, OPHLM de Puteaux, BJCP 2009, p. 123, concl. B. DACOSTA, AJDA 2009, p. 268, note J.-D. DREYFUS Référence 5 : CE, 7 avril 2011, Société Ajaccio diesel, AJDA 2011, pp. 1928, note J. MARTIN Référence 6 : Questions à Frédéric TIBERGHIEN, conseiller d’Etat, «Il faut un code de la commande publique pour assurer sa sécurité juridique», AJDA 2008, p. 1228 DÉCISIONS DU CORPUS CC, 26 juin 2003, Loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit CE, Ass., 29 avril 1981, Ordre des architectes CE, Section, 11 juillet 2001, Société des eaux du Nord, CE, 23 février 2005, Association pour la transparence et la moralité des marchés publics, CE, 26 septembre 2007, Office public départemental des habitations à loyer modéré du Gard, CE, 15 février 2008, Commune de La Londe-les-Maures, EXERCICES SUGGÉRÉS : Compositions écrites, exposés oraux, plans détaillés, fiches techniques : - Le contrat administratif et la loi - Le Code civil et le contrat administratif Épreuve pratique : Commentaire de document 3 Référence 1 : Conclusions COMBREXELLE (extraits) sur CE 28 juin 1996, Krief, JCP-G 1996, II, 22704 - A - «Les nations ont un droit public avant que d’avoir des lois civiles » déclarait Portalis en présentant le projet de Code civil devant le corps législatif et de montrer que le futur Code civil, en ce qu’il était destiné à mettre fin à la diversité des lois et coutumes propres à différentes parties du territoire national instituait un ordre civil venant cimenter l’ordre politique ». Si historiquement le Code civil est ainsi avant tout l’expression d’un acte de puissance publique, son champ d’application reste en principe cantonné aux relations de droit privé et ne s’applique pas aux relations entre la puissance publique et les personnes privées. C’est, faut-il le rappeler, ce qu’allait confirmer avec éclat le 8 février 1873, le Tribunal des conflits dans son arrêt Blanco dont le considérant constitue l’acte fondateur du droit administratif: «La responsabilité, qui peut incomber à l’Etat..., ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil ; pour les rapports de particulier à particulier; que cette responsabilité n’est ni générale ni absolue; qu’elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l’État avec les droits privés ». Tout avait été dit à l’occasion de l’accident dont avait été victime la petite Agnès Blanco et nous avons dès lors quelque scrupule à conclure devant votre section sur une question qui porte sur l’application d’une disposition du Code civil en droit administratif. La difficulté vient de ce que, comme le relèvent les auteurs des « Grands arrêts de la jurisprudence administrative » (p. 7), la liaison entre la compétence juridictionnelle et le fond du droit qu’institue cet arrêt n’est pas absolue. - B - S’agissant du juge judiciaire, celui-ci n’hésite pas lorsqu’il est confronté à des situations proches de celles qui par nature se rattachent au droit administratif à faire application des concepts dégagés par le juge administratif. L’arrêt de la Cour de cassation Giry en date du 23 novembre 1956 (Bull. civ. Il, p. 407), est une illustration marquante de ce type de raisonnement en matière de régime de responsabilité applicable aux collaborateurs occasionnels du service public de la justice. De façon plus récente et plus caractéristique encore, le développement de ce que nous serions tentés d’appeler des « prérogatives de puissance privée » dans le droit des affaires et notamment dans le droit des sociétés conduit le juge judiciaire à appliquer des techniques proches de celles du juge de l’excès de pouvoir (Charnpaud, Droit administratif et droit des affaires: AJDA n° spéc. juin 1995, p. 82). - C - De même, toute référence au droit civil n’est pas, par nature, exclue devant le juge administratif. En premier lieu, les situations visées par le droit administratif ne sont pas pour la plupart des situations de pur droit administratif qui se définiraient exclusivement par des concepts propres à ce droit. Les textes applicables visent, à titre d’exemples, des personnes physiques majeures ou mineures, des sociétés et des associations, des propriétaires et des locataires, des héritiers et des légataires, des salariés et des employeurs, des immeubles et des meubles qui se définissent par rapport au droit privé. Pour prendre un exemple récent de la nécessaire prise en compte de situations régies par le droit civil dans l’action uploads/S4/ fiches-td-droit-des-contrats-publics-2012.pdf
Documents similaires

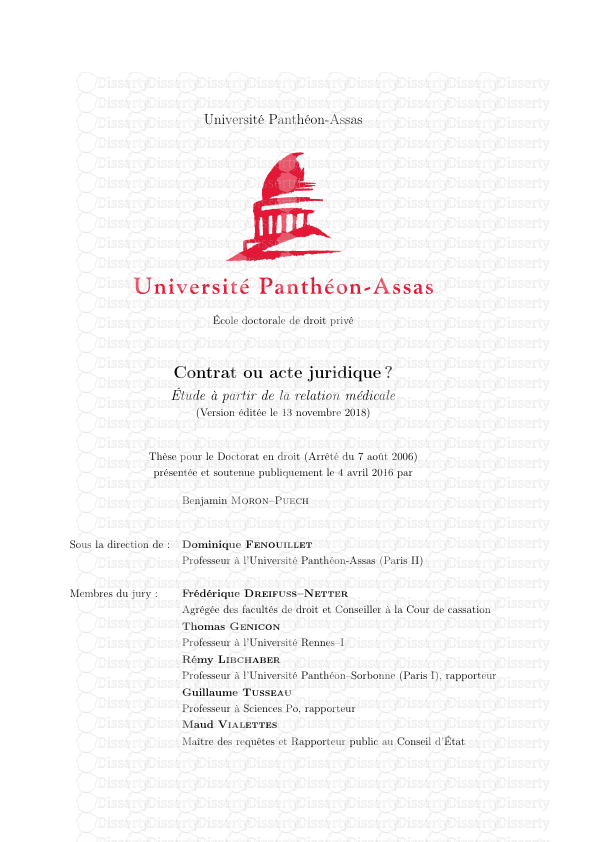








-
61
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 24, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 1.0437MB


