INTRODUCTION au DROIT Chapitre introductif: qu’est-ce que le droit ? Section 1:
INTRODUCTION au DROIT Chapitre introductif: qu’est-ce que le droit ? Section 1: le droit comme norme sociale 1. Polysémie du droit comme phénomène social Le droit renvoie à l’existence d’une organisation de l’activité de l’homme dans la société. On voit qu’il y a deux significations : Le droit comme règle: droit objectif : Le droit comme prérogative: droit subjectif A. Le droit comme règle social: le droit objectif Le droit est l’ensemble de règles de conduite édictées par une société à un moment donne et ayant pour but d’organiser les rapports entre les hommes. Le droit est perçu de manière objective, c’est-à-dire qu’on met l’attention sur la norme posée par des organes compétents. B. Le droit comme prérogative: les droits subjectifs Les droits subjectifs sont les prérogatives que le droit objectif reconnait à un individu ou un groupe d’individus en considération de leurs intérêts spécifiques. L’attention porte ici sur le sujet de droit et non pas sur le système dans son ensemble. Ex : le droit de propriété, le droit de respect à la vie privée, les droits de créance. Ils sont tous reconnus par le système (le législateur) au regard de l’intérêt des membres. Le langage commun : « j’ai le droit » - incarnation de la notion du droit subjectif Tous les droits subjectifs trouvent un ancrage dans le droit objectif mais le droit objectif ne se limite pas à l’énonciation et à la consécration des droits subjectifs. 2. Caractères de la règle du droit Une règle de droit est aussi une norme juridiquement obligatoire (normalement assortie de la contrainte étatique) quelque soit sa source (règle légale ou coutumière), son degré de généralité (règle générale ou spéciale) ou sa portée (règle absolue, rigide ou souple). La règle de droit présente 4 caractères: A. Caractère obligatoire Une règle de droit est avant tout une prescription, un ordre, un commandement, qu’il s’agisse de poser des barrières ou, au contraire, de définir et défendre des espaces de liberté. Comme le disait Portalis : « La loi permet ou elle défend. Elle ordonne, elle établit, elle corrige, elle punit ou elle récompense ». La loi peut poser un impératif ou laisser un choix au sujet de droit. Lorsqu’elle lais un choix, on parlera de loi supplétive; il y a toujours un caractère obligatoire. Le caractère obligatoire est en relation avec la sanction étatique. B. Caractère abstrait La règle de droit est abstraite a deux titres : Tout d’abord son objet est général, mai aussi la loi est impersonnelle, quant aux sujet a qu’elle s’applique Un objet est général: la règle concerne un nombre indéterminé d’actes ou de faits désignés de manière abstraite. Par exemple la prohibition du vol – la loi définit le vol comme la soustraction frauduleuse (intentionnelle) de la chose d’autrui. On définit un comportement de manière abstraite, on ne connait pas si pendant l’année il y aura un seul vol ou plusieurs. On donne des éléments abstraits qui peuvent se rattacher à la notion. C’est par le caractère abstrait de l’objet qu’on arrive à régler la société. la loi est impersonnelle quant au sujet auquel elle s’applique. La loi s’adresse à tous sans viser quelqu’un en particulier. Tous les sujets de droit peuvent se prévaloir leur droit de propriété, le droit au respect de leurs vies privées. C. Caractère extérieur La règle de droit est le produit de la société dans son ensemble et non pas simplement d’un individu ou d’un groupe d’individus dans un souci démocratique et il ne faut pas que les individus soit en position par leur seule volonté de se construire leur propre norme et de les imposer aux autres. D. Sanction étatique Il s’agit du caractère le plus spécifique de la règle de droit. Une règle de droit est une injonction formulée par une autorité compétente. Lorsqu’elle n’est pas respectée, elle donne lieu à une sanction par l’Etat. Que faut-il entendre par « sanction » lorsque le droit n’est pas respecté ? Il ne faut pas comprendre le terme d’une manière étroite. Il peut s’agir d’autre chose. La notion de sanction, utilisée dans ce contexte, renvoie de manière générale a la possibilité d’obtenir de la part d’une autorité de l’Etat (en général le juge) de prononcer une mesure destinée a assurer le respect et l’exécution de la règle de droit. Cette sanction est plutôt comment faire respecter le droit. Il y a plusieurs types de sanctions envisageables. Mais cette mesure n’est pas forcément une punition du fautif, d’autres sanctions peuvent être envisagées : On peut faire exécuter la règle de droit malgré la volonté contraire de la personne qui la méconnait. Ainsi, un créancier peut recourir à un huissier pour faire saisir les biens de son débiteur refusant de le rembourser. Une troisième catégorie de sanction est la réparation (art. 1382 C.civ.). Lorsqu’un contrat poursuit un but illicite (par ex un contrat qui a pour but d’organiser la vente de drogues) il peut être annulé par le juge. L’annulation fait disparaitre le contrat illégal. La nullité de l’acte illicite est une forme de réparation. Un autre mode de réparation est l’indemnisation. Elle consiste dans l’indemnisation d’une victime d’un dommage en demandant aux responsables de celui-ci de verser des dommages et intérêts. Formes de sanction: La punition L’exécution forcé La réparation – la nullité de l’acte illicite = sorte de réparation - l’indemnisation = sorte de réparation très fréquent Lorsqu’un contracte poursuit un but illicite il peut être annulé. L’annulation c’est une forme de réparation. 3. Distinction de la règle de droit et des autres normes sociales A. Droit et morale Toutes les règles de comportement ne sont pas des règles juridiques. La morale est une autre règle de comportement. 1. Nature des similitudes et divergences La morale est la science du bien et du mal. C’est l’ensemble de règles de conduite considérées par un sujet ou par un groupe donné comme bonne de manière absolue. La morale est considérée comme une norme obligatoire pour ceux qui la retiennent ou pour ceux qui l’adoptent. La morale est une règle de comportement à la fois sociale et intime. C’est un principe abstrait qui va conduire le sujet à se comporter d’une certaine manière, juste et bonne, dans les différentes situations auxquelles il sera confronté. Cette dimension de règle de comportement social est donc commune au droit et à la morale. Différences : La morale n’a pas pour but d’organiser la société ; c’est juste une définition du bien et du mal, mais cette première différence n’est pas déterminante. Il y a des passerelles. Bien souvent, les règles de morale sont déterminées parce qu’elles permettent une cohabitation pacifique au sein de la communauté. Plus important encore c’est qu’on voit bien que le droit s’inspire de règles morales qui prévalent dans la société à un moment donné. Le droit va parfois transformer certaines règles morales en règles du droit. Le droit va finir par constituer quelques règles de morale. Ex : la loi des 10 commandements – morale + religion ; traduction directe en droit, la classification du crime etc. ; Art. 1382 C.civ. – il y a un fondement moral dans la règle de droit énoncée par l’article en cause, l’obligation de réparer le dommage causé a autrui. Au regarde des objectifs, des finalités et du contenu, la frontière entre droit et morale n’apparait pas imperméable, absolue. Le recours au critère de la nature de la sanction apparait donc nécessaire pour bien distinguer le droit et la morale. La violation de ces règles ne conduit pas à la même sanction. Pour le droit, la sanction est d’origine étatique. Pour la morale, il y a une sanction de nature individuelle ou de nature collective (la réprobation sociale). 2. Pour ou contre une distinction stricte entre droit et morale ? a. Droit naturel : un pont entre droit et morale Le postulat de départ est de se poser la question suivante: qu’est-ce qui se passe si la règle de droit est immorale qui heurte les convictions de la société? Une première réponse conduit à faire un pont entre le droit et la morale. Les théories jusnaturalistes reposent toutes sur l’idée que certains principes existent dans la nature et doivent aider à élaborer le droit positif. Suivant ces théories, le droit positif ne serait valable qu’à condition d’être conforme aux principes naturels. On peut distinguer 3 périodes dans le jusnaturalisme: Les anciens Le droit naturel des anciens (essentiellement de la Grèce antique) reposait sur la recherche de l’ordre du monde. Les grecs considéraient que pour connaitre le monde, il faut l’observer. Aristote a déduit de l’observation du Cosmos la nécessité de mettre en place une système aristocratique et donc hiérarchiser la société – une vision holiste. Aristote a déduit de l’observation des astres que ceux-ci étaient plus ou moins importants et se trouvaient dans une relation de dépendance. La cité grecque doit être le reflet de cet ordre du monde, de cette hiérarchie (astres mineurs, astres majeurs) selon la qualité de l’âme. Cette observation du uploads/S4/ introduction-au-droit 3 .pdf
Documents similaires
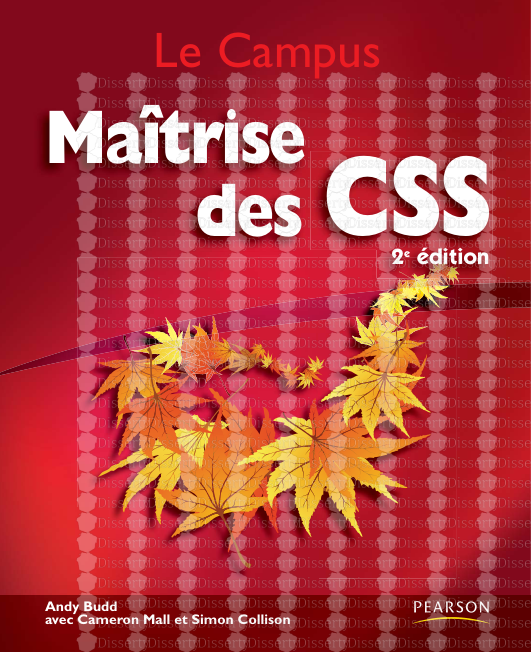









-
81
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 25, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.2825MB


