LA LANGUE DU DROIT DANS LE THÉATRE DE MOLIÈRE Author(s): Eugène Paringault Sour
LA LANGUE DU DROIT DANS LE THÉATRE DE MOLIÈRE Author(s): Eugène Paringault Source: Revue historique de droit français et étranger (1855-1869) , 1861, Vol. 7 (1861), pp. 309-357 Published by: Editions Dalloz Stable URL: https://www.jstor.org/stable/43840459 JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org. Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at https://about.jstor.org/terms is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Revue historique de droit français et étranger (1855-1869) This content downloaded from ������������197.29.181.169 on Wed, 19 Oct 2022 16:45:19 UTC������������� All use subject to https://about.jstor.org/terms LA LANGUE DU DROIT DANS LE THEATRE DE MOLIÈRE. i Molière, suivant l'expression qu'on lui prête à lui-même, prenait son bien partout où il le trouvait. S'il n'était pas de bou- quin qui se sauvât de ses mains •, tant il était fureteur de sa nature, il n'était pas non plus de ridicule qui échappât à son observation. Selon la tradition, lorsqu'il fut invité à réparer une omission qu'on lui signalait dans sa comédie des Fâcheux , représentée chez le favori Fouquet le 17 août 1661, il s'adressa au grand veneur, M. de Soyecourt, qui l'initia au dictionnaire des termes de la vénerie et des chasses, et à quelques jours de là une nouvelle scène des plus divertissantes, pleine d'un comique tout en action, quoiqu'il s'agisse d'une pièce à tiroir, était cou- sue à la comédie primitive, à la grande satisfaction de ceux qui assistaient à la seconde représentation, qui eut lieu à Fontaine- bleau le 27 du même mois. M. de Soyecourt lui-même, peint au vif dans cette galerie d'originaux, S'y vit avec plaisir, ou crut ne s'y point voir. (Boilbau, Art poétique , ch. Ill, vers 354.) Outre ce collaborateur qui avait dû l'être sans le savoir, Mo- lière en compta, pour ce rôle, un plus illustre. Après avoir as- sisté à la première représentation de la pièce, Louis XIV avait dit à l'auteur, en voyant passer son veneur : Voilà un grand original que vous n'avez point encore copié 2. C'est donc avec rai- son que, dans son épître dédicatoire des Fâcheux, l'auteur a dit, 1 C'est ce que reconnaît un de ses adversaires qui, dans la comédie de Zélinde (acte Ir se. vu), dit : « Pour réussir, il faul prendre la manière de Molière, lire tous les livres satiriques, prendre dans l'italien et lire tous les vieux bouquins ; il faut avouer que c'est un galant homme, et qu'il est louable de savoir se servir de tout ce qu'il lit de bon. » * Histoire dela vie et des ouvrages de Molière , par J. Taschereau, édition de 1844, p. 40. This content downloaded from ������������197.29.181.169 on Wed, 19 Oct 2022 16:45:19 UTC������������� All use subject to https://about.jstor.org/terms 310 LA LANGUE DU DROIT de ce complément de sa pièce, que le roi avait eu la lui en ouvrir les idées ł. Mauvillain, ce médecin qui ordonnait à Molière des r que celui-ci ne faisait pas 2, et qui resta l'ami de l'a mique, malgré la guerre déclarée par ce dernier à la m Mauvillain fit même plus; médecin sans préjugés, il f de la Faculté, l'âme damnée qui fournissait à Molière s de médecine. Pour le droit, on n'indique personne qui en ait soufflé la langue à Molière. Sa puissance ordinaire d'assimilation ne nous paraît pas avoir suffi pour lui tenir lieu à cet égard de tout se- cours étranger ; on trébuche à chaque pas, en effet, lorsqu'on veut parler cet idiome sans l'avoir étudié; or, Molière, nous le démontrerons au cours de ce travail, marche d'un pas ferme sur ce terrain comme sur tous les autres. Nous ne croyons pas le gentilhomme de Limoges quand il veut nous persuader qu'il parle la langue du droit sans l'avoir apprise 3, à l'imitation du pseudo-gentilhomme Jourdain qui, lui, faisait depuis plus de quarante ans de la prose sans s'en douter, ou chantait bien sans avoir appris la musique 4.AM. de Pourceaugnac annonçant que « ces mots-là me viennent sans que je les sache, » Molière s'est chargé de répondre par la bou- che de Sbrigani qui lui dit : « Il me semble que le sens com- mun d'un gentilhomme peut bien aller à concevoir ce qui est du droit et de l'ordre de la justice, mais non pas à savoir les vrais termes de la chicane5. » Ce qui est vrai de Pourceaugnac l'est de tout homme qui a à faire usage des mots de la procé- dure. Nous croyons donc qu'ici Molière avait ses ressources en lui-même et cela seul nous inspire un préjugé favorable à l'opi- 1 Voir la Dédicace au roi en lète de la comédie des Fâcheux . 2 « Toul le monde sait qu'étant un jour au dîner du roi : « Vous avez un médecin, dit le roi à Molière, que vous fait-il? - Sire, répondit Molière, nous causons ensemble, il m'ordonne des remèdes, je ne les fais point et je guéris. » ( Vie de Molière , par Voltaire.) - Voir aussi p. xlix des Mémoires sur la vie et les ouvrages de Molière , par de La Serre, mis en tête de l'édi- tion in-4 des œuvres de Molière, de 173i. 5 Pourceaugnac^ acte II, se. xii. * Le Bourgeois gentilhomme , acte II, sc. vi, et acte I, se. u. * Voir la comédie de Pourceaugnac , à la scène citée plus haut. This content downloaded from ������������197.29.181.169 on Wed, 19 Oct 2022 16:45:19 UTC������������� All use subject to https://about.jstor.org/terms DANS LE THÉÂTRE 1)E MOLIERE. 311 nion de ceux qui veulent que Molière ait étudié en dfoit. Cettè question, dont il faut dire ici un toot, a été fort débattue entre ses biographes, et au résumé on est aujourd'hui encore réduit, là-dessus, à des conjectures Comme il existe une lacune de trois ans environ dans la vie de Molière, on est amené à supposer que, comme plusieurs fils de la bourgeoisie et du commerce aisé d'alors, Molière a fait son droit, à l'étude duquel on assigne le temps écoulé de 1642 à 1645. En outre, comme le rétablissement de l'enseignement du droit civil n'avait pas encore eu lieu à Paris, c'est à l'école de droit la plus rapprochée de la capitale, à celle d'Orléans 2, que ceux des biographes de Molière qui admettent qu'il a étudié en droit ont, de leur autorité privée, envoyé le jeune Poquelin pour y prendre ses inscriptions et pour y passer ses examens. On n'fi pas d'autre preuve que celle-là relativement au séjour à Orléans. Quant à l'étude du droit elle-même, Grimarest, qui pou- vait puiser ses renseignements près des contemporains, dit que le fait de cette étude lui avait été d'abord absolument contesté 1 Voir line note p. v et vii du tome Ier de la 4e édition des œuvres de Mo- lière, publiée par M. Aimé-Martin; - J. Tascheieau, opere citato, p. 6 et 7; - Grimarest, p. 312; - A. Bazin, Notes historiques sur la vie de Molière , 2e édition, p. 19; - Bayle, Dictionnaire historique et critique, article Po- quelin ; - Mémoires sur la vie et les ouvrages de Molière , p. xviu. 2 L'école d'Orléans était alors très- fréquentée par les disciples de Thé- mis. On y discutait et disputait beaucoup, sans arriver à s'y entendre : de là est venu le proverbe longtemps si connu : C'est la glose ď Orléans, plus obscure ou pire que le texte. - A Paris, du temps de la jeunesse de Mo- lière, et par suite d'un usage remontant à Philippe le Bel, qui l'avait con- sacré législativement en 1312, on n'enseignait que le droit canon, de môme qu'à Orléans on n'enseignait que le droit civil. Celle ligne de démarcation avait été tracée pour éviter toute lutte entre les théologiens et les juris- consultes, qui précédemment avaient cherché réciproquement à s'enlever leurs élèves. Terrasson dit à ce sujet, dans son Histoire de la jurisprudence romaine , p. 442 : « La prudence de nos rois les engagea à ne pas souffrir dans ces lemps-Ià, dans une même ville, les deux écoles.» - C'est seulement six ans après la mort de Molière, et par edit donné à Sainl-Germain en Laye, au mois d'avril 1C579, qu'il fut décrété: « que dorénavant les leçons pu- bliques du droit romain seront rétablies dans l'Université de Paris, con- jointement avec celles du droit canonique, nonobstant l'article 69 de l'or- donnance deBlois.» - Cet article 69 de l'ordonnance de Blois, de mai 1379, était ainsi conçu : « Défendons à ceux de l'Université de Paris de lire ou graduer en droit civil. » This content downloaded from ������������197.29.181.169 on Wed, 19 Oct 2022 16:45:19 UTC������������� All use subject to https://about.jstor.org/terms 312 LA LANGUE uploads/S4/ la-langue-du-droit-dans-le-theatre-de-moliere.pdf
Documents similaires
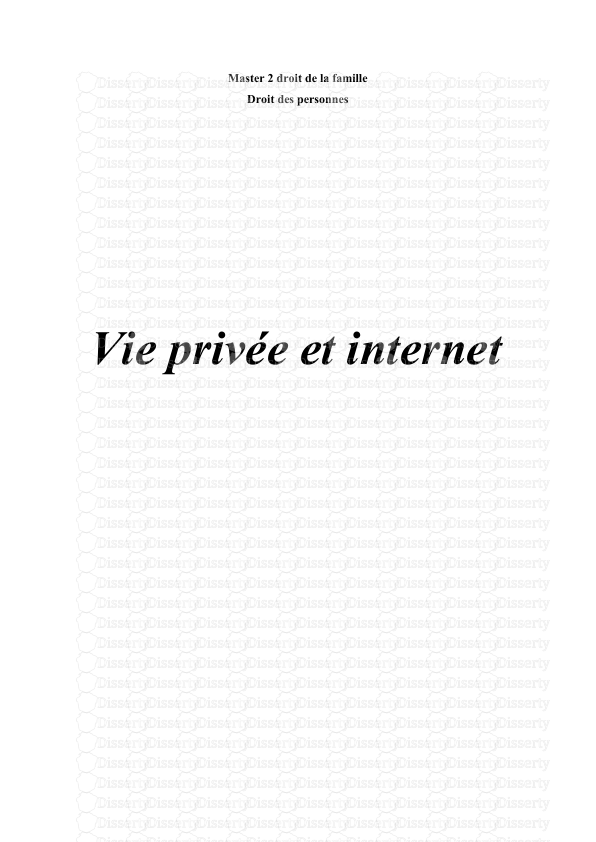









-
102
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 09, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 2.3351MB


