1. Ce texte est issu d'une communication au Colloque de réflexion en droit civi
1. Ce texte est issu d'une communication au Colloque de réflexion en droit civil, La bonne foi : rôle et exigences, tenu à l'Université du Québec à Montréal, le 31 octobre 1996. Pour les fins de sa publication, y ont simplement été ajoutées quelques notes infrapaginales relatives aux sources et à la bibliographie. Nous tenons à remercier les professeurs Paul-André Crépeau et Nicholas Kasirer de la Faculté de droit de l'Université McGill ainsi que Me France Allard du Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec qui ont bien voulu nous livrer leurs observations. 2. Avocate et chercheure au Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec de l'Université McGill. LE RÔLE DE LA BONNE FOI DANS L'ÉLABORATION DE LA THÉORIE DU CONTRAT* par Élise M. CHARPENTIER** SOMMAIRE Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Section I La bonne foi dans l'Antiquité romaine . . . . . . . . . . . . . 302 Paragraphe I La notion de bonne foi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Paragraphe II Le rôle de la bonne foi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Section II La bonne foi dans l'Ancien droit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 Paragraphe I L'apport des philosophes, des théologiens et des canonistes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 Paragraphe II Le rôle de la bonne foi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Le rôle de la bonne foi 300 dans l’élaboration (1996) 26 R.D.U.S. de la théorie du contrat Le rôle de la bonne foi (1996) 26 R.D.U.S. dans l’élaboration 301 de la théorie du contrat 1. Voir Commentaires du ministre de la Justice, t. 1, Québec, Les publications du Québec, 1993, sous l'art. 1375. 2. Le formalisme peut être défini comme une «conception purement formelle de la justice» (voir A.-J. Arnaud dir., Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, Paris-Bruxelles, LGDJ-Story-Scienta, 1988, sous «Formalisme juridique» à la p. 163). C'est bien là ce qui caractérise tant la conception romaine du contrat que celle qui découle de la théorie de l'autonomie de la volonté. Sur le formalisme en matière contractuelle voir J. Flour, «Quelques remarques sur l'évolution du formalisme» dans Mélanges Ripert, t. 2, Paris, L.G.D.J., 1950, 93; Y. Jeanclos, «Formalisme et consensualisme : la sempiternelle querelle Introduction Avec l'adoption des articles 6 et 1375 du Code civil du Québec, la notion de bonne foi devient un objet de réflexion. Pourtant cette notion n'est pas nouvelle, on dit même qu'elle est l'une des notions fondamentales du droit civil.1 Afin d'en cerner le sens et de déterminer le rôle qu'elle peut être appelée à jouer, il nous a semblé qu'un retour historique pourrait s'avérer éclairant. Le rôle de la bonne foi peut être envisagé non seulement de façon immédiate, à l'égard d'un problème juridique particulier, mais également de façon plus globale en abordant son influence sur notre théorie du contrat. L'analyse de la notion de bonne foi dans une perspective historique nous permet de comprendre son rôle, d'abord dans la conceptualisation du contrat tel que nous le concevons aujourd'hui, puis comme élément de relativisation de cette conception du contrat. Il convient d'abord de déterminer les transformations du droit qui ont eu le plus d'influence sur notre théorie du contrat. Chronologiquement, on voit que la bonne foi joua un rôle lors du passage du droit romain archaïque au droit romain classique, qui marque une profonde transformation du droit. Puis, on trouve, dans l'Ancien droit, une théorie du contrat imprégnée par la bonne foi. Ce n'est qu'avec l'individualisme ayant inspiré la théorie de l'autonomie de la volonté et influencé l'interprétation du Code civil que l'importance de la bonne foi diminue. La bonne foi, comme symbole de l'évolution du droit, est particulièrement intéressante lorsqu'elle est mise en rapport avec une conception formelle du contrat,2 ou encore, lorsqu'elle contribue à l'édification d'une théorie Le rôle de la bonne foi 302 dans l’élaboration (1996) 26 R.D.U.S. de la théorie du contrat du droit des contrats» dans Hommages à G. Boulvert, Nice, Service d'édition scientifique - Université de Nice, 1987, 333. du contrat empreinte de relativité. Nous verrons que la bonne foi est la source des principes du droit romain, qui ont contribué à la définition du contrat tel que nous le concevons aujourd'hui (section I), et que la bonne foi a inspiré les grandes règles applicables au contrat qui ont été élaborées dans l'Ancien droit (section II). À partir de ces constats, il est possible de montrer que la bonne foi a contribué à édifier une théorie du contrat remettant en question le formalisme juridique et qu'en articulant la théorie du contrat à partir d'une conception formelle du droit, comme c'est le cas avec l'autonomie de la volonté, on ne laisse que peu de place à la notion de bonne foi. Section I La bonne foi dans l'Antiquité romaine L'évolution du droit romain en matière contractuelle reflète bien l’évolution de la société romaine. D'un droit formaliste dont une société agraire et plutôt fermée pouvait très bien s'accommoder, on est passé à un droit beaucoup plus flexible, mieux adapté à une société où les rapports marchands se multiplient. La transformation du droit contractuel romain coïncide avec la prise en compte par le droit de la notion de bonne foi qui, jusque là, avait plutôt un caractère moral ou religieux. C'est à partir de la notion de bonne foi et des conditions ayant conduit à lui donner un rôle au niveau du droit qu'on peut déterminer son influence à Rome. Délaissant le formalisme, le droit romain a peu à peu reconnu la bonne foi comme source de certaines obligations. Voyons d'abord comment les romains ont conçu la notion de bonne foi, puis quel était le rôle que celle-ci jouait en matière contractuelle. Le rôle de la bonne foi (1996) 26 R.D.U.S. dans l’élaboration 303 de la théorie du contrat 3. J.-A. Hild, «Fides» dans C. Daremberg et E. Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, t. 2, Paris, Hachette, 1896 à la p. 1115, voir aussi, R. Schilling, La religion romaine de Vénus depuis les origines jusqu'à l'époque augustéenne, Paris, De Broccard, 1982 à la p. 53. 4. J.-A. Hild, ibid. à la p. 1147; voir, plus généralement, sur les rapports entre le droit et ses représentations N. Kasirer, «Larger Than Life. A Review Essay of Broken Tablets [:] The Cult of Law in French Art from David to Delacroix by J. Ribner», [1995] C.J.L.S. 185. 5. A. Piganol, «Fides et mains de bronze» dans Droits de l'antiquité et sociologie juridique, Mélanges H. Lévy-Bruhl, Paris, Sirey, 1959, 471 à la p. 473 («[l]e symbole des mains jointes apparaît sur les monnaies romaines l'année même de la mort de César et connaît une vogue singulière durant la guerre civile, pour signifier la Fides»); voir aussi J.-A. Hild, supra note 3 à la p. 1116. 6. J. Imbert, «De la sociologie du droit : la "fides" romaine» dans Droits de l'antiquité et sociologie juridique : Mélanges Henri Lévy-Bruhl, Paris, Sirey, 1959, 407 à la p. 408; voir aussi, R. Von Ihering, L'esprit du droit romain, t. 4, Paris, Marescq, Ainé, 1889 aux pp. 260-261: «La main est la plus importante des parties du corps : elle occupe la première place après l'organe qui doit agir dans tout acte juridique, la langue, et ainsi que nous l'avons fait remarquer plus haut, elle se trouve avec lui dans la plus étroite relation. Si la langue annonce la résolution, la main l'exécute; elle est bien véritablement l'organe de la volonté, et, au point de vue de la conception naturelle et sensible, agir et remuer la main sont une seule et même chose». 7. Voir G. Freyburger, Fides - Étude sémantique et religieuse, Paris, Les Belles Lettres, 1986 aux pp. 230-232. 8. Voir M. Villey, La formation de la pensée juridique moderne : Cours d'histoire de la philosophie du droit, Paris, Montchrétien, 1975 à la p. 66. Paragraphe I La notion de bonne uploads/S4/ le-role-de-la-bonne-foi-dans-l-x27-elaboration-de-la-theorie-du-contrat.pdf
Documents similaires



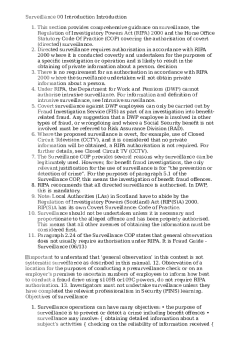






-
61
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 02, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.1747MB


