Lésions acquises de la valve tricuspide P Luxereau R é s u m é. – La pathologie
Lésions acquises de la valve tricuspide P Luxereau R é s u m é. – La pathologie acquise de la tricuspide se différencie des autres valvulopathies par des particularités étiologiques et évolutives : – l’incontinence valvulaire est, de très loin, l’anomalie la plus fréquente. Elle est le plus souvent fonctionnelle, due à la dilatation des cavités cardiaques droites secondaire à l’hypertension pulmonaire, quelle qu’en soit l’origine, en l’absence d’altération anatomique des structures valvulaires. Son évolution dépend de la réversibilité, non seulement de l’hypertension pulmonaire mais aussi de la dysfonction ventriculaire droite ; – les causes organiques sont plus rares. Elles déterminent plus souvent une régurgitation pure ou associée à une sténose modérée qu’un rétrécissement pur et serré. L’endocardite infectieuse du cœur droit augmente de fréquence parallèlement à la progression de la toxicomanie par voie veineuse, tandis que la tricuspidite rhumatismale est devenue très rare ; – le traitement chirurgical de l’insuffisance tricuspidienne (IT) fonctionnelle est conservateur. La plupart des atteintes organiques sont également accessibles à la chirurgie réparatrice et le remplacement valvulaire est de plus en plus rarement utilisé. © 1999, Elsevier, Paris. Valve tricuspide normale L’appareil tricuspidien est un ensemble assez complexe ; le bon fonctionnement de chacun de ses éléments est nécessaire à une fonction valvulaire normale. Anatomie L’orifice proprement dit, situé à la jonction auriculoventriculaire droite, est de forme ovalaire et donne insertion à trois valves : septale, antérieure et postérieure. Le pourtour de l’orifice ou « anneau » tricuspidien est discontinu. Il n’est bordé par une structure fibreuse collagène que dans sa partie septale, contiguë à la valve mitrale, où il s’appuie sur le trigone fibreux droit du cœur, et qui correspond à l’insertion de la valve septale tricuspide et à la commissure entre valve septale et valve antérieure [80]. La plus grande partie de l’anneau, sur laquelle s’insèrent les valves antérieure et postérieure, est constituée de myocarde à la jonction des parois auriculaire et ventriculaire droites et de tissu conjonctif lâche [4]. Les trois valves sont amarrées par des cordages à trois groupes de muscles papillaires. Les variations anatomiques sont nombreuses. Pour certains auteurs [92], la valve tricuspide doit être divisée, d’un point de vue anatomique, embryologique et fonctionnel, en deux parties bien distinctes : d’un côté la partie septale correspondant à la zone fibreuse, relativement fixe, de l’orifice donnant attache à la valve septale bien individualisée, de l’autre la partie musculaire de l’orifice sur laquelle s’insère un voile valvulaire discontinu de morphologie très variable, divisé par une ou plusieurs commissures en deux à six segments. Au moment de son ouverture diastolique maximale, les dimensions de l’orifice, mesurées par échographie, sont, chez l’adulte, de 35 à 40 mm pour le diamètre principal (20 à 25 mm/m_ de surface corporelle), 100 à 130 mm pour la circonférence, 9 à 13 cm_ pour la surface (soit 5 à 7 cm_/m_) [4, 86, 89]. Des mesures faites sur des pièces anatomiques fraîches donnent des résultats un peu supérieurs (11 à 15 cm_). Philippe Luxereau : Ancien chef de clinique cardiologique, assistant des hôpitaux de Paris, service du Pr Vahanian, hôpital Tenon, 4, rue de la Chine, 75020 Paris, France. Toute référence à cet article doit porter la mention : Luxereau P. Lésions acquises de la valve tricuspide. Encycl Méd Chir (Elsevier, Paris), Cardiologie-Angéiologie, 11-014-A-10, 1999, 10 p. Physiologie Les dimensions de l’anneau varient au cours du cycle cardiaque. Leur circonférence maximale est atteinte durant la mésodiastole et coïncide avec l’onde P de l’électrocardiogramme. Elles diminuent ensuite rapidement sous l’influence de la contraction auriculaire, puis ventriculaire. La réduction de surface est estimée à 33 % par Tei [86] et on estime que les deux tiers de la contraction sont dus à la systole auriculaire, un tiers à la systole ventriculaire [88]. La contraction de l’orifice est asymétrique, le raccourcissement n’intéresse que les portions myocardiques de l’anneau, en regard des valves antérieure et postérieure qui sont ainsi amenées au contact de la valve septale amarrée à la portion fibreuse de l’anneau. Le flux à travers la tricuspide enregistré par échodoppler ressemble au flux mitral avec deux ondes diastoliques correspondant successivement au remplissage passif proto- et mésodiastolique, puis à la contraction auriculaire en fin de diastole. En cas de tachycardie, le flux tend à diminuer et l’onde auriculaire à augmenter aux dépens du remplissage rapide protodiastolique. La respiration influence le flux tricuspidien : l’inspiration profonde, en diminuant la pression intrathoracique, favorise le remplissage auriculaire et augmente le flux à travers la tricuspide. Étiologie et anatomie pathologique des lésions acquises de la tricuspide Les étiologies à l’origine d’un dysfonctionnement tricuspidien intéressent rarement la seule tricuspide de façon isolée. Elles coexistent le plus souvent avec des anomalies du cœur gauche ou de la circulation pulmonaire. On doit en distinguer deux grandes variétés, l’IT fonctionnelle et les lésions organiques d’origines diverses. Insuffisance tricuspidienne fonctionnelle C’est la cause la plus fréquente d’IT pure. Dans la série autopsique de Waller [95], elle représente 47 % des observations, loin devant toutes les causes organiques. La régurgitation résulte de la dilatation des cavités droites et de l’anneau tricuspidien secondaire à une surcharge mécanique du ventricule droit, le plus souvent par hypertension pulmonaire, quelle qu’en soit l’origine : les lésions mitrales ou mitroaortiques sont fréquemment en cause, mais aussi plus rarement les insuffisances ventriculaires gauches hypertensives ou ischémiques, les cardiomyopathies, les cœurs pulmonaires aigus ou chroniques, emboliques ou par insuffisance respiratoire, l’hypertension artérielle pulmonaire primitive. 11-014-A-10 ENCYCLOPÉDIE MÉDICO-CHIRURGICALE 11-014-A-10 © Elsevier, Paris L’appareil valvulaire et sous-valvulaire est anatomiquement normal mais l’anneau est dilaté de façon asymétrique, dans sa portion myocardique, en regard de l’insertion des valves antérieure et postérieure, ce qui provoque l’incontinence valvulaire [57, 86, 89, 95]. Lésions organiques de la tricuspide De multiples pathologies organiques peuvent affecter la valve tricuspide, déterminant selon les cas une insuffisance, un rétrécissement ou la combinaison des deux. Chacune d’entre elles est relativement rare. Rhumatisme articulaire aigu L’atteinte tricuspidienne rhumatismale n’est jamais isolée mais toujours associée à une atteinte mitrale et, une à deux fois sur trois, à une atteinte aortique [39, 67]. Sa fréquence, comme celle de la maladie rhumatismale, est en baisse : dans la série de la Mayo Clinic portant sur 363 remplacements tricuspidiens suivis pendant 25 ans [39], la fréquence de l’étiologie rhumatismale est passée de 79 à 24 % entre les périodes 1963-1967 et 1983- 1987.Au cours des valvulopathies mitrales rhumatismales, la fréquence d’une tricuspidite organique n’est pas parfaitement connue. Elle a été estimée à plus de 30 % dans certaines séries anatomiques anciennes, mais une étude échographique récente la chiffre seulement à 6 % [22] et une étude anatomique à 11 % [63]. Il s’agit presque toujours de femmes [63]. L’atteinte est souvent moins sévère que sur la mitrale. La lésion principale est la rétraction valvulaire qui prédomine sur la valve postérieure ; il peut s’y ajouter des fusions commissurales modérées, partielles. Les valves sont épaissies, très rarement calcifiées. Les cordages sont modérément épaissis. L’ensemble réalise neuf fois sur dix une maladie tricuspidienne à fuite de degré variable et sténose modérée [67]. Le rétrécissement pur et/ou serré (surface inférieure ou égale à 1,5 cm_) est rare [39, 63, 67]. Endocardite infectieuse Autrefois rare, l’endocardite tricuspidienne a vu sa fréquence augmenter considérablement, parallèlement à celle de la toxicomanie par voie intraveineuse. Elle représente la deuxième cause d’IT pure. Il s’agit souvent d’endocardites à germes virulents, staphylocoques ou à Gram négatif [11, 73, 99], parfois à germes multiples [5, 99] qui peuvent se greffer sur des valves préalablement normales et intéresser le seul cœur droit dans la moitié des cas. Les lésions sont habituellement mutilantes, ruptures de cordages ou perforations valvulaires, à l’origine d’insuffisance valvulaire avec embolies pulmonaires septiques. Rarement, des végétations volumineuses peuvent être responsables d’obstruction valvulaire avec tableau de rétrécissement. Syndrome carcinoïde Il s’agit d’un syndrome rare, mais très particulier. Les tumeurs carcinoïdes sont des tumeurs malignes sécrétantes siégeant le plus souvent sur l’intestin grêle ou l’appendice, parfois l’ovaire, qui libèrent, en grandes quantités, des substances vasoactives, sérotonine, bradykinine, substance P, dopamine, histamine, neuropeptides K, etc [52, 72]. Ces substances, qui empruntent la circulation porte, sont inactivées par le foie, mais en cas de métastases hépatiques ou de localisations extradigestives, elles sont déversées dans la veine cave inférieure et atteignent le cœur droit où elles provoquent des lésions de fibrose de l’endocarde et des valves tricuspide et pulmonaire dans plus de deux tiers des cas. Il y a une corrélation entre la sévérité des lésions et le taux circulant de certaines de ces substances qui sont capables de stimuler les fibroblastes, ce qui expliquerait leur action [72]. La tricuspide, les cordages et les piliers sont rétractés, rigides, immobilisés, ce qui réalise une maladie tricuspide à fuite prédominante, à la différence de la valve pulmonaire dont l’atteinte est surtout sténosante. Les substances responsables sont inactivées dans la traversée pulmonaire, si bien que le cœur gauche est habituellement respecté, à moins de shunt droit gauche. Dystrophie Exceptionnellement isolé, un prolapsus tricuspidien coexiste souvent avec un prolapsus mitral : 21 à 52 % des cas selon les séries [41, uploads/S4/ lesions-acquises-de-la-valve-tricuspide.pdf
Documents similaires
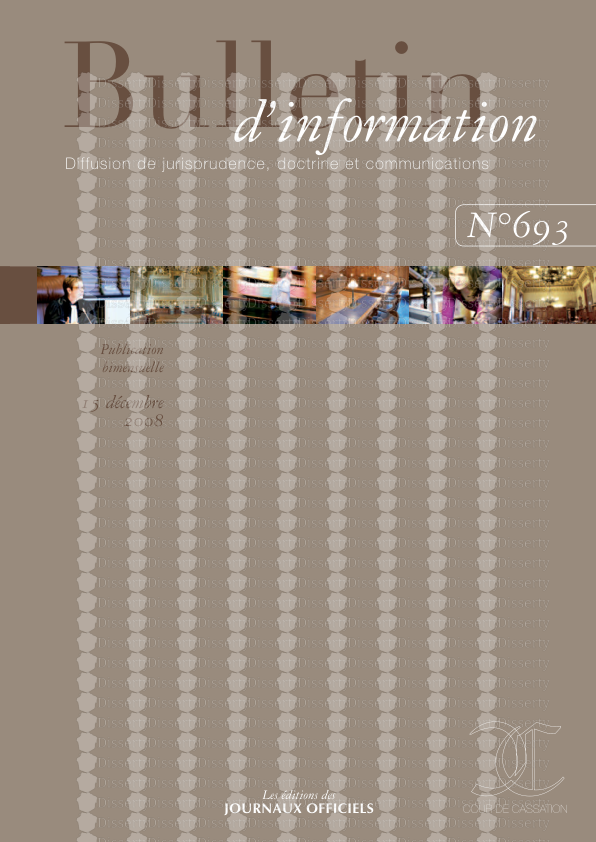

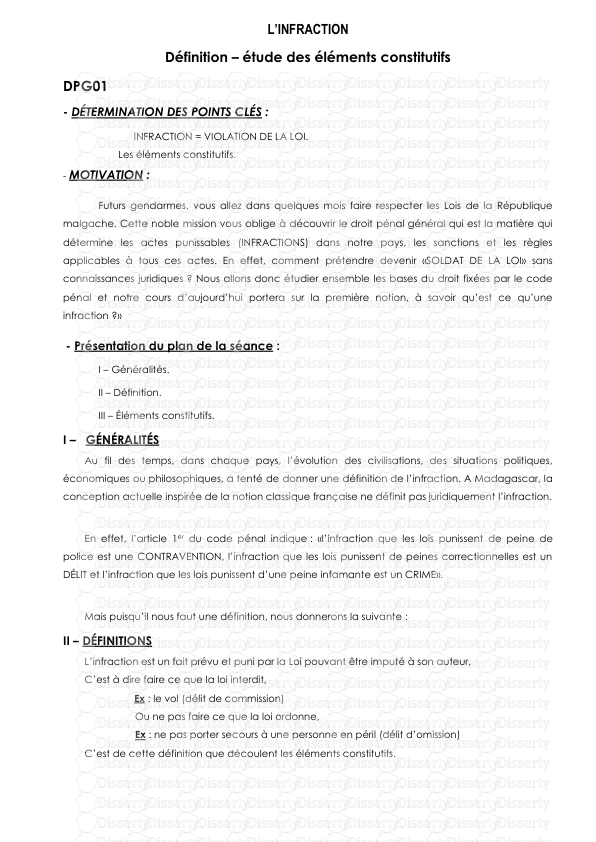







-
37
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 02, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.2039MB


