Semestre 2 2016-2017 LICENCE 2 Sophie Druffn-Bricca Jean-Raphaël Demarchi Droit
Semestre 2 2016-2017 LICENCE 2 Sophie Druffn-Bricca Jean-Raphaël Demarchi Droit des obligations : la responsabilité délictuelle • Les principes de responsabilité • La responsabilité du fait d’autrui • La responsabilité du fait des choses ANNALES D’EXAMENS & Sujets d’actualité CORRIGÉS COMMENTÉS À jour de la réforme du droit des obligations (ord. 10/02/2016) La faute de la victime constitue une des trois causes étrangères exonératoires de responsabilité, commune à toutes les responsabilités. Son rôle varie selon les responsabilités et selon les époques. Dissertation Sujet 11 Vous traiterez le sujet suivant : La faute de la victime Aucun document n’est autorisé Durée de l’épreuve : 2 heures 0algré sa formulation, le sujet proposé impose une certaine réÁexion, plus qu’une description. La faute de la victime est une cause d’exonération de responsabilité. ce titre elle est étudiée avec chaque régime selon la force qui lui a été reconnue (exonération totale ou partielle). Les étudiants doivent rechercher dans toutes les parties du cours consacrées à la responsabilité délictuelle toutes les données sur cette question pour en dresser un bilan. 68 CONSEILS DU CORRECTEUR Corrigé rédigé et commenté par Sophie Druffin-Bricca Introduction La victime peut être, par sa faute, la cause de son propre dommage. C’est pour- quoi, traditionnellement le droit commun de la responsabilité civile admet comme cause d’exonération la faute de la victime, à côté de la force majeure et du fait d’un tiers. Aujourd’hui, que la victime agisse sur le terrain de la responsabilité pour faute ou d’une responsabilité objective, elle peut se voir opposer sa propre faute pour ex- clure ou minorer son droit à réparation. La faute de la victime est en effet une cause d’exonération commune à toutes les hypothèses de responsabilité délic- tuelle qu’elle soit personnelle, du fait d’autrui ou du fait des choses. Paradoxalement la conception très large de la faute, développée dans le souci de faciliter et d’améliorer l’indemnisation de la victime, se retourne contre celle-ci. La faute de la victime est en effet appréciée de la même façon que la faute de l’au- teur lui-même, c’est-à-dire par comparaison avec le comportement d’un homme prudent et avisé dans les mêmes circonstances. Elle est comprise comme une faute objective, comme tout comportement objectivement irrégulier, peu impor- tant de qui elle émane. La disparition de l’imputabilité joue pour les deux catégo- ries l’auteur du dommage et sa victime. Désormais toute victime, peut se voir opposer sa faute, qu’elle soit sous l’empire d’un trouble mental (art. 414-3, C. civ.) ou mineure. Depuis l’arrêt Lemaire où elle a énoncé que « pour déclarer un enfant de treize ans partiellement responsable des conséquences de l’accident mortel dont il a été victime, les juges ont pu estimer que le mineur avait commis une faute sans avoir à vérifier s’il était capable de discerner les conséquences de son acte » (Ass. plén., 9 mai 1984, arrêts Lemaire et L’introduction permet d’aborder des points en relation avec le sujet qui ne seront pas ensuite développés. 69 Derguini), la Cour de cassation considère que la faute d’un mineur peut être rete- nue à son encontre même s’il n’est pas capable de discerner les conséquences de son acte. C’est pour échapper à cette rigueur que la jurisprudence Desmares avait privé dans le domaine de la responsabilité du fait des choses la faute de la victime de son rôle partiellement exonératoire. Après de nombreuses hésitations jurisprudentielles, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a même admis que la faute de la victime directe est oppo- sable à la victime par ricochet (Ass. plén., 19 juin 1981, 2 arrêts). La réparation du préjudice de la victime par ricochet est diminuée si la victime directe a commis une faute justifiant une réparation simplement partielle de son propre dommage. Ce principe a été repris par la loi du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation dans son article 6 qui oppose à la victime par ricochet la faute de la victime immédiate. On constate alors l’importance de la faute de la victime par son application généralisée à toutes les responsabilités et à toutes les victimes. En revanche sa portée n’est pas toujours la même. Elle n’est qu’exceptionnellement une cause d’exonération totale (1), et le plus souvent une cause d’exonération partielle de l’auteur du dommage (2). 1 • -B GBVUF EF MB WJDUJNF DBVTF FYDFQUJPOOFMMF d’exonération totale À l’origine, la jurisprudence considérait que la faute de la victime écartait toute responsabilité du gardien, même si elle ne présentait pas les caractères de la force majeure. Cette solution fut vite abandonnée à raison de sa sévérité envers les vic- times privées de toute réparation, quelle que soit la gravité de leur faute. La Cour de cassation a alors utilisé plusieurs critères pour faire jouer à la faute de la victime un rôle exonératoire total : soit elle constitue la cause unique, ou exclusive, du dom- mage (A), soit elle présente les caractères de la force majeure (B). " -B GBVUF EF MB WJDUJNF DBVTF FYDMVTJWF EV EPNNBHF Dans leurs premières décisions, la Chambre des requêtes en 1934 puis la chambre civile de la Cour de cassation en 1936 ont exigé que la faute soit la cause unique du dommage pour justifier une exonération totale de son auteur. Dans un arrêt du 6 octobre 1998, la Cour de cassation a admis l’exonération du gardien au motif que la faute de la victime constituait la cause exclusive de son dommage. La loi du 5 juillet 1985 a repris cette condition, disposant qu’exceptionnellement le gardien ou le conducteur peut s’exonérer totalement par suite de certaines fautes de la victime immédiate. Il s’agit du cas où la victime non conductrice a recherché intentionnellement le dommage (tentative de suicide par exemple, art. 3, al. 3, loi 1985), et de celui où la victime âgée de 16 à 70 ans a commis une « faute inex- cusable, cause exclusive de l’accident » (art. 3, al. 1, loi 1985). Lorsque la victime est conductrice, sa faute, a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’elle a subis. La faute du conducteur doit avoir joué un rôle causal dans la survenance du dommage. La Cour impose l’existence du lien de causalité entre la faute de la victime et son dommage (Ass. plén., 6 avr. 2007 – 2 arrêts). En l’espèce elle a pu juger que si la conduite en état d’ébriété de la victime est bien constitutive d’une faute, l’absence de lien de causalité avec le dommage interdit Vous ne faites qu’évoquer cette décision qui sera approfondie plus loin mais qui est nécessaire pour la cohérence de l’introduction. Ce point trouve sa place dans l’introduction eu égard au plan retenu. Il était possible d’envisager une partie sur la notion de la faute (son auteur, sa nature) en déplaçant ces éléments. -ustifiez votre plan en énonçant une idée générale qui va guider votre raisonnement et les idées forces. Expliquez comment vous allez traiter cette sous-partie. Ces jurisprudences ne peuvent être citées que si elles ont été étudiées en cours ou TD. Le sujet a une portée générale. Il fallait traiter des dispositions spéciales prévues pour les victimes d’accident de la circulation. 70 de limiter ou d’exclure l’indemnisation des ayants droit de la victime. La faute de la victime ne doit pas nécessairement être la cause exclusive de l’acci- dent pour entraîner une exonération totale. Elle produit également cet effet quand elle réunit les caractères de la force majeure. B) La faute de la victime présentant les caractères de la force majeure La faute de la victime, imprévisible et irrésistible, est une cause d’exonération totale de responsabilité de l’auteur du dommage. Il s’agit là des caractères généraux de la force majeure, l’extériorité étant inhérente à la faute de la victime. Par définition la victime est un tiers et donc extérieure à l’auteur du dommage, sauf si son compor- tement a été « déterminé ou provoqué » par ce dernier. Ainsi la faute qui présente les caractères de la force majeure est totalement exonératoire. De façon plus large, la Cour de cassation s’est prononcée sur les critères de la force majeure dans la responsabilité délictuelle. En matière contractuelle l’irrésistibilité est apparue comme le critère essentiel. En matière délictuelle la deuxième chambre civile semblait maintenir les deux exigences d’imprévisibilité et d’irrésistibilité. Face aux incertitudes et divergences jurisprudentielles entre les formations, l’Assemblée plénière est intervenue le 14 avril 2006 pour tenter de proposer une définition uni- taire de la force majeure. Elle énonce, en matière délictuelle, que « si la faute de la victime n’exonère totalement le gardien qu’à la condition de présenter les carac- tères d’un événement de force majeure, cette exigence est satisfaite lorsque cette faute présente, lors de l’accident, un caractère imprévisible et irrésistible ». La Cour de cassation fait preuve d’une extrême sévérité dans le contrôle et l’appré- ciation de ces critères, dans le but de protéger les victimes. Par exemple elle a refusé de considérer l’agression d’un voyageur comme un cas de force majeure exonératoire de responsabilité de la SNCF . Car uploads/S4/ lextenso-etudiant-droit-des-obligations-responsabilite-delictuelle-corrige.pdf
Documents similaires








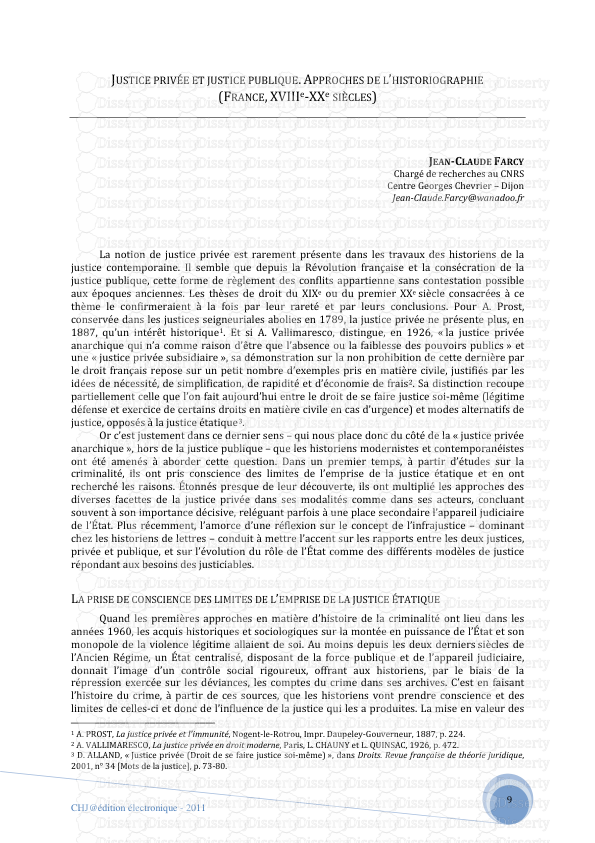

-
45
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 07, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.7817MB


