Page 1 sur 148 Page 2 sur 148 Sommaire INTRODUCTION Charles-André DUBREUIL, Pro
Page 1 sur 148 Page 2 sur 148 Sommaire INTRODUCTION Charles-André DUBREUIL, Professeur de droit public, Directeur du Centre Michel de l'Hospital EA 4232 I - Fonction et force obligatoire de la coutume LA COUTUME ET LES USAGES EN DROIT COMMERCIAL A LA FIN XIXe SIECLE ET AU DEBUT XXe SIECLE. UNE DISTINCTION SOUS INFLUENCE Florent GARNIER, Professeur d'histoire du droit LA COUTUME DANS L'EMPIRE ROMAIN TARDIF Aude LAQUERRIERE-LACROIX, Professeur d'histoire du droit REFLEXIONS SUR QUELQUES PROBABLES SOURCES COUTUMIERES DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT Philippe BOUCHEIX, Maître de conférences de droit public L’USAGE EN DROIT DU TRAVAIL Allison FIORENTINO, Maître de conférences de droit privé A LA RECHERCHE DE LA COUTUME EN DROIT COMMERCIAL… Jean-François RIFFARD, Maître de conférences de droit privé PERSISTANCE DE LA COUTUME EN DROIT CIVIL (UN PARALLELE AVEC LE DROIT COMMERCIAL) Nicolas GRAS, doctorant en droit privé, ED 245 Page 3 sur 148 II - L'appréciation de la coutume : le rôle du juge et du commentateur LE COMMENTAIRE DE COUTUMES : ROLE ET PORTEE. (L’EXEMPLE DE L’AUVERGNE, XVIe – XVIIIe SIECLES) Jacqueline VENDRAND-VOYER, Professeur émérite d'histoire du droit LA COUTUME : UNE REFERENCE "AMBIGUË" EN DROIT CIVIL POUR LE JUGE JUDICIAIRE Alain LE POMMELEC, Maître de conférences de droit privé LE JUGE PENAL INTERNATIONAL ET LA COUTUME INTERNATIONALE Herman Blaise NGAMENI, doctorant en droit public, ED 245 CONCLUSION Table des matières Page 4 sur 148 INTRODUCTION e Centre de recherche Michel de l’Hospital (EA 4232) a initié en 2010 un programme de recherche consacré aux sources coutumières du droit. Un tel projet correspondait également à la volonté de célébrer comme il se doit le 500e anniversaire de la rédaction de la coutume d’Auvergne. A cette occasion fut organisé un colloque intitulé « La coutume dans tous ses états », qui s’est déroulé du 15 au 17 juin 2010, sous la direction des professeurs Vendrand-Voyer et Garnier. Les actes devraient prochainement être publiés à La mémoire du droit. Parallèlement, fut organisé un cycle de conférences consacré à la coutume au cours duquel enseignants- chercheurs et doctorants de toutes spécialités eurent l’occasion de présenter le fruit de leur travail de recherche. Ce sont ces travaux qui sont ici reproduits, après qu’une sélection a été faite parmi les articles proposés. Deux grandes thématiques ont été retenues pour structurer cet ouvrage : la fonction et la force obligatoire de la coutume d’une part, l’appréciation de la coutume par le juge et le commentateur d’autre part. Dans ce cadre, les diverses interventions, bien que portant sur des thématiques distinctes les unes des autres, ont toutes abordé des problématiques semblables : la définition de la coutume, ses éléments constitutifs, sa force probante, sa valeur juridique, sa fonction, etc. Si bien qu’à l’issue de ce cycle de conférences, et à l’issue de la lecture de ces actes, une vision transversale, synthétique, de la source coutumière en droit semble pouvoir se dessiner. Ceci illustre parfaitement le fait que des études transversales sont possibles en sciences juridiques, qu’elles sont souhaitables, et qu’elles devraient se multiplier à l’avenir, tant il semble que la distinction opérée entre différentes branches du droit mérite d’être régulièrement dépoussiérée. Charles-André DUBREUIL, Directeur du Centre Michel de l'Hospital L Page 5 sur 148 I – Fonction et force obligatoire de la coutume LA COUTUME ET LES USAGES EN DROIT COMMERCIAL A LA FIN XIXe SIECLE ET AU DEBUT XXe SIECLE. UNE DISTINCTION SOUS INFLUENCE Florent GARNIER, Professeur d'histoire du droit, Clermont Université, Université d'Auvergne, EA 4232, Centre Michel de l'Hospital, CS 60032, F-63000 CLERMONT-FERRAND I – ASSIMILATION II – DISTINCTION a doctrine contemporaine admet généralement la distinction entre l’usage conventionnel et l’usage de droit1. Quelques réserves ont pu être formulées tant pour le droit interne que dans le cadre des relations internationales du commerce privilégiant une conception unitaire des usages du commerce2. Nul ne remet en cause l’importance et l’influence des usages dans la formation et l’évolution du droit commercial tant par le passé que de nos jours. Ainsi Fremery affirme que « le droit commercial a été établi par la coutume constante des commerçants… elle est constatée soit par les auteurs contemporains, soit par les décisions de la juridiction commerciale, qui ont attesté le constant usage »3. Pour Delamarre et Le Poitvin, l’usage est « le supplément de la loi ou, de la convention écrite, et […] il obtient force de loi »4. L’autorité des usages n’est pas à démontrer non plus pour Thaller tant ils ont contribué à la formation du droit commercial5. Pour Georges Ripert le « droit commercial a été pendant longtemps un droit purement coutumier sans qu’il y ait eu aucune rédaction de cette coutume. Même quand il a été codifié, il a conservé une place assez large aux usages »6. A prendre connaissance des travaux de la doctrine commerciale de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, la question des usages commerciaux semble avoir retenu son attention dans un contexte de renouvellement par la doctrine civiliste française des sources du droit et de la réception de théories formulées par la science juridique européenne. Les questions particulières de la nature, mais aussi de la portée des usages et de la coutume dans le domaine commercial, ont donné lieu en particulier à la publication de divers articles dans la première moitié du XXe siècle avec notamment Jean Escarra et Jules Valéry. Michel Pédamon s’est aussi intéressé à cette question après la Seconde Guerre Mondiale. 1 Pour quelques exemples, R. Houin et M. Pedamon, Droit commercial, 9e éd., Paris, 1990, p. 19-26. Y. Guyon, Droit des affaires, t. 1, 12e éd., Paris, 2003, p. 26-29. J. Mestre, M.E. Pancrazi, Droit commercial, 27e éd., Paris, 2006, p. 11-12. J.B. Blaise, Droit des affaires, 4e éd., Paris, 2007, p. 24. F. Dekeuwer-Defossez, E. Blary-Clement, Droit commercial, 9e éd., Paris, 2007, p. 16-18. 2 A. Kassis, Théorie générale des usages du commerce, Paris, 1984. 3 A. Fremery, Etudes de droit commercial ou Du droit fondé par la coutume universelle des commerçants, Paris, 1833, p. III. 4 L.-E. Delamarre et J. Le Poitvin, Traité théorique et pratique de droit commercial, T. I, Paris, 1861, p. 37 et s., n° 26 p. 58. 5 E. Thaller, Traité élémentaire de droit commercial, Paris, 4e éd., 1910, p. 34-41. 6 G. Ripert, Traité élémentaire de droit commercial, Paris, 1948, p. 20. L Page 6 sur 148 Escarra, en 1910, après une rapide approche historique et présentation de la formation de l’usage, s’est interrogé sur la place de cette « source extra législative » dans la hiérarchie des sources et de son rapport à la loi. L’essentiel de son article tient à l’examen des différentes matières commerciales dans lesquelles on rencontre des usages (assurances terrestres, vente, solidarité, compte courant, opérations de bourse, droit maritime…). Il assimile l’usage et la coutume et il adopte la distinction de l’usage de fait et l’usage de droit7. Jules Valéry, titulaire de la chaire de droit commercial à Montpellier, établit une filiation entre la coutume qualifiée de droit non écrit et trois sources : les usages (adoptant la distinction usages généraux et locaux), et de manière moins développée dans son analyse, la jurisprudence et la doctrine8. Enfin en 1959, Michel Pedamon, s’interrogeant sur la distinction de l’usage et de la coutume, développait l’idée que si les deux notions ont une « unité d’origine », elles diffèrent quant à leur régime juridique9. Il ralliait l’opinion de la majorité de la doctrine pour considérer la distinction usage et coutume. C’est là nous semble-t-il un point d’aboutissement d’une réflexion engagée quelques décennies plus tôt. Plusieurs étapes méritent d’être distinguées. La présente étude cherche à les préciser en essayant de rétablir une partie de la filiation doctrinale plus ou moins avouée ou exprimée par la doctrine commerciale française de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. La doctrine assimile dans un premier temps l’usage et la coutume au sein des sources non écrites du droit commercial (I). A partir de la notion d’usage, la doctrine va ensuite s’intéresser aussi à la formation et à la portée de la coutume en droit commercial. Elle s’interroge alors sur sa distinction avec l’usage. La conception unitaire traditionnelle va être remise en cause, tout comme la distinction usages généraux et locaux, pour laisser la place à de nouvelles approches sous l’influence de la science juridique européenne10. L’analyse développée par Cesare Vivante va être connue et discutée en France à partir de 1910 pour être finalement adoptée avec la distinction usage de fait et usage de droit (II). I – ASSIMILATION Contrairement à la conception classique développée dans l’Ancien droit, la doctrine commerciale du XIXe siècle assimile l’usage à la coutume. De manière générale, le caractère écrit ou non de la norme coutumière permet de distinguer l’usage de la coutume11. Le premier correspond au droit non écrit, à la coutume non rédigée, alors que la seconde est synonyme de coutume rédigée. Claude de Ferrière précise que la coutume correspond à « un droit écrit ayant force de loi dans la province pour laquelle uploads/S4/ revue-2-la-coutume.pdf
Documents similaires







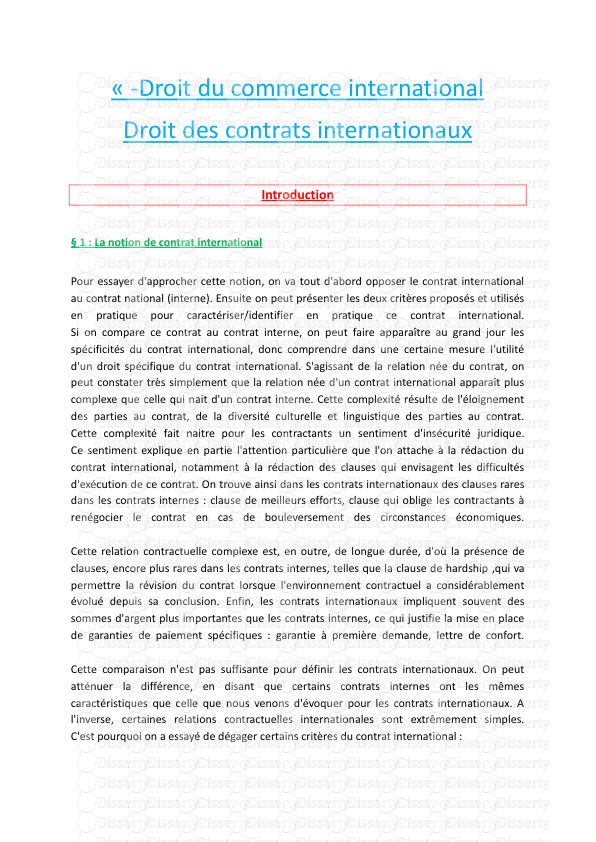


-
52
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 06, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 3.9996MB


