LE SUJET DE DROIT, LA PERSONNE ET LA NATURE Sur la critique contemporaine du su
LE SUJET DE DROIT, LA PERSONNE ET LA NATURE Sur la critique contemporaine du sujet de droit Yan Thomas Gallimard | Le Débat 1998/3 - n°100 pages 85 à 107 ISSN 0246-2346 ISBN 9782070752928 Article disponible en ligne à l'adresse: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- http://www.cairn.info/revue-le-debat-1998-3-page-85.htm -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pour citer cet article : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Thomas Yan , « Le sujet de droit, la personne et la nature » Sur la critique contemporaine du sujet de droit, Le Débat, 1998/3 n°100, p. 85-107. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Distribution électronique Cairn.info pour Gallimard. © Gallimard. Tous droits réservés pour tous pays. La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit. Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 200.146.5.24 - 28/01/2011 17h15. © Gallimard Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 200.146.5.24 - 28/01/2011 17h15. © Gallimard Yan Thomas Le sujet de droit, la personne et la nature Sur la critique contemporaine du sujet de droit La question du sujet de droit est devenue franchement polémique. L’antimodernité con- centre aujourd’hui sa critique sur une construc- tion juridique très ancienne, pour lui faire por- ter la charge de tous les maux attribués à l’hypertrophie du sujet. De toutes parts, chez les juristes, chez les théoriciens du droit, chez cer- tains philosophes aussi, pour ne pas parler de certains courants psychanalytiques, se multi- plient les attaques contre la toute-puissance que le droit aurait attribuée, sous la catégorie moderne de sujet de droit, à l’individu maître de soi-même et de la nature. Une idéologie nouvelle se dessine, très réac- tive pour ne pas dire réactionnaire, et qui, pêle- mêle, dénonce la technique, l’individu et le marché. Cette idéologie a toute une histoire. Elle se réfère souvent à Heidegger et utilise en France la critique de J. Ellul sur la technique et de M. Villey sur le droit subjectif moderne. Il n’est pas question ici d’entrer dans l’histoire de ces controverses purement doctrinales, qui, au demeurant, sont assez bien connues. Mieux vaut évoquer le débat juridique lui-même, tel qu’il se dessine sur un terrain casuistique où l’argumentation est au service de la décision — où elle est contrainte par l’impératif de ses effets pratiques. Je me contenterai de présenter ici quelques-unes des questions juridiques con- temporaines à propos desquelles se noue la polémique autour de l’idée dite moderne du sujet de droit et de celle, corollaire, de droit sub- jectif. J’essaierai, dans un second temps, de sug- gérer dans quelle mesure et en quoi le sujet juridiquement armé pour la maîtrise et la trans- formation de soi-même et du monde, et qui est en passe de réaliser cette maîtrise sur le terrain technique comme sur le terrain politique, s’ins- crit dans notre plus ancienne tradition du droit. Elle y est beaucoup plus profondément inscrite que nous ne le croyons et que ne le croient par- ticulièrement les contempteurs du droit naturel dit moderne. Yan Thomas est spécialiste de l’histoire du droit romain. Il est notamment l’auteur de Mommsen et l’« Isolierung » du droit. Rome, l’Allemagne et l’État (Paris, De Boccard, 1984). Le Débat a déjà publié : « L’institution civile de la cité » (n° 74, mars-avril 1993). Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 200.146.5.24 - 28/01/2011 17h15. © Gallimard Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 200.146.5.24 - 28/01/2011 17h15. © Gallimard 86 La critique antimoderne Les débats les plus vifs, aujourd’hui, chez les civilistes sont liés aux récents domaines que l’essor de certaines techniques offre à l’expan- sion de la maîtrise des sujets sur la nature et sur eux-mêmes, en tant qu’eux-mêmes seraient aussi l’œuvre de la nature. Les premières tech- niques visées sont celles qui transforment les conditions mêmes de la production ou de la reproduction de la vie, c’est-à-dire les biotech- nologies. Des pans entiers du droit des per- sonnes et du droit de la filiation sont, croit-on, directement atteints ou menacés à travers elles — surtout lorsque, ce qui est généralement le cas, ces techniques sont sollicitées et portées par un mouvement qui tend à se confondre avec celui du marché. On s’inquiète de ce qu’un cer- tain nombre de principes généraux du droit semblent directement mis en cause : à commen- cer par celui de l’indisponibilité des personnes dont dérive l’indisponibilité du corps humain, réalisée à l’aide de la catégorie civile de l’inalié- nable et du « hors commerce »1 ; également l’indisponibilité des filiations, qui n’est qu’une extension du premier principe ; ou bien encore, autre cercle élargi de cet irréductible noyau d’interdit, l’indisponibilité du genre sexuel publiquement inscrit dans l’état civil et consti- tué, par conséquent, dans l’univers politique. Mais, bien au-delà, des zones entières d’institu- tion sociale qui ne relevaient traditionnellement pas du droit sont aujourd’hui prises en charge par les juristes, dans l’urgence où certains d’entre eux pensent être d’avoir à lutter, avec les armes du droit, contre les dangers que les tech- nologies du vivant font courir à la vie — à la vie entendue non pas au sens biologique, mais au sens de vie juridiquement fondée et socialement organisée2. Aux nouveaux défis que posent à cet ordre de la vie humaine les avancées récentes de la biotechnologie et de l’ingénierie génétique, certains répondent en énonçant des principes qui auraient eu de tout temps valeur de droit — par exemple, à propos du clonage, le principe du caractère nécessairement sexué, en droit, de la reproduction humaine, ou bien encore celui de la nécessaire singularité génétique, en droit, des sujets humains3. Parfois, ce sont des prin- cipes nouveaux que l’on croit découvrir pour interdire certaines pratiques du marché, tel le principe de la dignité humaine, dignité indispo- nible aux tiers comme au sujet lui-même4, sans prendre garde, d’abord, que la dignité est une très vieille catégorie juridique liée précisément à l’indisponibilité de certaines institutions poli- tico-administratives (par exemple, la dignité de l’office ou la dignité de la couronne, indispo- Yan Thomas Le sujet de droit, la personne et la nature 1. M.-A. Hermitte, « Le corps hors du commerce hors du marché », Archives de philosophie du droit, 1988, pp. 323- 346 ; J.-C. Galloux, « Réflexions sur la catégorie des choses hors du commerce : l’exemple des éléments et des produits du corps humain en droit français », Les Cahiers de droit, vol. 30, n°4, 1989, pp. 1011-1032 ; I. Couturier, « Re- marques sur quelques choses hors du commerce », Les Petites Affiches, 6 septembre 1993, n° 107, pp. 7-12 ; 13 sep- tembre 1993, n° 110, pp. 7-14 ; B. Oppetit, « Droit du com- merce et valeurs non marchandes », Mélanges P. Lalive, 1993, pp. 309-319. 2. Sur ce concept de vie organisée, par opposition à la vie purement animale, ou « vie nue », voir G. Agamben, Homo sacer, trad fr. Paris, 1996. L’opposition de bios et de zoè confère à la langue grecque, ici, valeur de paradigme. En revanche, l’expression prétendument romaine « instituer la vie » (vitam instituere), souvent utilisée par P. Legendre pour désigner le discours européen en ce qu’il fonde et fait loi, n’a strictement aucun écho en latin, et moins encore en droit romain : cette formule n’est attestée par aucun texte. 3. Voir l’excellente étude critique de M. Iacub, « Faut-il interdire le clonage humain ? », La Mazarine, n° 2, sep- tembre 1997. 4. B. Edelman, « Le concept juridique d’humanité », dans Le Droit, la médecine et l’être humain, 1996, pp. 245- 269 ; « La dignité de la personne humaine, un concept nou- veau », Dalloz, 1997, p. 185 sq. Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 200.146.5.24 - 28/01/2011 17h15. © Gallimard Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 200.146.5.24 - 28/01/2011 17h15. © Gallimard 87 nibles à leur provisoire titulaire) ; mais sans prendre garde non plus que, à définir la dignité de la personne humaine comme cette part d’in- disponible que chacun doit à son appartenance à l’humanité tout entière, l’on s’oblige, si l’on veut qu’une telle catégorie ait le moindre sens pratique, à définir précisément cette part : c’est- à-dire à tracer la limite qui sépare en chaque sujet sa dignité indisponible, qui relève de cette appartenance commune, et sa dignité indivi- duelle, qui ne fait qu’un avec sa liberté, et dont il est maître de disposer. En d’autres termes, avant d’engager contre la technique et le mar- ché le combat du droit au nom de la nature ou de la dignité humaines, il conviendrait de com- mencer par réfléchir aux difficultés — voire aux dangers — qu’il y a à conférer à cette nature et à cette dignité le sceau d’une sanction juridique. uploads/S4/ thomas-le-sujet-du-droit-la-personne-et-la-nature.pdf
Documents similaires




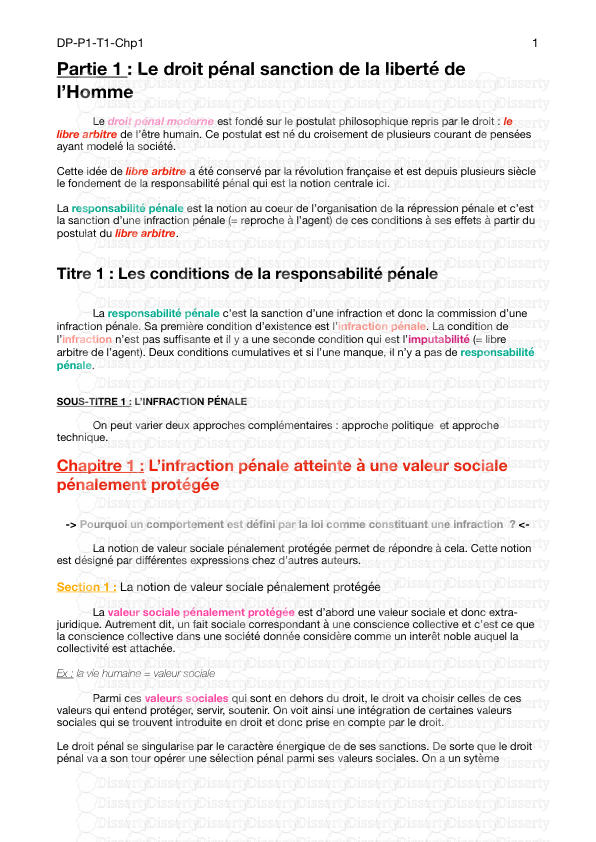





-
91
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 13, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.1575MB


