UNIVERSITE PAUL CEZANNE – AIX-MARSEILLE FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQU
UNIVERSITE PAUL CEZANNE – AIX-MARSEILLE FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE CENTRE DE DROIT MARITIME ET DES TRANSPORTS LA CONTENEURISATION DANS LES ECHANGES MARITIMES INTERNATIONAUX Mémoire pour le Master II DROIT MARITIME ET DES TRANSPORTS Présenté par Vola Marielle RAJAONARISON Dirigé par M. Christian SCAPEL Aix-en-Provence 2005 TABLE DES ABREVIATIONS AIS Automatic Identification System CFS Container Freight Station CSI Container Security Initiative C-TPAP Custom Trade Partnership Against Terrorist EVP Equivalent Vingt Pieds FCL Full Container Loaded IMTM Institut Méditerranéen des Transports Maritimes ISO International Standardisation Organisation ISPS International Ship and Port facility Security Code LCL Less than Container Load NVOCC Non Vessel Operating (Owning) Common Carriers OMI Organisation Maritime Internationale SOMMAIRE INTRODUCTION PARTIE I – ASPECTS TECHNIQUES ET PRATIQUES DE LA CONTENEURISATION Chapitre I – Evolution technique des instruments matériels Section 1 – Le conteneur Section 2 – Les navires et les ports Chapitre II- Pratique actuelle de la conteneurisation Section 1 – Conteneurisation et transport multimodal transmaritime Section 2 – Les acteurs de la conteneurisation PARTIE II – ASPECTS JURIDIQUES DE LA CONTENEURISATION Chapitre I- Les problèmes juridiques de la conteneurisation Section 1 – Les opérations précédant le voyage maritime Section 2 – Le voyage maritime et le déchargement Section 3 – Le contentieux du conteneur Chapitre II – Le conteneur au centre d’un problème d’actualité : la sûreté du transport maritime Section 1 – La sûreté des conteneurs Section 2 – Les actions menées au niveau international CONCLUSION INTRODUCTION « L’espace maritime est défini comme un système géographique dont la finalité consiste à relier les espaces continentaux. [1]» Le transport maritime est donc un instrument privilégié des échanges internationaux et a connu plusieurs révolutions pour s’adapter au fil du temps à l’évolution des échanges. La conteneurisation est sans doute l’une des révolutions les plus marquantes du transport maritime. Mais qu’est ce en fait la conteneurisation et comment elle est née ? La conteneurisation est l’utilisation de conteneurs pour le transport maritime de marchandises. Apparu dans les années 20 aux Etats-Unis dans les transports ferroviaires, la conteneurisation a gagné la France peu de temps après car les premières utilisations en maritime y ont été enregistrées en 1925. Par la suite, la conteneurisation a été utilisée par les Américains pendant la Deuxième Guerre Mondiale et la Guerre de Corée. L‘exploitation commerciale de ce mode de conditionnement telle que nous le voyons de nos jours ne date que de 1956 où un entrepreneur de transport routier américain, Malcom Mac Lean a eu l’idée de transporter ses remorques sans leurs châssis sur un navire. Ce fut le début de la révolution du conteneur. Peu de temps après, il a développé son idée et a aménagé ses navires spécialement pour transporter les conteneurs. C’est à cette époque que l’on enregistre la construction des premiers porte-conteneurs, l’Ideal X et l’Alema d’une capacité de 58 unités chacun. Le 23 avril 1966, le Fairland d’une capacité de 228 conteneurs a été le premier porte-conteneurs à relier l’Amérique et l’Europe. La conteneurisation a donc moins d’un siècle et pourtant son essor fait qu’elle se taille actuellement une place de choix dans les échanges maritimes internationaux. En effet, 80% des échanges internationaux se font à par voie maritime pour un volume évalué à 5,1 milliards de tonne en 2004. Le conteneur représente près de 80% de ce volume soit 300 millions d’EVP[2]. Notre travail qui s’intitule « LA CONTENEURISATION DANS LES ECHANGES MARITIMES INTERNATIONAUX » trouve tout naturellement son intérêt à une époque où le transport de marchandises par conteneur est devenu banal et où tout ou presque se met en « boîtes ». Toutes les marchandises qui doivent voyager sur de longues distances en dehors des vrac ( charbon par exemple, céréales, minerais de fer par exemple) et des liquides (hydrocarbures par exemple) sont aujourd’hui chargées en conteneurs. Par ailleurs, 9 400 000 conteneurs circulent en 2004 représentant 14 300 000 EVP. Ces constats nous amènent à nous intéresser sur le conteneur et ce qu’il représente. Le terme de « boîte » utilisé quand on évoque les conteneurs amène à ne voir dans le conteneur que la notion matérielle de la chose. Cependant, le concept vise une notion matérielle mais aussi une notion juridique. Etant considéré comme un « faux problème »[3] par le Doyen Rodière, on constate de plus en plus que le conteneur a ses particularités aussi dans la pratique par rapport aux autres types d’emballage ce qui entraîne forcément une spécificité juridique. Le conteneur est complexe dans sa définition. C’est un emballage mais aussi une marchandise[4]. En effet, les recherches autour du conteneur avaient pour but de trouver la formule d’un emballage susceptible de permettre d’acheminer intacte une marchandise à travers toutes les vicissitudes du transport maritime. Comme le souci des chargeurs et des transporteurs est de garantir l’arrivée de la marchandise en son état de départ, le conteneur a été présenté à son avènement comme une « forme relativement nouvelle d’emballage[5] » dont l’utilisation assurerait l’arrivée des colis en toute sécurité et aux moindre frais et offrant par ailleurs une « garantie contre casse, vol et avaries, sans limitation ». La pratique voit dans le conteneur un emballage étanche, solide, inviolable et facile à manipuler. La résistance et l’inviolabilité sont les points forts du conteneur. Mais le conteneur n’est pas qu’un simple emballage. Comparé aux autres types d’emballage, il se distingue par sa valeur onéreuse[6] et par le fait qu’il soit réutilisable plusieurs fois[7], il est assimilé à une marchandise et non à un accessoire du navire. Le conteneur a ses avantages et ses inconvénients. L’objet de notre travail est justement de montrer une vue générale de la conteneurisation dans les échanges maritimes internationaux, comment elle a évolué et qu’en est - il de nos jours. Par ailleurs, comme la conteneurisation évolue dans le contexte précis des échanges internationaux en général, on ne peut l’évoquer sans parler du transport multimodal. En effet, le conteneur est devenu l’ « outil roi » de l’expédition maritime et du transport multimodal en général. La première partie de notre travail étudiera les aspects techniques et pratiques de la conteneurisation dans laquelle on évoquera l’évolution technique du conteneur (Chapitre I) et la pratique actuelle de la conteneurisation (Chapitre II). Notre deuxième partie envisagera la conteneurisation dans son aspect juridique à travers les problèmes juridiques de la conteneurisation (Chapitre I) et un sujet d’actualité qui a retenu notre attention, la sûreté des conteneurs (Chapitre II). PARTIE I - ASPECTS TECHNIQUES ET PRATIQUES DE LA CONTENEURISATION Considérée comme une véritable révolution dans le transport maritime, le conteneur s’est imposé en moins de cinquante ans comme le premier moyen de conditionnement dans les échanges internationaux. Nous sommes actuellement loin des premiers cadres en bois, ancêtres du conteneur du début du vingtième siècle. Le conteneur a su s’adapter à l’évolution des échanges. Il y a autant de types de conteneurs que de marchandises transportées. Cet essor s’accompagne d’une évolution dans la taille des navires et dans l’aménagement et la modernisation des ports (Chapitre I) et ne peut être isolé du contexte actuel dans lequel il évolue, celui du transport multimodal (Chapitre II). ( ((( CHAPITRE I – EVOLUTION TECHNIQUE DES INSTRUMENTS MATERIELS Sous le vocable d’instruments matériels, on regroupe les conteneurs, objet de notre étude, les navires, destinés à les transporter et les ports qui doivent les accueillir. Section 1 - Le conteneur Le conteneur est à la fois un mode de conditionnement et un support logistique. Nous évoquerons dans ce travail les conteneurs maritimes qui, même utilisés dans les autres modes de transports, sont spécifiquement conçus pour le transport maritime. Paragraphe 1 – Notion de conteneur Avant de dresser l’inventaire des conteneurs en circulation actuellement, il convient de définir ce qu’est un conteneur. A - Définitions de conteneur Le conteneur peut se définir grossièrement comme une « boîte », généralement métallique, de forme parallélépipédique, destinée à contenir des marchandises en vue de faciliter leur manutention et leur transport. Mais le conteneur est plus qu’une simple boîte. Le Bureau International des Container[8] ou BIC[9] le définit comme « un récipient conçu pour contenir des marchandises en vrac ou légèrement emballées, spécialement en vue de leur transport sans manipulations intermédiaires, ni rupture de charge, par un moyen de locomotion quelconque ou la combinaison de plusieurs d’entre eux.[10]» En 1968, le Doyen Rodière, qui critiquait à l’époque les polémiques[11] autour du problème juridique des « containers », le définissait comme « des cadres fixes munis d’ouverture que l’on charge de marchandises individualisées ou en vrac et que l’on remet préalablement fermés et même scellés au transporteur. »[12] La Convention douanière de 1972 relative aux conteneurs (CCC) définit quant à elle le conteneur comme un engin de transport (qu’il s’agisse de cadre, d’une citerne ou d’un autre engin analogue) constituant un compartiment, totalement ou partiellement clos, destiné à contenir des marchandises. Il a un caractère permanent et est de ce fait suffisamment résistant pour permettre un usage répété. Spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs uploads/S4/ transport-maritime.pdf
Documents similaires






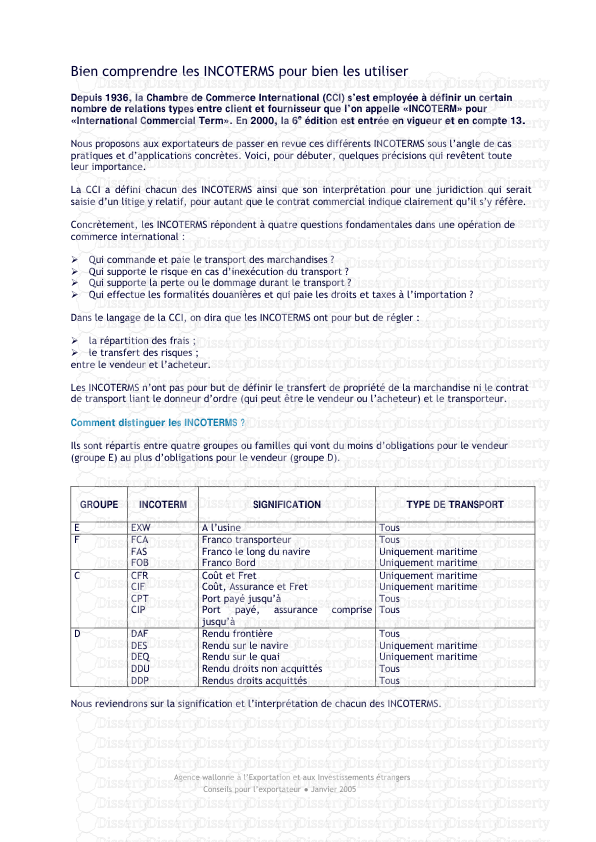



-
65
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 03, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.1924MB


