« Qui dit contractuel, dit juste. » (Fouillée) … en trois petits bonds, à recul
« Qui dit contractuel, dit juste. » (Fouillée) … en trois petits bonds, à reculons1 Louise Rolland Professeure Université de Montréal Faculté de droit 1 Ce texte s’inspire d’une communication faite au IXe Congrès de l’Association internationale de méthodologie juridique (Tunis, nov. 2005) : Les principes généraux de droit Introduction Le fil de la pensée suit les méandres d’un ordre qui parfois lui échappe. Le raisonnement qui, dans quelques moments privilégiés, paraît clair, direct et parfaitement agencé masque l’itinéraire tourmenté, les détours et circonvolutions qui l’ont engendré. Il arrive donc que le point d’arrivée ne reflète nullement le point de départ. Je me propose aujourd’hui de dévoiler le parcours tortueux d’une démarche intellectuelle qui a participé de près à l’émergence d’un principe général du droit. Il s’agit en quelque sorte de mettre à nu la construction de la science juridique et les trajets imprévus qu’emprunte son édification. Tout commence par une anecdote. En 1999, alors que je travaillais à la rédaction d’un article sur les figures contemporaines du contrat2, je me pris à reproduire l’expression « Qui dit contractuel, dit juste. » entre guillemets et (Fouillée) entre parenthèses. Nous retrouvons cette citation telle quelle dans la plupart, sinon tous les ouvrages contemporains en droit des obligations. Je l’avais jusque-là lue et relue sans jamais sourciller. Mais cette technique de rédaction soulève plusieurs questions. Comment et surtout pourquoi les auteurs s’autorisent-ils à citer cet extrait sans autre référence que le nom de Fouillée? La littérature juridique, si friande de notes en bas de page, si scrupuleuse de ses sources, si avide d’arguments d’autorité, se permet dans ce cas un écart et semble briser ses conventions tacites. Cette rupture par rapport à la tradition intellectuelle des juristes m’a poussé à faire enquête, à remonter le courant depuis les auteurs contemporains jusqu’à la source primaire. 2 Louise ROLLAND, « Les figures contemporaines du contrat et le Code civil du Québec », (1999) 44 R. de D. de McGill 903. Les caractéristiques formelles de cette citation s’arriment à l’ordre séquentiel de la construction juridique pris à rebours. Les trois signes rédactionnels correspondent aux trois temps du parcours : j’en ferai les trois rubriques de ce texte. D’abord, les guillemets et les parenthèses réunis : quelle est la fonction de cette citation dans le raisonnement des auteurs contemporains ? (1) Puis, les seuls guillemets : comment ce court extrait a-t-il pénétré le langage du droit ? (2) Enfin, les seules parenthèses : quelle est cette œuvre de Fouillée à laquelle l’on fait laconiquement référence ? (3) 1. Les auteurs contemporains : guillemets et parenthèses Tous les auteurs québécois sans exception et tous les auteurs français que j’ai consultés3 citent donc cet extrait dans leur ouvrage en droit des obligations. La plupart utilisent la formule des guillemets et parenthèses, sans référence exacte à la source primaire4. Certains cependant citent l’extrait entre guillemets sans aucune référence à l’auteur5; d’autres, enfin, en référent à un autre auteur, donc à une source secondaire6. 3 Boris STARCK, Henri ROLAND et Laurent BOYER, Droit civil – Les obligations – T. 2. Contrat, 6e éd., Paris, Litec, 1998, p. 5 : ces auteurs qualifient cet extrait de formule ramassée d’un philosophe du XIXe siècle; François TERRÉ, Philippe SIMLER et Yves LEQUETTE, Droit civil – Les obligations, 8e éd., Paris, Dalloz, 2002, p. 31; Jean CARBONNIER, Droit civil, T. 4, Les obligations, 18e éd., Paris, P.U.F., 1994, p. 51 : l’auteur reprend cet extrait de Fouillée dans l’État des questions consacré à l’autonomie de la volonté (dans les éditions refondues subséquentes, l’expression n’est pas reprise textuellement : on préfère affirmer que le contrat est le pivot de toute justice (Fouillée)). 4 Jean PINEAU et Serge GAUDET, La théorie des obligations, 4e éd., Montréal, Thémis, 2001, p. 303; Jean- Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN (avec la collaboration de Nathalie Vézina), Les obligations, 6e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2005, p. 118 : ces auteurs font appel à Fouillé sans le « e » muet de la fin du nom, comme c’était du reste le cas dans toutes les éditions précédentes de cet ouvrage. 5 Maurice TANCELIN, Des obligations – Actes et responsabilités, 6e éd., Montréal, Wilson et Lafleur, 1997, p. 32. 6 Didier LLUELLES (avec la collaboration de Benoît Moore), Droit québécois des obligations, Vol.1, Montréal, Thémis, 1998, p. 424 : ces auteurs renvoient à Jean CARBONNIER, Droit civil, T. 4, Les obligations, 12e éd., Paris, P.U.F., 1985, p. 148 À quelques exceptions près7, tous utilisent cette citation dans la section qu’ils consacrent au principe de l’autonomie de la volonté et à la liberté contractuelle. Le mode de raisonnement est relativement uniforme. Le contrat étant une source volontaire d’obligations, l’on s’interroge sur le rôle dévolu à la volonté dans sa formation et ses effets. L’approche est parfois historique : du formalisme romain, le contrat est devenu de plus en plus consensuel sous l’influence de la pensée chrétienne, qui le fonde alors sur le serment ou la foi jurée, donc dans une relation sacrée avec Dieu; ce n’est qu’à l’ère moderne qu’il trouve ses assises dans l’individualisme philosophique et le libéralisme économique. Le principe de l’autonomie de la volonté aurait eu ses précurseurs au XVIIe et XVIIIe8 siècles : Kant, Rousseau, Diderot, Grotius, Hobbes, Suarez, Pufendorf, Locke; mais, ce serait dans l’esprit révolutionnaire français et l’adoption du Code civil de 1804 qu’il aurait obtenu sa pleine consécration. Les auteurs rapportent que ce principe repose sur quelques postulats simples : des individus libres et égaux sont pleinement en mesure de veiller à leurs propres intérêts ; par conséquent, les règles auxquelles ils consentent sont les mieux à même d’assurer le bien-être de tous, l’intérêt général n’étant que la sommation des intérêts particuliers. L’application du principe de l’autonomie de la volonté aux rapports de droit privés entraîne des conséquences immédiates. Les conditions de formation des contrats, conditions de fond et de forme, reposent sur l’expression des consentements ; la force 7 Lluelles et Moore (Id.) l’évoquent dans le chapitre qu’ils consacrent à la lésion, donc à la justice contractuelle, et Tancelin (op. cit., note 4) y recourt dans la section intitulée « Diverses conceptions de la notion de contrat ». 8 Jean Pineau (op. cit., note 3) attribue complètement cette théorie à Kant (de la première à la quatrième édition), alors que Jean-Louis Baudouin (op. cit., note 3) voit chez les Encyclopédistes, Diderot et Rousseau les fondateurs de cette théorie (1ère et 2e édition) auxquels il ajoutera plus tard Grotius, Hobbes et Voltaire (de la 3e à la 5e édition); Maurice Tancelin, s’en remettant à Véronique RANOUIL (L’autonomie de la volonté, naissance et évolution d’un concept, Paris, P.U.F., 1980), fait remonter l’apparition de ce concept au XVIe siècle avec Suarez et son développement au XVIIe siècle avec Grotius, Hobbes, Pufendorf, Locke et Thomassius : op. cit., note 4, p. 34-35. obligatoire des conventions privées s’explique par le respect des volontés individuelles. Le contrat tenant lieu de loi à ceux qui les ont faits, le droit n’a plus qu’un rôle instrumental : en assurer l’exécution par la contrainte publique. Toute intervention externe à la volonté des parties, politiques législatives ou révision judiciaire, risque de fausser l’équilibre inhérent des intérêts en présence. Tout contrat librement consenti est par définition conforme à la justice et à l’intérêt général9, car « Qui dit contractuel dit juste. » (Fouillée). L’exposé de cette théorie, nous le savons, sert essentiellement de tremplin argumentatif à sa critique et la citation « Qui dit contractuel, dit juste. » est le pivot du revirement doctrinal. La pleine liberté et la parfaite égalité des parties n’existant pas dans les faits, la thèse individualiste, parce qu’elle repose sur des postulats erronés, se trouve infirmée. L’intervention de l’État et des tribunaux est donc nécessaire à l’équilibrage contractuel. La loi, l’ordre public sont meilleurs garants des valeurs supérieures de justice et d’égalité sociale que ne le sont les volontés individuelles10. D’après Didier Lluelles, « Qui dit contractuel dit juste » est un axiome qui relève davantage du sophisme que de la raison et qui est de moins en moins justifié sur le plan socio-économique11. Selon Starck, Roland et Boyer, la sentence « Qui dit contractuel dit juste » est un peu simpliste désormais démentie par les faits12, en réalité l’« autonomie de la volonté est un mythe périmé »13. 9 Si ces conséquences sont clairement exprimées par Jean-Louis Baudouin (op. cit., note 3) et Maurice Tancelin (op. cit., note 4), elles se lisent en filigranes dans l’ouvrage de Jean Pineau (op. cit., note 3). 10 Jean PINEAU et Serge GAUDET, op. cit., note 3, p. 303 à 308 11 Didier LLUELLES avec la collaboration de Benoît MOORE, op. cit., note 5, p. 148, no 777. 12 Boris STARCK, Henri ROLAND et Laurent BOYER, op. cit., note 2, p. 8 13 Ibid. L’autonomie de la volonté, posée comme principe général, demeure mais circonscrite, limitée, encadrée par un autre principe général, la justice contractuelle. Ce jugement semble unanime. L’impression qui ressort est que ce débat est clos, que le pas est franchi, que « uploads/S4/fouillee.pdf
Documents similaires









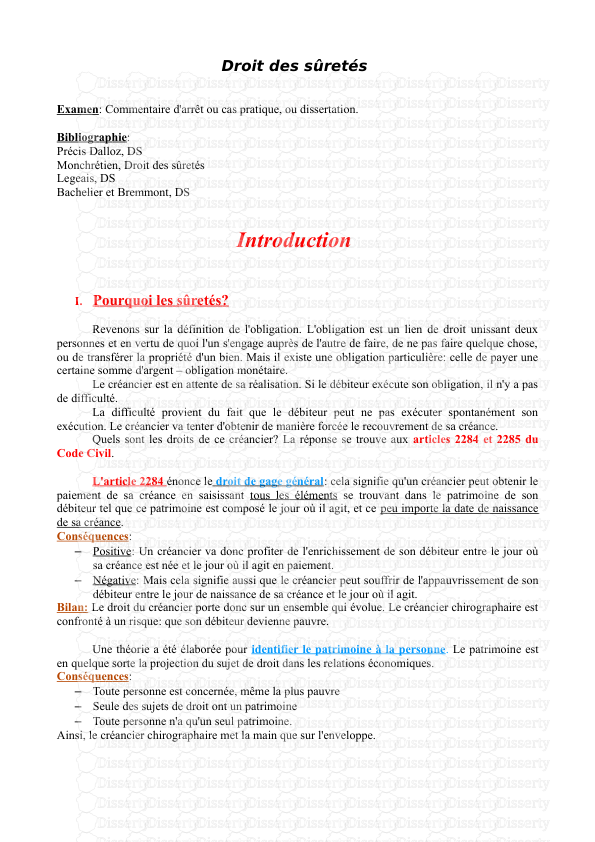
-
96
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 31, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.1548MB


