Droit et cultures Chercher Sommaire Document précédent 61 | 2011-1 : Technologi
Droit et cultures Chercher Sommaire Document précédent 61 | 2011-1 : Technologies, Droit et Justice Études Le statut juridique des enfants métis nés en Afrique Occidentale Française de parents inconnus : Entre idéalisme républicain et turpitudes coloniales The Legal Position of Mixed-Race Children Born in French Western Africa of Unknown Parents: Between Republican Idealism and Colonial Turpitudes Mamadou Badji p. 257-283 Résumé | Index | Plan | Texte | Bibliographie | Notes | Citation | Auteur Résumés Français English Le métissage, lié au contact colonial, s’entend ici des croisements « hors des liens du mariage » entre Européens et Noirs, résultant de la présence française en Afrique Occidentale. Le statut des enfants métis issus de ces unions illustre, à hauteur d’un cas d’école, comment le droit construit ce qui, aujourd’hui, prend l’appellation juridique de discrimination. L’auteur étudie cette « question métisse » à la lumière du droit colonial : la place des métis dans l’empire colonial français pose problème : sont-ils des citoyens ou des sujets indigènes ? Les débats ont été passionnés tant du point de vue ethnologique que juridique avec notamment le fait que la notion de « race » s’est retrouvée reconnue dans les textes juridiques. Haut de page Entrées d’index Mots-clés : Afrique Occidentale Française, droit colonial, métis, race Keywords : Colonial Law, French Western Africa, Mixed-Raced Population, Race Haut de page Plan La traduction juridique du problème Les aspects juridiques d’une question sociale Les distorsions entre le droit et les faits Les solutions apportées à la question du statut juridique des enfants métis La consécration de la possession d’état par le législateur L’action judiciaire Haut de page Recherche Texte intégral PDF Signaler ce document 1 M. Delafosse, « Note relative à la condition des métis en AOF », in Session de l’Institut colonial (...) 1Depuis que les premières intuitions des anthropologues et des ethnologues ont montré que l’esprit humain semble éprouver, pour des raisons toutes autres que scientifiques, l’irrépressible besoin de classification, diverses études ponctuent la recherche universitaire sur ce thème particulièrement fertile. Maintes fois observé dans l’histoire, le besoin de classer plonge ses racines dans la nécessité politique et sociale de se distinguer d’autrui et, ainsi, de forcer les distinctions, prélude aux actes discriminatoires. Cette nécessité est d’autant plus active quand elle s’appuie sur des considérations raciales. La plupart des travaux consacrés au phénomène du métissage1 au XXe siècle sont à cet égard très révélateurs. 2Ce sont des leçons de l’histoire que l’on apprend, comme en témoigne en Afrique Occidentale Française (AOF) la question des enfants métis nés de parents inconnus. Le statut de ces enfants illustre, à hauteur d’un cas d’école, comment le droit construit ce qui, aujourd’hui, prend l’appellation juridique de discrimination. 3Le décret du 5 novembre 1928 sur les métis nés de parents inconnus en AOF et ses avatars dans les autres colonies est le texte de base en la matière. Il introduit la race comme condition de la citoyenneté française ; l’innovation de ce texte juridique réside dans le fait que son application est ici limitée à la population des enfants issus du métissage. 4Le métissage peut être défini comme l’union entre Blancs et Noirs, Blancs et Jaunes et entre Jaunes et Noirs, c’est-à-dire comme le mélange des grands groupes de couleur entre lesquels se répartit l’espèce humaine. Cette acception du mot métissage renvoie à un élément social omniprésent, le Blanc. Sous ce rapport, le métissage est lié au contact colonial et dans le cadre de ce travail, il s’entend des croisements « hors des liens du mariage » entre Européens et Noirs, résultant de la présence française en Afrique occidentale. 2 Voir en particulier P. Bessaignet, in Encycl. univ. T. 15, 1989, p. 226. 3 Les études des anthropologues ont au demeurant intégré cette donnée. Voir H. Neuville, L’espèce, (...) 5Ce phénomène est, en ce qui concerne cette partie de l’Empire, jusque-là appréhendé à partir d’une analyse par trop descriptive. En effet, les études consacrées à ce fait social occultent les causes profondes qui lui donnent sa pleine cohérence. Certes, il n’a pas échappé à certains auteurs2 que c’est un phénomène social autant, et même plus, qu’un phénomène physique, mais les chercheurs en sciences sociales ne s’attardent guère sur les relations entre le métissage et la notion de race, volontairement absente de leur définition3. 4 La doctrine moderne reconnaît que la nationalité a un fondement politique et non ethnique (Niboy (...) 5 E. Saada, Les enfants de la colonie, Paris, éd. La Découverte, 2007, p. 14. 6Or, pendant toute la présence française en Afrique Occidentale, la couleur de peau a pu être considérée comme révélatrice d’une race. On peut objecter que le mot « race » ne correspond pas à une notion juridique précise et qu’en vérité ce n’est pas un concept auquel s’attache une signification juridique4 ; cependant la consécration d’un statut juridique propre aux « métis » s’est inscrite dans cette articulation, avec des effets de convergence ou de divergence. Comment alors rendre compte de cette irruption de la notion de « race » dans les textes juridiques ? L’inscription de ce mot dans le marbre du droit est d’autant plus surprenante que « la notion n’est pas ici utilisée à des fins exclusives, pour désigner un groupe ainsi marqué d’une altérité absolue »5. Au contraire, il s’agit d’intégrer ce groupe dans la communauté civique, en vertu de l’appartenance à une « race » qui est bien « française ». 6 Il s’agit de ceux dont la filiation paternelle et maternelle n’est pas légalement, volontairement (...) 7 Voir : Décret du 5 septembre 1930 déterminant la condition juridique des métis nés de parents inco (...) 8 Voir entre autres : A. Girault, « La condition juridique des métis dans les colonies françaises » (...) 9 B. Durand et E. Gasparini (sous dir.), Le juge et l’outre-mer, tome 3, Lille, Centre d’histoire ju (...) 7Si la question du statut des métis, particulièrement celle des enfants métis nés en AOF de parents inconnus6, a été réglée par divers textes7 dont l’origine et la portée ont été étudiées par d’éminents spécialistes de l’École de droit colonial8, il nous est apparu qu’en histoire du droit nous manquions, jusqu’à récemment9, d’une analyse approfondie sur le sujet, qui nous permette de progresser sur la voie de l’appréhension de l’Autre et de la gestion des différences, à l’époque coloniale. 8L’objet de la présente étude est donc d’envisager cette « question métisse », à la lumière du droit colonial. 9Figure emblématique de la discrimination, le métis se trouve classé en anthropologie avec le banni. 10Dans les usages coloniaux, le mot métis renvoie aux individus nés hors mariage d’un père « européen » et d’une mère « indigène ». Ils pouvaient être reconnus, soit uniquement par l’un de leurs auteurs, soit par les deux. Au tournant du XIXe siècle, ils se trouveront dans la situation d’enfants illégitimes, non reconnus puis abandonnés par leur père. C’est le cas de figure le plus fréquent même si, faute de données statistiques précises, il n’est pas possible d’avancer de chiffres. 10 Ministre à gouverneur général, 3 mars 1913, ANS, H 25. 11Pour tenter de saisir cette question sociale, il faut se placer sur le terrain du droit. En effet, l’analyse des textes juridiques – parfois négligée par les historiens du droit – est indispensable pour comprendre le phénomène du métissage, en raison de l’importance de la règle de droit dans les rapports sociaux. La chose est délicate, car « les métis n’ont jamais fait l’objet d’une définition juridique et la loi n’a pas établi de critérium pour les distinguer »10. Cependant, il n’est pas sans intérêt de préciser que l’état des personnes relativement à la filiation est très clairement défini par le Code civil qui opère des distinctions selon le statut matrimonial des parents (entre enfants légitimes et enfants naturels) et, pour les enfants naturels, selon qu’ils ont été reconnus auprès d’un officier d’état civil. Quant à la catégorie d’enfants abandonnés, elle a fait l’objet d’une définition précise par la loi du 27 juin 1904 sur les enfants assistés. 11 « Quand les parents sont mariés, l’enfant suit la condition du père ». 12Il résulte de ces textes que l’enfant métis né de parents inconnus est celui qui, juridiquement, n’a pas d’attaches familiales et, en vertu de l’adage patrem liberi sequuntur11, qui domine le droit de l’époque, faisant de l’enfant légitime l’héritier de son père, le métis illégitime et non reconnu ne jouit pas du droit de cité, il suit la condition de sa mère. 13 C’est la combinaison de ce défaut d’affiliation à l’institution familiale et à la nation qui donne toute son acuité à la « question métisse ». 12 H. Sambuc, « De la condition juridique des enfants nés en Afrique de parents légalement inconnus (...) 14Les métis, en AOF, étaient classés d’après des nuances d’épiderme, ou plus généralement, d’après des notions ethnologiques. C’est qu’en AOF, les autorités administratives s’attachent plus à établir l’infériorité juridique de ces métis (par une stratégie d’exclusion), dès l’instant que ces derniers uploads/S4/le-statut-juridique-des-enfants-metis-nes-en-afrique.pdf
Documents similaires







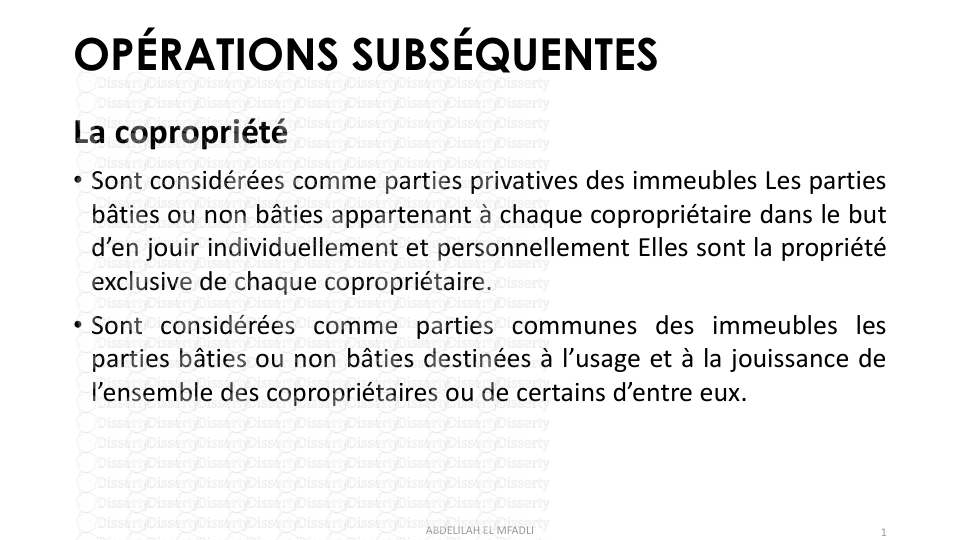


-
91
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 12, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.5026MB


