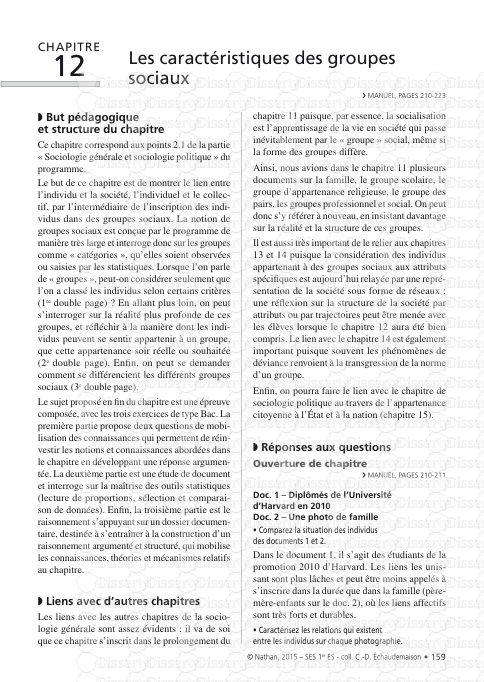© Nathan, 2015 – SES 1re ES - coll. C.-D. Échaudemaison • 159 ◗ ◗But pédagogiqu
© Nathan, 2015 – SES 1re ES - coll. C.-D. Échaudemaison • 159 ◗ ◗But pédagogique et structure du chapitre Ce chapitre correspond aux points 2.1 de la partie « Sociologie générale et sociologie politique » du programme. Le but de ce chapitre est de montrer le lien entre l’individu et la société, l’individuel et le collec- tif, par l’intermédiaire de l’inscription des indi- vidus dans des groupes sociaux. La notion de groupes sociaux est conçue par le programme de manière très large et interroge donc sur les groupes comme « catégories », qu’elles soient observées ou saisies par les statistiques. Lorsque l’on parle de « groupes », peut-on considérer seulement que l’on a classé les individus selon certains critères (1re double page) ? En allant plus loin, on peut s’interroger sur la réalité plus profonde de ces groupes, et réfléchir à la manière dont les indi- vidus peuvent se sentir appartenir à un groupe, que cette appartenance soir réelle ou souhaitée (2e double page). Enfin, on peut se demander comment se différencient les différents groupes sociaux (3e double page). Le sujet proposé en fin du chapitre est une épreuve composée, avec les trois exercices de type Bac. La première partie propose deux questions de mobi- lisation des connaissances qui permettent de réin- vestir les notions et connaissances abordées dans le chapitre en développant une réponse argumen- tée. La deuxième partie est une étude de document et interroge sur la maîtrise des outils statistiques (lecture de proportions, sélection et comparai- son de données). Enfin, la troisième partie est le raisonnement s’appuyant sur un dossier documen- taire, destinée à s’entraîner à la construction d’un raisonnement argumenté et structuré, qui mobilise les connaissances, théories et mécanismes relatifs au chapitre. ◗ ◗Liens avec d’autres chapitres Les liens avec les autres chapitres de la socio- logie générale sont assez évidents : il va de soi que ce chapitre s’inscrit dans le prolongement du chapitre 11 puisque, par essence, la socialisation est l’apprentissage de la vie en société qui passe inévitablement par le « groupe » social, même si la forme des groupes diffère. Ainsi, nous avions dans le chapitre 11 plusieurs documents sur la famille, le groupe scolaire, le groupe d’appartenance religieuse, le groupe des pairs, les groupes professionnel et social. On peut donc s’y référer à nouveau, en insistant davantage sur la réalité et la structure de ces groupes. Il est aussi très important de le relier aux chapitres 13 et 14 puisque la considération des individus appartenant à des groupes sociaux aux attributs spécifiques est aujourd’hui relayée par une repré- sentation de la société sous forme de réseaux : une réflexion sur la structure de la société par attributs ou par trajectoires peut être menée avec les élèves lorsque le chapitre 12 aura été bien compris. Le lien avec le chapitre 14 est également important puisque souvent les phénomènes de déviance renvoient à la transgression de la norme d’un groupe. Enfin, on pourra faire le lien avec le chapitre de sociologie politique au travers de l’appartenance citoyenne à l’État et à la nation (chapitre 15). ◗ ◗Réponses aux questions Ouverture de chapitre › › MANUEL, PAGES 210-211 Doc. 1 – Diplômés de l’Université d’Harvard en 2010 Doc. 2 – Une photo de famille • Comparez la situation des individus des documents 1 et 2. Dans le document 1, il s’agit des étudiants de la promotion 2010 d’Harvard. Les liens les unis- sant sont plus lâches et peut être moins appelés à s’inscrire dans la durée que dans la famille (père- mère-enfants sur le doc. 2), où les liens affectifs sont très forts et durables. • Caractérisez les relations qui existent entre les individus sur chaque photographie. Les caractéristiques des groupes sociaux › › MANUEL, PAGES 210-223 CHAPITRE 12 160 • © Nathan, 2015 – SES 1re ES - coll. C.-D. Échaudemaison On peut utiliser le mot « groupe » dans les deux cas. Dans le premier cas, il s’agit d’un groupe dont les individus sont reliés par le fait d’appartenir à la même promotion d’une université prestigieuse. Le sentiment d’appartenance peut être fort. Les liens du groupe familial sont pérennes, fondés sur de multiples points communs structurant des champs très étendus de la vie. Doc. 3 – L’habit fait-il le moine ? • Selon vous, à quel groupe social ces hommes semblent-ils appartenir ? La photographie représente 6 personnes (5 hommes et une femme) avec en arrière-plan les buildings de Manhattan. Les hommes portent des costumes et la cravate. Cette tenue laisse à penser que ces individus appartiennent au groupe social des cadres. Ce sont des analystes financiers d’une grande banque d’investissement dans le film Margin Call. 1. Qu’est-ce qu’un groupe social ? › › MANUEL, PAGES 212-213 Découvrir – Les lycéens sont-ils un groupe social ? a. Que font ces jeunes ? Il s’agit de lycéens en train de consulter l’affichage des résultats au Baccalauréat. b. Ces personnes se connaissent-elles ? Certaines de ces personnes se connaissent sans doute, si elles appartenaient à la même classe de Terminale. Mais tous les élèves de Terminale ne se connaissent pas forcément. Dans ce cas, leur interaction est faible et se borne à des conversa- tions autour des résultats. c. Peuvent-elles constituer un groupe social ? Elles constituent un groupe social par leur appar- tenance à une classe d’âge, la conscience de faire partie d’un ensemble (ceux qui ont réussi le Baccalauréat). Doc. 1 – Les habitants de Saint-Pol 1. Lire. Qu’est-ce qui caractérise l’unité des habitants de Saint-Pol ? Les Saint-Polais partagent certains points de vue : « même culte », « même terreur des mêmes idées », « même curiosité des mêmes détails ». Il y a donc une « unité ». 2. Décrire. Quels individus particuliers l’auteur décrit-il ? Il décrit des « ouvriers », un « militaire », « quelques vieilles dévotes », les musiciens d’un « orphéon ». 3. Expliquer. Que signifie la phrase soulignée ? Le métier du sociologue est d’observer la société puis de trouver des régularités et de les classer (cf. les « hordes » de Durkheim dans Les Règles de la méthode sociologique). La phrase signifie qu’en observant l’orphéon, les dévotes, les ouvriers, le militaire, etc., le sociologue fait des groupes avec des critères d’appartenance d’ordre professionnel, culturel, religieux, etc. 4. Déduire. Que signifie la dernière phrase du texte ? La société de Saint-Pol est faite de nombreux petits groupes sociaux (de natures différentes) qui ont leurs spécificités et en même temps se superposent, créant le tissu social de la ville. Doc. 2 – Population en emploi selon le sexe et la CSP en 2012 5. Lire. Rédigez une phrase présentant les informations apportées par les données en rouge. Selon l’Enquête emploi de l’Insee, les agriculteurs exploitants représentaient 2 % de l’ensemble de la population en emploi en 2012. Environ un tiers des hommes actifs ayant un emploi (32,1 %) était ouvrier en 2012. 6. Illustrer. Citez deux métiers pour les CSP « Professions intermédiaires » et « Employés ». Professions intermédiaires : infirmière, psycho- logue scolaire, instituteur, technicien, etc. Employés : vendeur dans un magasin, secrétaire, assistante de gestion, etc. 7. Décrire. Quelle est la CSP dont la part est la plus importante ? Identifiez ses caractéristiques. La CSP la plus importante statistiquement aujourd’hui est la catégorie des employés. Ils représentent 28,1 % des actifs occupés aujourd’hui. Il s’agit d’une CSP fortement fémi- nisée (45,2 % des femmes actives appartiennent à cette catégorie), peu qualifiée et dont les emplois sont souvent à temps partiel. 8. Justifier. Quel est l’intérêt de répartir les individus au sein des CSP ? Les CSP constituent un outil pratique pour étudier la population française. Elles sont utilisées dans de nombreuses enquêtes et permettent d’étudier les comportements économiques, sociaux ou démo- graphiques des individus. Il s’agit d’une simpli- fication du réel. © Nathan, 2015 – SES 1re ES - coll. C.-D. Échaudemaison • 161 Doc. 3 – Les classes d’âge : un groupe social ? 9. Analyser. Pourquoi peut-on dire que les classes d’âge dans la société Masaï constituent des groupes sociaux ? Les classes d’âge dans la société Masaï consti- tuent des groupes sociaux car chaque classe d’âge a ses normes de comportements, ses droits et ses devoirs. Les hommes passent successivement dans cinq classes d’âge : enfants, jeunes guerriers, guer- riers adultes, jeunes aînés puis aînés. Le passage d’une classe à l’autre est accompagné de rites initiatiques, qui marquent le changement d’ap- partenance. Ce sont les anciens qui prennent les décisions pour l’ensemble du groupe. 10. Justifier. En France, l’INSEE répartit la population en tranches d’âge (0-19 ans, 20-59 ans, etc.). Selon vous, la tranche 20-59 ans constitue-t-elle un groupe social ? 20 ans est l’âge à partir duquel la moitié seule- ment d’une tranche d’âge est scolarisée : 78 % le sont à 18 ans, 64 % à 19 ans et 51 % à 20 ans (Insee). 59 ans révolus correspondent à l’âge légal de la retraite, même si les récentes mesures le prolongent de fait. Cela uploads/Finance/ ch12-livprof 1 .pdf
Documents similaires







-
38
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 17, 2022
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 0.7468MB