eduscol.education.fr/ - Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse -
eduscol.education.fr/ - Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse - Juin 2019 1 Retrouvez éduscol sur : VOIE GÉNÉRALE Enseignement cinéma-audiovisuel 1re VOIE GÉNÉRALE Sciences économiques et sociales 1re Sciences économiques et sociales 2DE 1RE TLE Informer et accompagner les professionnels de l’éducation ENSEIGNEMENT SPÉCIALITÉ VOIE GÉNÉRALE COMMENT LES MARCHÉS IMPARFAITEMENT CONCURRENTIELS FONCTIONNENT-ILS ? Problématique d’ensemble Le marché n’est pas toujours constitué d’une multitude d’offreurs n’ayant aucune relation directe entre eux. Il existe des situations dans lesquelles quelques entreprises se partagent le marché (ces entreprises peuvent même nouer entre elles des ententes illicites), voire qu’une seule entreprise est présente sur le marché. Quand le marché est imparfait, le niveau du prix est supérieur à celui qui résulterait de la concurrence et le niveau de production est inférieur à celui qui résulterait de la concurrence ; le surplus du consommateur est donc réduit. La politique de la concurrence, en régulant les fusions-acquisitions et en luttant contre les ententes illicites et les abus de position dominante, permet donc d’augmenter le surplus du consommateur. Les objectifs d’apprentissage des élèves sont strictement définis par les programmes. Cette fiche pédagogique, à destination des professeurs, vise à les accompagner dans la mise en œuvre des nouveaux programmes. Sans prétendre à l’exhaustivité, ni constituer un modèle, chaque fiche explicite les objectifs d’apprentissage et les savoirs scientifiques auxquels ils se rapportent, suggère des ressources et activités pédagogiques utilisables en classe et propose des indications bibliographiques. Objectifs d’apprentissage • Comprendre, à l’aide d’exemples, les principales sources du pouvoir de marché (nombre limité d’offreurs, ententes et barrières à l’entrée). • Comprendre que le monopole est faiseur de prix et être capable de donner des exemples de monopoles (monopole naturel, institutionnel et d’innovation). • Comprendre, à l’aide de représentations graphiques et/ou d’un exemple chiffré, que l’équilibre du monopole n’est pas efficace. • Comprendre ce qu’est un oligopole et, à l’aide du dilemme du prisonnier, pourquoi les firmes ont intérêt à former des ententes. • Comprendre que la politique de la concurrence, en régulant les fusions-acquisitions et en luttant contre les ententes illicites et les abus de position dominante, augmente le surplus du consommateur. eduscol.education.fr/ - Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse - Juin 2019 2 Retrouvez éduscol sur : VOIE GÉNÉRALE Enseignement cinéma-audiovisuel 1re VOIE GÉNÉRALE Sciences économiques et sociales 1re Savoirs scientifiques de référence [Cette partie est dédiée aux savoirs scientifiques ; il ne s’agit pas d’un cours à destination des élèves qui devrait contenir davantage d’illustrations concrètes (voir les ressources et activités pédagogiques)] Le marché concurrentiel est un modèle théorique : la réalité s’en éloigne donc régulièrement et présente des situations de concurrence imparfaite. Ainsi, les marchés sont souvent dominés par un nombre réduit d’offreurs (le marché des producteurs d’avions gros-porteurs est ainsi pratiquement dominé par deux entreprises, Airbus et Boeing), et certaines entreprises s’entendent pour fixer les prix et les niveaux de production. Les situations de concurrence imparfaite, telles qu’illustrées dans les exemples précédents, sont des situations dans lesquelles les agents disposent d’un certain pouvoir de marché. Ce dernier peut donc se définir comme la capacité, pour un agent, à influencer la fixation du prix. Le pouvoir de marché peut trouver son origine, notamment, dans le nombre limité d’offreurs, les barrières à l’entrée ou les ententes, ces trois situations n’étant pas sans lien. Nombre limité d’offreurs Une entreprise en monopole ou quelques entreprises en situation d’oligopole sont en position d’influencer le prix de marché. Dans la situation extrême du monopole, la firme est en mesure de fixer son prix (elle opte pour une combinaison prix / niveau de production) ; dans la situation d’oligopole, les firmes se font concurrence mais prennent chacune des décisions en réaction aux décisions des autres et affectent ainsi le prix de marché. Barrières à l’entrée Elles correspondent à une situation dans laquelle l’hypothèse de libre entrée (et de libre sortie) n’est pas respectée. Dans ces conditions, il est coûteux, pour un agent d’entrer sur le marché en raison de barrières qui peuvent être directement liées aux caractéristiques du marché (par exemple, nécessaire maîtrise d’une technologie de production particulière ou accès limité à certaines ressources, présence de coûts élevés voire irrécupérables générés par des investissements lourds à l’instar de ceux qu’imposent une industrie de réseau) ou liées à des pratiques délibérées des entreprises cherchant à préserver leurs profits (baisse temporaire des prix pour dissuader un éventuel concurrent à entrer sur le marché, par exemple). Ententes Elles correspondent à des accords généralement secrets et illicites entre quelques entreprises. Celles-ci, en adoptant un accord portant sur les prix ou sur la répartition géographique du marché, par exemple, se rapprochent d’une situation de monopole. Ces ententes ont pour conséquence le renforcement du pouvoir de marché des entreprises qui les concluent dans la mesure où elles peuvent imposer leurs conditions aux acheteurs. Comprendre, à l’aide d’exemples, les principales sources du pouvoir de marché (nombre limité d’offreurs, ententes et barrières à l’entrée). eduscol.education.fr/ - Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse - Juin 2019 3 Retrouvez éduscol sur : VOIE GÉNÉRALE Enseignement cinéma-audiovisuel 1re VOIE GÉNÉRALE Sciences économiques et sociales 1re Le monopole est une entreprise fournissant à elle seule la totalité de la production sur un marché : il y a donc un offreur qui produit un bien sans substituts proches. Le monopole est donc en mesure a priori de fixer son prix au-dessus du niveau concurrentiel. Seul producteur sur le marché, le monopole est « faiseur de prix » par opposition aux agents présents sur un marché de concurrence parfaite qui sont « preneurs de prix ». Un monopole peut avoir plusieurs origines : on peut ainsi distinguer le monopole d’innovation, le monopole naturel et le monopole institutionnel. Le monopole naturel est fondé sur l’existence de coûts fixes très élevés qui rendent nécessaire un volume de production très important pour que les coûts unitaires ne soient pas trop élevés. Dans ces conditions, une seule entreprise se retrouve sur le marché. Les industries de réseau (transport ferroviaire, électricité, télécommunication) sont un exemple traditionnel de monopoles naturels. Un monopole peut également être un monopole institutionnel, institué par l’État qui a concédé à une entreprise le monopole de la production ou de la distribution d’un bien ou d’un service. Par exemple, en France, à partir de la fin des années 1990, La Poste a perdu progressivement le monopole de la distribution de courrier. La vente au détail des tabacs manufacturés reste un monopole confié par l’État français aux débitants de tabac. Un monopole peut également être un monopole d’innovation qui permet à l’entreprise qui la met en œuvre de maintenir une avance sur ses concurrents parce qu’elle est plus efficace pour produire. L ’innovation peut également être une innovation de produit. Le monopole d’innovation est temporaire dans la mesure où l’entreprise innovante sera rapidement imitée. La protection par des brevets permet de prolonger la position de monopole. Un brevet confère à son propriétaire un droit exclusif d’exploitation de l’innovation ; celui-ci est temporaire dans la mesure où la durée d’un brevet est limitée dans le temps (au plus 20 ans). Par exemple, Nestlé a déposé près de 1 700 brevets autour de la capsule et la machine Nespresso. Sur un marché de concurrence parfaite, la demande de marché est une fonction décroissante du prix mais la demande s’adressant à chaque entreprise est potentiellement infinie : tant qu’elle ne s’éloigne pas du prix de marché, chacune peut vendre autant qu’elle le souhaite. Dans cette situation, le prix de marché correspond à la recette marginale de chaque entreprise qui choisit de produire la quantité qui maximise le profit, ce qui revient à la règle d’égalisation du prix (et donc de la recette marginale) au coût marginal : Rm (= P) = Cm. En tant qu’unique producteur sur le marché, l’entreprise en situation de monopole fait face à la totalité de la demande de marché, fonction décroissante du prix. Cette relation implique un écart entre le prix de vente et la recette marginale : le monopole est obligé de baisser le prix de vente s’il veut vendre une unité supplémentaire (et le choix de produire et vendre une unité supplémentaire implique la réduction du prix de toutes les unités vendues). Comme le montre l’exemple chiffré suivant, la recette marginale est décroissante et toujours inférieure au prix de vente. Comprendre à l’aide de représentation graphique et/ou d’un exemple chiffré, que l’équilibre du monopole n’est pas efficace. Comprendre que le monopole est faiseur de prix et être capable de donner des exemples de monopoles (monopole naturel, institutionnel et d’innovation). eduscol.education.fr/ - Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse - Juin 2019 4 Retrouvez éduscol sur : VOIE GÉNÉRALE Enseignement cinéma-audiovisuel 1re VOIE GÉNÉRALE Sciences économiques et sociales 1re Prix Quantité (vendue et donc produite) Recette totale (PxQ) Recette marginale 10 1 10 10 9 2 18 8 8 3 24 6 7 4 28 4 6 5 30 2 5 6 30 0 4 7 28 -2 3 8 24 -4 2 9 18 -6 1 10 10 -8 Le uploads/Finance/ comment-les-marches-imparfaitement-concurrentiels-fonctionnent-ils 1 .pdf
Documents similaires







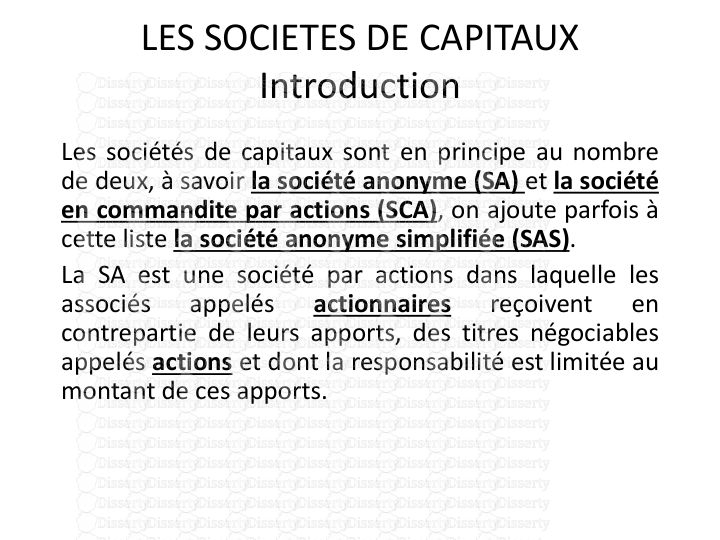
-
76
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 21, 2021
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 0.3544MB


