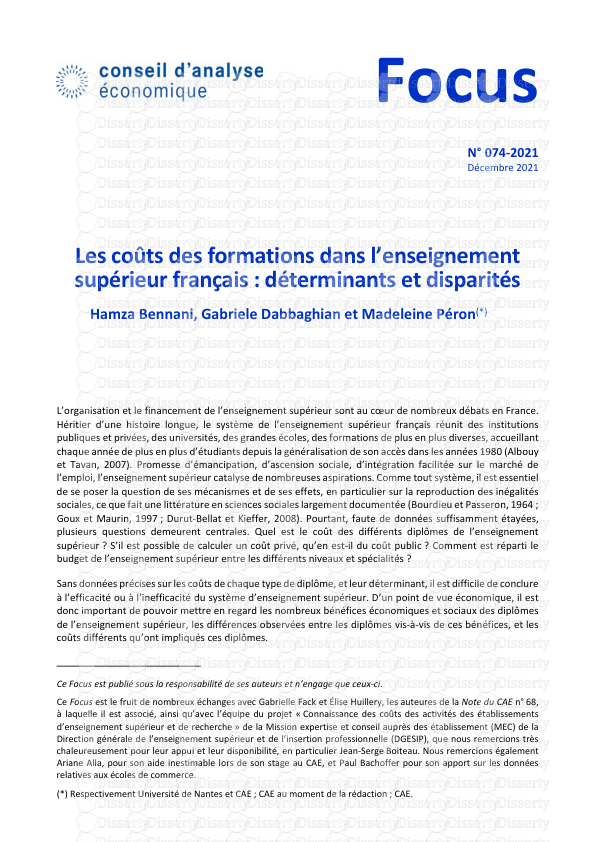Focus N° 074‐2021 Décembre 2021 Les coûts des formations dans l’enseignement su
Focus N° 074‐2021 Décembre 2021 Les coûts des formations dans l’enseignement supérieur français : déterminants et disparités Hamza Bennani, Gabriele Dabbaghian et Madeleine Péron(*)(1) L’organisation et le financement de l’enseignement supérieur sont au cœur de nombreux débats en France. Héritier d’une histoire longue, le système de l’enseignement supérieur français réunit des institutions publiques et privées, des universités, des grandes écoles, des formations de plus en plus diverses, accueillant chaque année de plus en plus d’étudiants depuis la généralisation de son accès dans les années 1980 (Albouy et Tavan, 2007). Promesse d’émancipation, d’ascension sociale, d’intégration facilitée sur le marché de l’emploi, l’enseignement supérieur catalyse de nombreuses aspirations. Comme tout système, il est essentiel de se poser la question de ses mécanismes et de ses effets, en particulier sur la reproduction des inégalités sociales, ce que fait une littérature en sciences sociales largement documentée (Bourdieu et Passeron, 1964 ; Goux et Maurin, 1997 ; Durut‐Bellat et Kieffer, 2008). Pourtant, faute de données suffisamment étayées, plusieurs questions demeurent centrales. Quel est le coût des différents diplômes de l’enseignement supérieur ? S’il est possible de calculer un coût privé, qu’en est‐il du coût public ? Comment est réparti le budget de l’enseignement supérieur entre les différents niveaux et spécialités ? Sans données précises sur les coûts de chaque type de diplôme, et leur déterminant, il est difficile de conclure à l’efficacité ou à l’inefficacité du système d’enseignement supérieur. D’un point de vue économique, il est donc important de pouvoir mettre en regard les nombreux bénéfices économiques et sociaux des diplômes de l’enseignement supérieur, les différences observées entre les diplômes vis‐à‐vis de ces bénéfices, et les coûts différents qu’ont impliqués ces diplômes. Ce Focus est publié sous la responsabilité de ses auteurs et n’engage que ceux‐ci. Ce Focus est le fruit de nombreux échanges avec Gabrielle Fack et Élise Huillery, les auteures de la Note du CAE n° 68, à laquelle il est associé, ainsi qu’avec l’équipe du projet « Connaissance des coûts des activités des établissements d’enseignement supérieur et de recherche » de la Mission expertise et conseil auprès des établissement (MEC) de la Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle (DGESIP), que nous remercions très chaleureusement pour leur appui et leur disponibilité, en particulier Jean‐Serge Boiteau. Nous remercions également Ariane Alla, pour son aide inestimable lors de son stage au CAE, et Paul Bachoffer pour son apport sur les données relatives aux écoles de commerce. (*) Respectivement Université de Nantes et CAE ; CAE au moment de la rédaction ; CAE. (1) 2 Les coûts des formations dans l’enseignement supérieur français : déterminants et disparités L’information sur le coût des diplômes est peu répandue en France. Pour pallier cette absence de données, nous nous sommes appuyés sur un projet mené au sein du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MESRI), le projet « Connaissance des coûts des activités des établissements d’enseignement supérieur » (P2CA). Il en résulte un ensemble de données quantitatives original et à notre connaissance inédit(1), sur lequel nous avons construit l’étude approfondie des coûts publics de plusieurs dizaines de formations dispensées dans les établissements d’enseignement supérieur rattachés au MESRI classées selon le niveau et la spécialité du diplôme. Les analyses présentées dans ce Focus concernent un échantillon représentatif des établissements publics rattachés au MESRI, mais un des défis futurs pour une connaissance approfondie des dépenses en formations du supérieur sera de compléter ces données avec les formations non contenues dans le projet initial (écoles privées, formations gérées par les conseils régionaux et départementaux, etc.). Toutefois, sur la base des données disponibles, nous montrons un différentiel important des dépenses publiques en fonction des formations. D’un point de vue descriptif, les diplômes du type DUT et écoles d’ingénieur sont parmi les plus onéreux, tandis que les licences et master sont peu coûteux. Les diplômes de sciences sociales, de droit, des domaines littéraires sont moins coûteux que les diplômes des domaines scientifiques, techniques et technologiques. Plus important encore, nous observons de fortes variations d’un établissement à l’autre des coûts déclarés pour une même formation. En menant plusieurs analyses descriptives et économétriques, nous tentons également de comprendre les principaux déterminants de ces différentiels de coût : il apparaît alors que le taux d’encadrement (i.e. le nombre d’enseignants‐chercheurs pour 100 étudiants) ainsi que le nombre d’heures (i.e. le nombre d’heures d’enseignement), qui reflètent l’investissement général dans la formation et l’intensité du modèle pédagogique en termes d’accompagnement, expliquent une grande partie des variations observées. 1. Les dépenses d’éducation en France sont dans la moyenne des pays de l’OCDE… Les dépenses de l’enseignement supérieur en France sont régulièrement au cœur du débat public car elles sont considérées comme étant insuffisantes par rapport à celles de pays ayant un niveau de richesse similaire. Il apparaît donc important de commencer cette analyse par une mise en perspective des dépenses d’enseignement supérieur par rapport à celles des pays de l’OCDE. À cette fin, on mobilise les données de l’OCDE qui couvrent l’ensemble des pays membres sur la période 1995‐2015. On observe que la dépense moyenne d’éducation en % du PIB pour la période 2005‐2015 (graphique 1) montre des disparités importantes dans le financement de l’éducation parmi les pays de l’OCDE. Avec un niveau de dépense presque égale à 1,5 %, la France se situe juste au‐dessus de la moyenne des pays de l’OCDE (1,4 %). Néanmoins, cet indicateur peut cacher de grandes disparités compte tenu des situations démographiques différentes d’un pays à l’autre, notamment la pyramide des âges. Pour remédier à cela, on a recours à la dépense moyenne d’éducation en dollars par étudiant. Le graphique 2 montre qu’avec un tel indicateur, le classement de la France ne change pas : elle se trouve à un niveau légèrement supérieur à la dépense moyenne des pays de l’OCDE. Vis‐à‐vis des autres pays européens comparables, elle se situe dans une position intermédiaire, en deçà de l’Allemagne, des Pays‐Bas et des pays nordiques, mais au‐dessus de l’Espagne et de l’Italie. (1) Il est à noter que Zuber (2004) offrait déjà un premier panorama des coûts des formations en France. Nous n’avons pas eu connaissance, à ce jour, d’autres travaux permettant un découpage aussi fin des niveaux de diplômes et de spécialités. 3 Les coûts des formations dans l’enseignement supérieur français : déterminants et disparités Graphique 1. Dépenses moyennes d’enseignement supérieur en pourcentage du PIB (2005‐2015) Lecture : La France a consacré en moyenne 1,5 % de son PIB aux dépenses d’enseignement supérieur sur la période 2005‐2015. Source : OCDE (2021). Graphique 2. Dépenses moyennes d’enseignement supérieur par étudiant (en dollars 2018) (2005‐2015) Lecture : D’après l’OCDE, la dépense moyenne d’enseignement supérieur par étudiant s’élève à 17 000 dollars entre 2005 et 2015. Source : OCDE (2021). 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 4 Les coûts des formations dans l’enseignement supérieur français : déterminants et disparités Un autre élément susceptible de différencier les pays de l’OCDE dans le financement de l’éducation est la répartition entre dépense publique et dépense privée. En effet, la prise en charge des dépenses d’éducation se fait par la collectivité publique, les ménages et des entités privées selon une répartition qui varie en fonction des pays. Le graphique 3 montre la prépondérance de la dépense publique par rapport à la dépense privée en France, contrairement aux pays d’Europe du Sud ou la dépense privée représente plus du tiers de la dépense d’éducation. Graphique 3. Répartition des dépenses part publique/privée Lecture : La dépense totale d’enseignement supérieur est assurée à 77 % par la puissance publique et la part privée de cette dépense représente 22 %. Source : OCDE (2021). 2. … mais montrent une tendance à la baisse face à l’augmentation du nombre d’étudiants Graphique 4. Évolution de la dépense intérieure d’éducation (DIE), des effectifs et de la dépense moyenne par étudiant dans l’enseignement supérieur Lecture : Les effectifs de l’enseignement supérieur ont augmenté de 120 % entre 1980 et 2019. Source : MNJS‐MESRI‐DEPP, Compte de l’éducation. 0 20 40 60 80 100 Autres Part de dépenses privées Part de dépenses publiques 100 120 140 160 180 200 220 240 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Base 100 en 1980 300 280 260 OCDE Effectifs de l'enseignement supérieur DIE de l'enseignement supérieur Dépense moyenne par étudiant 5 Les coûts des formations dans l’enseignement supérieur français : déterminants et disparités Il existe très peu d’informations détaillées concernant la différence de dépenses dans les formations de l’enseignement supérieur. Plusieurs estimations coexistent jusqu’à maintenant, basées principalement sur la division de budgets globaux en fonction du nombre de formations et d’étudiants. La publication du Compte de l’éducation sur une base annuelle permet de rendre compte de la part de la dépense intérieure consacrée au système éducatif, de son évolution et de sa répartition selon plusieurs indicateurs, notamment la dépense moyenne par étudiant des premières classes au supérieur (graphique 5). Ces chiffres donnent une première idée de l’hétérogénéité des dépenses, et donc potentiellement des coûts, associés uploads/Finance/ focus-les-couts-des-formations-dans-l-x27-enseignement-superieur-francais-determinants-et-disparites.pdf
Documents similaires










-
22
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 16, 2022
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 1.5840MB