Le véhicule électrique É L E C T R I C I T É - É L E C T R O N I Q U E Sommaire
Le véhicule électrique É L E C T R I C I T É - É L E C T R O N I Q U E Sommaire Présentation page 2 La batterie de traction page 4 Le moteur électrique de traction page 10 Le confort page 16 Les interventions sur circuits électriques page 19 Conclusion page 20 Annexe page 21 Dossier technique A.N.F.A. « Le véhicule électrique » Edition 1997 2 Présentation Le véhicule électrique connu dès 1890 a été utilisé jusque dans les années trente, période à partir de laquelle le véhicule à moteur thermique le supplante en raison de son autonomie. Depuis 1980, le nombre de véhicules thermiques polluants, augmentent de façon importante ; des solutions de substitution sont envisagées pour les grandes villes. Les constructeurs de véhicules, de batteries, de moteurs électriques, groupent actuellement leurs efforts de recherche, pour répondre au cahier des charges dressés par les différents services de l’environnement des états de la communauté européenne. La Solution électrique répond doublement aux exigences de la circulation urbaine, par son absence de pollution gazeuse et de nuisance sonore Les solutions proposées Actuellement, trois solutions électriques existent et se différencient par leur chaîne de traction. Traction électrique classique C'est la solution la plus répandue. Elle est composée d'un groupe de batterie, d'une gestion électronique du courant et d'un moteur électrique. Le montage se fait sur véhicules légers de série, poids lourds, chariots élévateurs, tracteurs aérogares, Tracteurs de bagages SNCF et deux roues. batteries gestion moteur roues Dossier technique A.N.F.A. « Le véhicule électrique » Edition 1997 3 La traction bi-mode La traction thermique classique est utilisée hors des villes ; la traction électrique classique s'utilise en ville. moteur thermique boîte transfert roues batteries gestion moteur boîte transfert roues Le montage se fait sur poids lourds PONTICELLI INDUSTRIES. La traction hybride Il s'agit d'un groupe électrogène, entraîné par un moteur thermique ou par une turbine à gaz. Celui-ci produit du courant, qui recharge en permanence un groupe de batteries. Celles-ci débitent dans un moteur électrique de traction. En site urbain, le groupe est à l'arrêt et on recourt au moteur électrique. Actuellement chez PSA, il existe le prototype 406 V.E.R.T. (Véhicule Routier électrique à Turbine) dont la commercialisation est envisagée pour 2004. turbine Alternateur batteries gestion moteur roues Groupe électrogène Chaîne de traction 406 VERT.PSA. La présentation simplifiée du véhicule électrique que nous proposons ici, va permettre de se familiariser avec le fonctionnement des systèmes, le vocabulaire technique et de comparer les produits fabriqués actuellement. Dossier technique A.N.F.A. « Le véhicule électrique » Edition 1997 4 La batterie de traction La batterie de traction est un générateur électrochimique. Son principe de fonctionnement est identique à celui des batteries de démarrage, de servitude, et d’éclairage que nous connaissons. Toutefois, en raison de son aptitude à générer de très forts courants, pendant des durées importantes, il est très différent des autres batteries, par sa technologie de fabrication, sa gestion de charge et de décharge. Un générateur électrochimique stocke de l’énergie sous forme chimique et la restitue sous forme électrique. La construction Les constituants internes d’une batterie sont : l’électrode positive, l’électrode négative, l’isolant et l’électrolyte. Terminologie utilisée dans le domaine électricité Terminologie utilisée dans le domaine chimie Remarque électrode + ou plaque positive Corps oxydant ou corps susceptible d’être réduit électrode - ou plaque négative Corps réducteur ou corps susceptible d’être oxydé L’ensemble oxydant plus réducteur (plaque positive plus plaque négative) s’appelle couple électrochimique Exemples : Plomb-Oxyde de plomb ; Cadmium-Nickel ; Nickel-Fer ; etc... Isolant poreux Séparateur Isolant mécanique entre deux plaques, sa porosité permet le passage des ions Liquide électrolytique ou électrolyte Acide ou base ; liquide ou gel L’électrolyte participe ou ne participe pas à la réaction chimique suivant les couples, mais dans tous les cas assure la conduction ionique Dossier technique A.N.F.A. « Le véhicule électrique » Edition 1997 5 Le processus de décharge Pendant la décharge, la batterie est génératrice et débite du courant dans le moteur de traction. Pour permettre l’apparition d’un courant électrique, il est nécessaire que les électrons et les ions puissent circuler ; un récepteur va permettre la liaison entre l’électrode + et l’électrode -. Le principe de fonctionnement pendant la décharge est le suivant : le galvanomètre joue le rôle du récepteur et le déplacement de son aiguille prouve le passage du courant... La batterie se décharge... Il est rappelé que l’intensité est proportionnelle à la quantité d’électrons déplacés et à la quantité de matière mise en œuvre. Une batterie chargée possède un excès d’électrons à sa plaque négative et un manque d’électrons à sa plaque positive. Lorsque les deux plaques possèdent le même nombre d’électrons, la batterie ne débite plus de courant (on dit qu’elle est " à plat "). Le processus de charge Pendant la charge, la batterie est réceptrice du courant fourni par le secteur. Le procédé est l’inverse de la décharge. Un générateur de courant (dynamo, chargeur) est placé aux bornes des électrodes et débite en sens inverse dans le système. Il va permettre de déplacer les électrons de la plaque positive vers la plaque négative et redonner à la batterie son état initial. Pendant la charge, le courant circule en sens inverse. Le galvanomètre dévie dans le sens inverse à celui de la recharge. L’intensité et la quantité de matière déplacée est toujours proportionnelle au nombre d’électrons en mouvement. Lorsque la plaque négative est en excès d’électrons, la batterie est rechargée. L’utilisation du générateur électrochimique s’effectue en deux phases, la charge et la décharge. À l’intérieur de la batterie, l’énergie chimique se manifeste par un transfert de matière grâce à une circulation d’ions. À l’extérieur de la batterie, l’énergie électrique se manifeste par un déplacement d’électrons. La réaction chimique fait apparaître deux autres phénomènes gênants : un dégagement de gaz et une montée en température. Dossier technique A.N.F.A. « Le véhicule électrique » Edition 1997 6 Les chargeurs Pendant la charge, la batterie se comporte comme un récepteur de courant. Cette phase de fonctionnement obéît à des valeurs limites à ne jamais dépasser pour : - la tension ; - l’intensité ; - le temps ; - la température ; - le dégagement gazeux. Pour répondre à ces besoins, il existe pour chaque type de batterie un chargeur adapté. - le chargeur embarqué pour les véhicules légers et les 2 roues (220V ~ 15 A alimentation secteur) ; - le chargeur stationnaire pour les poids lourds et véhicules industriels (380V ~ 20 A et plus, alimentation triphasée). Ces chargeurs sont pilotés par un micro processeur. Ils s’adaptent automatiquement aux besoins de la batterie en restant dans les valeurs permises. La coupure s’effectue automatiquement en fin de charge. Les bornes de rechargement en site urbain Les borne en parking sont accessibles grâce à une carte à puce. Elles permettent d’effectuer une recharge de jour et de nuit, sur un site en plein air ou souterrain. Il en existe très peu actuellement. Leur développement est lié à l’évolution du véhicule électrique. Quelques parkings sont déjà équipés dans les grandes villes et sites pilotes. Les bornes de recharge rapide sont situées en station service et permettent en cas de " panne sèche " de récupérer 20 Km d’autonomie en 20 mm (puissance de la borne 18 KVA). Ces bornes sont manœuvrées par le personnel de la station et sont la propriété exclusive du distributeur. Très peu existent actuellement. Dossier technique A.N.F.A. « Le véhicule électrique » Edition 1997 7 Comparaison des énergies L’examen de ce graphique permet de constater les difficultés rencontrées pour stocker une énergie équivalente à celle d’un hydrocarbure. Dossier technique A.N.F.A. « Le véhicule électrique » Edition 1997 8 Comparaison des technologies de fabrication Couples chimiques énergie massique Wh/kg tension nominale par élément Volt durée de vie en cycles et recharge recharge rapide T° de fonctionnement °C rendement recyclage et nocivité prix franc/kWh utilisation Plomb acide Pb- PbO2 30 à40 2 600 à 1200 occasionnel -20 à 60 68 oui 1000 Volta, 2 roues, chariot élévateur, poids lourds, servitudes SNCF et aéroports Nickel cadmium Ni-Cd 50 à 65 1,2 2000 oui -50 à 50 80 oui 4000 Peugeot : 100, 2 roues, Partner. Citroën : AX Saxo, Berlingo. Nickel hydrure métal Ni- MH 55 à 80 1,2 1500 non < 50 76 Essais : USA, Europe, Japon. Sodium soufre Na-Ci 80 à 120 2 1000 constante 350° 91 Essais : Europe. Lithium polymère Li-POE- MO2 150 3 500 non < 80 85 Essais : USA, France. Lithium carbone LiC-MO2 140 3,5 1200 oui -30 à 70 NC Essais : France Saft. Aluminium air Al-O2 250 2,75 Essais : USA. Zinc air Zn-O2 300 1,2 50 Essais : USA, Allemagne NC > non communiqué > informations non validées Dossier technique A.N.F.A. « Le véhicule électrique » Edition 1997 9 Le choix d'une batterie de traction La sélection d’une batterie se fait en fonction des critères suivants, par ordre d’importance : - énergie, poids (Energie/Massique) ; - recharge (Nombre de cycles) ; - durée de vie, prix uploads/Finance/ vehicule-electrique.pdf
Documents similaires


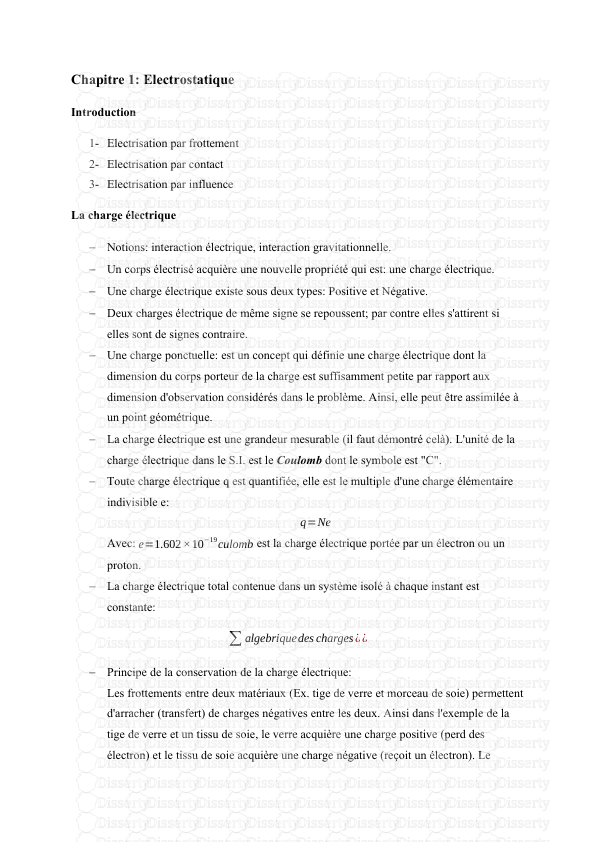






-
83
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 07, 2022
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 0.2740MB


