18HGMGMLR1 1/11 Baccalauréat Technologique Session 2018 *** Histoire-Géographie
18HGMGMLR1 1/11 Baccalauréat Technologique Session 2018 *** Histoire-Géographie Série : Sciences et Technologies du Management et de la Gestion EPREUVE DU MARDI 19 JUIN 2018 Durée : 2 heures 30 Coefficient : 2 Les calculatrices ne sont pas autorisées. Le candidat doit répondre à toutes les questions de la 1ère partie. 10 points Le candidat traitera au choix un seul des quatre exercices de la 2nde partie. 10 points Ce sujet comporte 11 pages numérotées de 1/11 à 11/11. La feuille Annexe page 11/11 est à rendre avec la copie d’examen. 18HGMGMLR1 2/11 PREMIÈRE PARTIE Questions d’histoire 1) Proposez une date pour la fin de la guerre froide et indiquez l’événement qui lui correspond. (1 point) 2) Complétez le croquis en annexe (page 11) et sa légende : - en nommant, sur le croquis, les deux anciennes colonies et, dans la légende, leur ancienne métropole - en indiquant les dates pour le premier figuré - en entourant, sur le croquis, le continent dont la plupart des pays ont été décolonisés entre 1955 et 1975. (3 points) 3) Citez le nom d’un président de la République française et de son Premier ministre (1 point) Questions de géographie 4) Proposez une définition de la notion d’interface. (1 point) 5) Justifiez l’affirmation suivante en proposant deux exemples : « La mondialisation met en relation les territoires par des flux de différentes natures ». (2 points) 6) Caractérisez la puissance culturelle de la France dans le monde. (2 points) 18HGMGMLR1 3/11 SECONDE PARTIE Le candidat traitera au choix un seul des quatre exercices. Exercices portant sur les sujets d’étude du programme d'histoire Exercice 1 / Sujet d’étude : Le Moyen-Orient et le pétrole. Document : La Guerre du Golfe et l’enjeu énergétique. Source : Discours du président américain George Bush au Congrès, le 11 septembre 1990. […] « L’Irak à lui seul possède environ 10 % des réserves pétrolières mondiales. L’Irak plus le Koweït en possèdent le double. Si on permettait à l’Irak d’absorber le Koweït, il aurait, en plus de l’arrogance, la puissance économique et militaire nécessaire pour intimider et forcer la main à ses voisins - des voisins qui ont la part du lion des réserves pétrolières du monde. Nous ne pouvons pas permettre qu’une ressource aussi essentielle soit dominée par un être aussi tyrannique1. Et nous ne le permettrons pas. Les récents évènements ont certainement montré qu’il n’existe pas de substitut au leadership américain. Face à la tyrannie, que personne ne doute de la crédibilité et du sérieux des Etats-Unis. Que personne ne doute de notre détermination. Nous défendrons nos amis. D’une façon ou d’une autre, le dirigeant de l’Irak doit apprendre cette vérité fondamentale. Dès le début, en agissant en étroite coopération avec d’autres, nous avons cherché à modeler la réponse la plus large possible à l’agression irakienne. La coopération internationale et la condamnation de l’Irak ont atteint un degré sans précédent. […] De concert avec nos amis et alliés, les bâtiments de la marine nationale des Etats- Unis patrouillent aujourd’hui dans les eaux du Moyen-Orient. Ils ont déjà intercepté plus de sept cents navires dans le cadre de l’application des sanctions. Trois dirigeants de la région avec lesquels j’ai parlé hier m’ont dit que ces sanctions donnaient des résultats. L’Irak commence à en sentir les effets. Nous continuons d’espérer que les dirigeants irakiens réévalueront le coût de leur agression. Ils sont coupés du commerce mondial. Ils ne peuvent plus vendre de pétrole. Et seule une proportion très faible des marchandises leur parvient. […] Pour aider à couvrir les frais, les dirigeants de l’Arabie Saoudite, du Koweït et des Emirats arabes unis se sont engagés à fournir à nos forces sur le terrain les vivres et le carburant dont elles ont besoin. Une aide généreuse sera également fournie aux vaillants pays de la ligne de front, tels que la Turquie et l’Egypte. […] Cette crise a également un coût sur le plan énergétique. Les pays producteurs de pétrole sont déjà en train de compenser la production perdue de l’Irak et du Koweït. Plus de la moitié des pertes ont été compensées. Nous obtenons une coopération superbe. Si les producteurs, dont les Etats-Unis, continuent de prendre des mesures en vue d’accroître la production de pétrole et de gaz, nous pourrons stabiliser les prix et garantir qu’il n’y aura pas de difficultés. En outre, plusieurs de nos alliés et nous- mêmes avons toujours la possibilité de tirer sur nos réserves stratégiques de pétrole, si les circonstances l’exigent. Comme je l’ai déjà souligné, il est essentiel de s’efforcer de maintenir à un niveau aussi faible que possible nos besoins d’énergie. 18HGMGMLR1 4/11 Nous devons ensuite tirer parti de toutes nos sources d’énergie : charbon, gaz naturel, énergie hydroélectrique et énergie nucléaire. Notre inaction sur ce plan nous a rendus plus dépendants que jamais du pétrole étranger. Enfin, que personne ne songe à profiter de cette crise. » 1 désigne Saddam Hussein, dirigeant de l’Irak. Questions : 1) Présentez le document en insistant sur son auteur et le contexte. 2) Montrez que la guerre du Golfe a des conséquences sur le marché mondial de pétrole. 3) Relevez les solutions évoquées par George Bush pour résoudre les problèmes d’approvisionnement en pétrole. 4) Expliquez le rôle que les Etats-Unis jouent pour leurs « amis et alliés » au Moyen-Orient, en précisant qui sont ces derniers. 5) Montrez que le pétrole fait du Moyen-Orient une région stratégique. 18HGMGMLR1 5/11 Exercice 2 / Sujet d’étude : l’Amérique latine. Document 1 : Le Brésil, leader de l’Amérique latine ? Source : Daniel Solano, Le Brésil et la coopération Sud-Sud : l’Amérique latine Prioritaire, publié le 13 mars 2010, www.diploweb.com À partir de l’acquis du Mercosur, le Brésil cherche à devenir discrètement le leader d’un ensemble sud-américain. Le 1er septembre 2000, se tient à Brasilia le premier sommet des chefs d’Etat ou de gouvernement d’Amérique du Sud. Le président Luiz Inácio Lula da Silva1, élu en 2002, va accentuer cette orientation et défendre ouvertement le concept de leadership (liderança) du Brésil dans la région. En même temps, la vieille revendication d’un siège permanent au Conseil de sécurité de l’ONU est à nouveau mentionnée, le Brésil se présentant comme un porte-parole des intérêts de l’Amérique latine. Le président Lula multiplie les contacts avec les chefs d’Etat de la zone et, en 2004, nait la Communauté sud-américaine des nations (Casa). Un pas supplémentaire est franchi en mai 2008 avec la création de l’Union des nations sud-américaines (Unasur) puis, en mars 2009, de son appendice2 militaire, le Conseil sud-américain de défense (CSD). Parallèlement, le Brésil fait preuve d’un moindre enthousiasme pour les négociations avec le Nord : l’administration Lula va faire capoter les négociations de la ZLEA3 en 2003-2004, tandis que l’accord d’association avec l’Europe s’enlise sans que Brasilia montre une farouche détermination à le relancer. Le Brésil prend bien soin de ne pas supplanter les États-Unis en Amérique du Sud et ne veut pas apparaître comme une nouvelle puissance dominatrice. Brasilia continue de refuser de s’immiscer dans les affaires intérieures des pays. Tout au plus, cherche-t-elle à se poser comme médiateur dans les crises. […] En aucun cas, elle ne cherche à imposer une solution par la force, ce dont au demeurant le Brésil n’a pas les moyens. Le Brésil ne cherche pas non plus à mettre en place de nouvelles institutions. Au sein du Mercosur, Brasilia s’accommode d’un dispositif très léger et peu contraignant. Lula, comme Fernando Henrique Cardoso4, s’est toujours montré réticent à mettre en place un schéma qui ressemblerait à celui de l’Union européenne avec, en particulier, un organisme équivalent à la Commission de Bruxelles. Le Brésil a toujours refusé une intégration qui supposerait une perte de souveraineté : la supranationalité est un mot tabou. L’Unasur ne dispose que d’un simple secrétariat. 1 Luiz Inácio Lula da Silva dit « Lula » est président du Brésil de 2003 (année de sa prise de fonction) à 2011. 2 ici signifie le prolongement. 3 ZLEA : Zone de Libre-Echange des Amériques. 4 Président du Brésil de 1995 à 2003. 18HGMGMLR1 6/11 Document 2 : La fondation de la Communauté d'Etats latino-américains et caribéens (Celac). Source : « Obama et l’Amérique latine se séparent » dessin de Bob Row, publié le 3 Janvier 2012, www.toonpool.com De gauche à droite : Barack Obama président des Etats-Unis, Hugo Chavez président du Venezuela, Christina Kirchner présidente de l’Argentine et Dilma Roussef présidente du Brésil. Questions : 1) Comment le Brésil cherche-t-il à devenir le leader des pays d’Amérique latine ? (Document 1 et document 2) 2) Comment le Brésil évite-t-il « d’apparaître comme une nouvelle puissance dominatrice »? (Document 1) 3) Décrivez et expliquez le document 2. 4) Montrez, qu’à la date des documents, l’influence croissante du Brésil remet en cause la domination traditionnelle des Etats-Unis en Amérique latine. 18HGMGMLR1 7/11 Exercices portant sur les sujets d’étude du programme de géographie Exercice n°3 /Sujet d’étude : Les engagements militaires et humanitaires de la France et des Français dans le monde. Document : L’engagement de la uploads/Geographie/ bac-stmg-2018-histoire-geo-sujet.pdf
Documents similaires

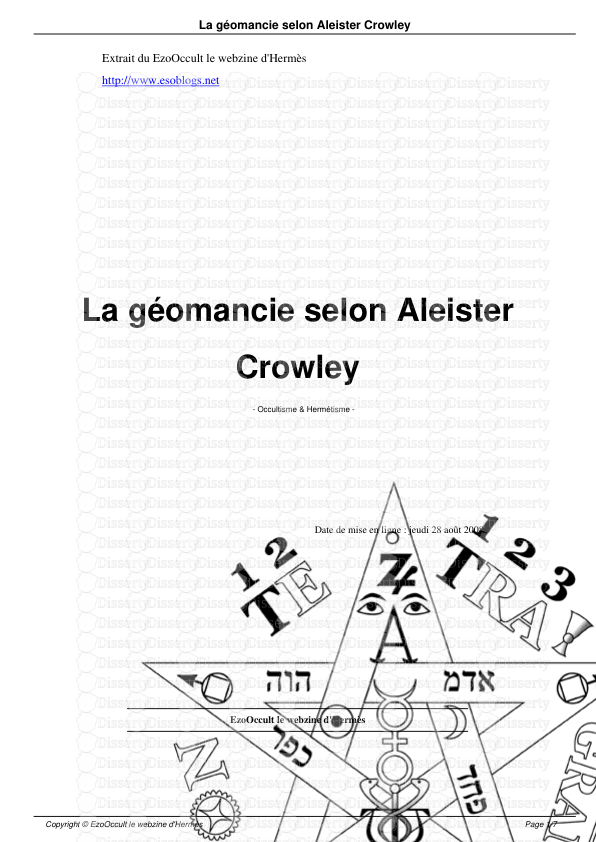








-
51
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 11, 2022
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1563MB


