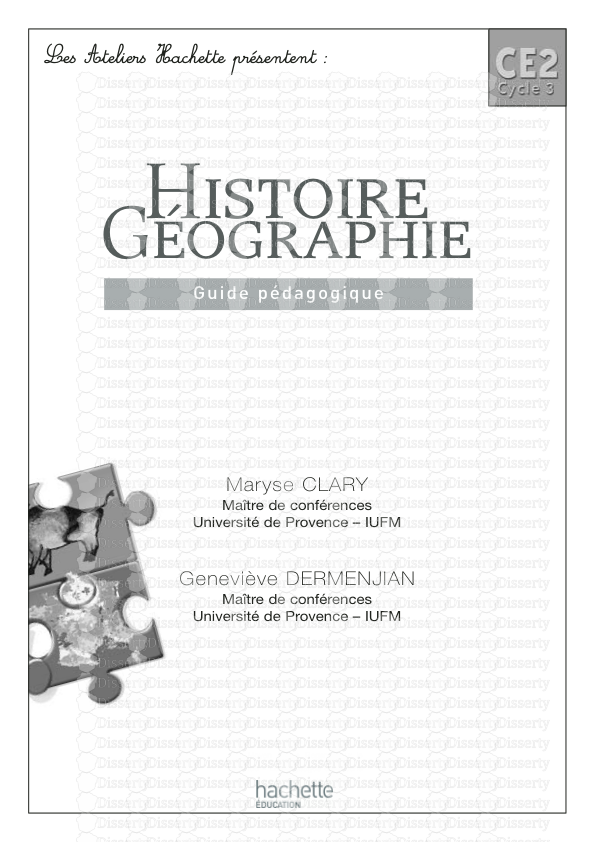L¥e∑ A¥telier∑ H¥achette présentent : La Préhistoire • L’Antiquité • Le Moyen Â
L¥e∑ A¥telier∑ H¥achette présentent : La Préhistoire • L’Antiquité • Le Moyen Âge • Regards sur le monde • Les paysages européens • Les paysages français Maryse CLARY Maître de conférences Université de Provence – IUFM Geneviève DERMENJIAN Maître de conférences Université de Provence – IUFM Histoire Géographie Guide pédagogique 2 Suivi éditorial : Claire MARCHANDISE Création de la maquette intérieure : Valérie GOUSSOT Création de la maquette de couverture : Laurent CARRÉ et Estelle CHANDELIER Illustration de la couverture : Alain BOYER Exécution de la couverture : TYPO-VIRGULE Mise en pages : TYPO-VIRGULE Recherche iconographique : Anne PEKNY Cartographie et frises chronologiques : Cartographie HACHETTE ÉDUCATION Crédits photographiques : Page 149 : Forum romain : la Voie sacrée, la place du Forum, au fond le temple d’Antonin et Faustine et le Colisée, © G. Dagli Orti. Illustration page 148 : Gilles POING ISBN : 978-2-01-117438-3 © HACHETTE LIVRE 2009, 43 quai de Grenelle, 75905 Paris Cedex 15. Tous droits de traduction, de reproduction et d’adaptation réservés pour tous pays. Le Code de la propriété intellectuelle n’autorisant, aux termes des articles L. 122-4 et L. 122-5, d’une part, que les « copies de reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d’autre part, que « les analyses et les courtes citations » dans un but d’exemple et d’illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite ». Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, sans autorisation de l’éditeur ou du Centre français de l’exploitation du droit de copie (20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris), constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal. 3 Avant-propos Ce guide pédagogique constitue le complément indispen- sable du manuel et du cahier d’exercices de l’élève de CE2. Il a été conçu pour faciliter le travail des enseignants et leur proposer des stratégies afin de guider les apprentissages des élèves et de leur permettre d’utiliser avec pertinence les documents d’histoire et de géographie du manuel. Le guide pédagogique et le cahier d’exercices sont des outils complémentaires du manuel : ils ont tous les trois été pen- sés comme un tout et sont étroitement imbriqués. Des orientations conformes aux nouveaux programmes Arrivés au cycle 3, les élèves doivent consolider les appren- tissages du cycle 2 portant sur la prise de conscience de la diversité des espaces et sur le passage du temps vécu au temps perçu et au temps historique. Cet apprentissage va consister en une approche disciplinaire plus spécifique : celle de la géographie qui « a pour objectifs de décrire et comprendre comment les hommes vivent et aménagent leurs territoires », et celle de l’histoire qui a pour but de « permettre aux élèves d’identifier et de caractériser sim- plement les grandes périodes qui seront étudiées au col- lège ». Comme le préconisent les nouveaux programmes 2008, « l’histoire et la géographie donnent des repères com- muns, temporels et spatiaux, pour commencer à compren- dre l’unité et la complexité du monde. Elles développent chez les élèves curiosité, sens de l’observation et esprit cri- tique ». Les deux disciplines contribuent ainsi à la consti- tution d’une culture citoyenne qui s’enrichira tout au long de la scolarité des élèves. Le programme de géographie porte sur « les réalités géo- graphiques locales », du milieu où vivent les élèves à leur région, et contribue, avec le programme de sciences, à l’éducation au développement durable. Le programme d’histoire « s’effectue dans l’ordre chronologique par l’usage du récit et de l’observation de quelques documents patrimoniaux ». L ’organisation du guide pédagogique Ce guide propose 36 séquences de classe en histoire et 36 en géographie qui correspondent au nombre d’heures ins- crites dans les programmes. Ces séquences correspondent : – aux pages méthodologiques (pages-outils) situées au début du manuel de l’élève, mais que l’on peut étudier de nouveau à n’importe quel moment de l’année sco- laire, lorsque cela s’avère nécessaire pour les apprentis- sages en cours ; – aux pages de « leçons » qui développent un thème pré- cis, l’enseignant ayant la liberté de concevoir son propre parcours en géographie ; – aux pages d’activités intitulées « Je suis… », plus ludiques (le ludique étant également vecteur de connaissances) ; – aux pages intitulées « Zoom sur... » qui permettent aux élèves de prendre conscience, en géographie, de quelques problèmes liés à leur environnement et d’agir en faveur d’un développement durable et d’avoir, en his- toire, « une rencontre sensible et raisonnée avec des œuvres considérées dans un cadre chronologique ». Le guide comporte quelques fiches méthodologiques à photocopier aux élèves (voir p. 148 à 160). L’enseignant pourra les utiliser quand cela s’avérera nécessaire. Contrairement aux fiches méthodologiques situées en début de manuel et qui demandent un travail oral ou, accessoirement, un petit travail écrit sur le cahier d’essai, ces fiches méthodologiques mettent l’accent sur l’écrit, comme le cahier d’exercices. Elles font parfois référence à des documents du manuel de l’élève qui sont alors utilisés non pas pour leur aspect informatif, mais comme support méthodologique. Proposition de séquences de travail Toutes les séquences se référant aux leçons et aux fiches méthodologiques présentent une organisation à peu près similaire : – une référence aux Instructions officielles, ce qui ancre bien les apprentissages dans les nouveaux programmes ; – des objectifs qui portent à la fois sur les connaissances factuelles à faire acquérir aux élèves, mais aussi sur des compétences méthodologiques, des savoir-faire et des comportements à mettre en place ; – des notions et des concepts qui sont les mêmes, de l’école élémentaire à l’Université, mais que les élèves abordent à des degrés d’expression, de compréhension et de maîtrise différents. Ces notions et ces concepts leur donnent des clés pour rendre intelligible leur époque. Cette rubrique permet également à l’élève de découvrir « un vocabulaire spécifique qu’il apprend à distinguer du vocabulaire courant et à utiliser avec précision » ; – le déroulement de la séquence présenté sous forme d’ac- tivités. Ces activités (observation, comparaison, mise en relation, réinvestissement…) prennent appui sur les documents et les textes présentés dans le manuel ; 4 – des éléments de synthèse sont proposés à l’enseignant pour éviter que les élèves n’engrangent que des connais- sances parcellaires, pour donner du sens à l’apprentis- sage et pour rendre cohérent le savoir acquis par les élèves ; – des prolongements interdisciplinaires sont proposés. Il s’agit de donner des pistes à l’enseignant afin de lui per- mettre de prolonger l’étude en cours et de montrer à l’élève la complémentarité des savoirs, évitant ainsi que ne se forme l’idée de savoirs indépendants les uns des autres ; – enfin, une rubrique, « Pour aller plus loin », propose des compléments d’informations sur un thème lié à la leçon. L’évaluation n’a pas fait l’objet d’un paragraphe à part puisque le cahier d’exercices permet à la fois d’évaluer l’élève en fonction des différents objectifs fixés et à l’ensei- gnant d’évaluer sa propre progression. Étude des documents Contrairement à une idée reçue et bien ancrée, le docu- ment ne parle pas de lui-même. Face à un document, l’ob- servateur s’interroge et recherche des éléments de réponse. C’est pourquoi, dans le manuel, chaque docu- ment est accompagné de quelques questions destinées à mieux le faire comprendre par l’élève. Les documents ont été choisis en fonction d’une problématique et de leur per- tinence pour des élèves de cycle 3. Ils ont tous un titre et un auteur, ils sont datés : autant de points qu’il faut travail- ler avec les élèves pour les initier à la lecture disciplinaire des documents. Dans le guide pédagogique, des éléments théoriques sont introduits au cours des activités pour montrer l’intérêt du document et permettre à l’enseignant de l’exploiter au mieux avec ses élèves. Le manuel est riche de plus de 300 documents iconogra- phiques et de textes, qui sont expliqués et commentés dans le guide pédagogique, afin de se conformer aux Instructions officielles. Ces dernières rappellent en effet qu’en géographie « la fréquentation régulière du globe, de cartes, de paysages est nécessaire ». En histoire, l’élève doit être capable d’identifier les traces du passé que l’his- torien appelle « sources » ou « documents », traces qui se sont considérablement diversifiées. Le recours à la diversité des sources – écrites et orales, vestiges… – per- met de choisir des documents adaptés au niveau des élèves. La grande diversité des documents présentés permet de faire entrer l’élève, à son niveau, dans une démarche d’his- torien et de géographe. Ce guide s’est efforcé de proposer une stratégie à l’enseignant pour « initier les élèves à la méthode du questionnement et leur apprendre progressi- vement à émettre des hypothèses et à privilégier la recherche du sens ». Au-delà du langage spécifique de chaque discipline, ont été introduits, dans le manuel et le cahier d’exercices, des textes d’écrivains, des poèmes, des textes publicitaires ainsi que d’autres langages qui uploads/Geographie/ dossier-histoire-geo-ce2.pdf
Documents similaires










-
64
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 06, 2021
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 1.6194MB