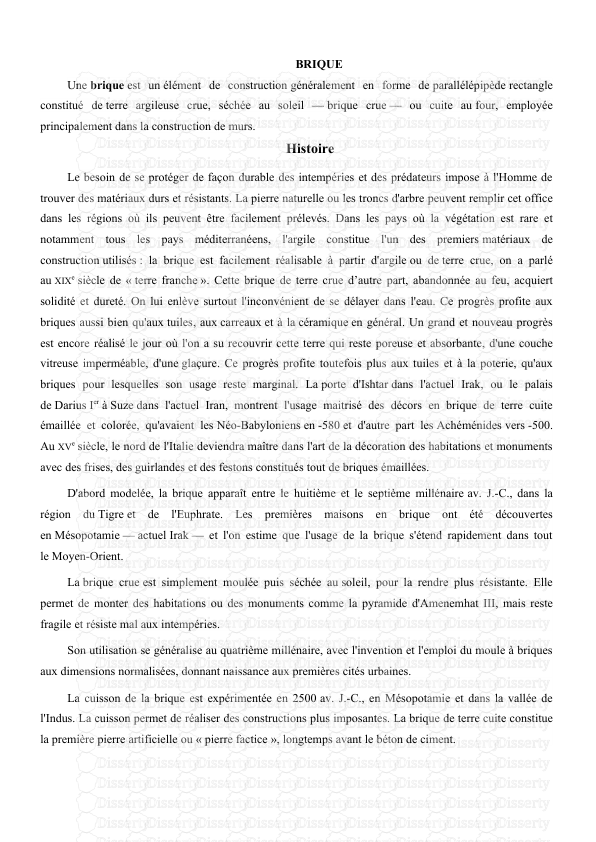BRIQUE Une brique est un élément de construction généralement en forme de paral
BRIQUE Une brique est un élément de construction généralement en forme de parallélépipède rectangle constitué de terre argileuse crue, séchée au soleil — brique crue — ou cuite au four, employée principalement dans la construction de murs. Histoire Le besoin de se protéger de façon durable des intempéries et des prédateurs impose à l'Homme de trouver des matériaux durs et résistants. La pierre naturelle ou les troncs d'arbre peuvent remplir cet office dans les régions où ils peuvent être facilement prélevés. Dans les pays où la végétation est rare et notamment tous les pays méditerranéens, l'argile constitue l'un des premiers matériaux de construction utilisés : la brique est facilement réalisable à partir d'argile ou de terre crue, on a parlé au XIXe siècle de « terre franche ». Cette brique de terre crue d’autre part, abandonnée au feu, acquiert solidité et dureté. On lui enlève surtout l'inconvénient de se délayer dans l'eau. Ce progrès profite aux briques aussi bien qu'aux tuiles, aux carreaux et à la céramique en général. Un grand et nouveau progrès est encore réalisé le jour où l'on a su recouvrir cette terre qui reste poreuse et absorbante, d'une couche vitreuse imperméable, d'une glaçure. Ce progrès profite toutefois plus aux tuiles et à la poterie, qu'aux briques pour lesquelles son usage reste marginal. La porte d'Ishtar dans l'actuel Irak, ou le palais de Darius Ier à Suze dans l'actuel Iran, montrent l'usage maitrisé des décors en brique de terre cuite émaillée et colorée, qu'avaient les Néo-Babyloniens en -580 et d'autre part les Achéménides vers -500. Au XVe siècle, le nord de l'Italie deviendra maître dans l'art de la décoration des habitations et monuments avec des frises, des guirlandes et des festons constitués tout de briques émaillées. D'abord modelée, la brique apparaît entre le huitième et le septième millénaire av. J.-C., dans la région du Tigre et de l'Euphrate. Les premières maisons en brique ont été découvertes en Mésopotamie — actuel Irak — et l'on estime que l'usage de la brique s'étend rapidement dans tout le Moyen-Orient. La brique crue est simplement moulée puis séchée au soleil, pour la rendre plus résistante. Elle permet de monter des habitations ou des monuments comme la pyramide d'Amenemhat III, mais reste fragile et résiste mal aux intempéries. Son utilisation se généralise au quatrième millénaire, avec l'invention et l'emploi du moule à briques aux dimensions normalisées, donnant naissance aux premières cités urbaines. La cuisson de la brique est expérimentée en 2500 av. J.-C., en Mésopotamie et dans la vallée de l'Indus. La cuisson permet de réaliser des constructions plus imposantes. La brique de terre cuite constitue la première pierre artificielle ou « pierre factice », longtemps avant le béton de ciment. La Rome antique met en œuvre les briques crues dans l’opus latericium, et les briques cuites dans l’opus testaceum. Les briques sont carrées et peuvent être fractionnées en éléments rectangulaires ou triangulaires. Si en France, Paris, tirant parti du calcaire lutécien du Bassin parisien, demeure une ville de pierre, beaucoup de villes et pays où la pierre à bâtir est rare seront des villes de brique. Le gothique de brique est un style spécifique de l'architecture gothique en Europe du Nord, en particulier dans le nord de l'Allemagne et les régions autour de la mer Baltique qui ne disposent pas de ressources en pierre naturelle, construiront en utilisant essentiellement la brique. Les édifices gothiques de briques se trouvent en Biélorussie, Danemark, Estonie, Finlande, Allemagne, Lettonie, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, Russie et Suède. À Londres, la pénurie en pierre de taille de qualité fait de celle-ci une ville de briques. Lors de la Révolution industrielle, les briqueteries se regroupent et forment de véritables usines. Des fours à charbon permettent d'augmenter la capacité de production : des fours plus grands, plus efficaces (le four Hoffmann, où la production de brique se fait en continu, le four Bull, etc.) et de grandes cheminées de briques deviennent les éléments caractéristiques de ces briqueteries. En France, Toulouse et ses 170 briqueteries devient un important producteur de briques. Aujourd'hui, les briqueteries ont pratiquement disparu en Europe. En 1830, Auguste Virebent dépose le brevet d'invention d'un système de presse à briques. Ceci est un jalon de l'industrialisation de la brique. Il met au point aussi la « plinthotomie », invention fonctionnant comme un emporte-pièce, pour découper diverses formes dans de la glaise fraîche. Cette technique permet de s'affranchir des sculpteurs, et d'industrialiser la fabrication. L'après-guerre marque le remplacement progressif de la brique par le béton de ciment et l'acier. À la fin du XXe siècle, les chocs pétroliers à répétition, la prise de conscience écologique consécutive au dérèglement climatique, conduisent l'industrie briquetière à des innovations majeures pour réduire la consommation énergétique et l'impact environnemental liés à la fabrication des produits. Ainsi : la récupération de l’air chaud lors du refroidissement des produits dans le four qui est redirigé vers les séchoirs, permet d’économiser près de la moitié de la consommation en énergie de ces derniers, l’utilisation de sources d’énergie alternatives : la biomasse (ex. : déchets de bois), le biogaz (issu de centre d’enfouissement) et l’énergie photovoltaïque ou éolienne en cours de développement permettent de réduire de moitié la consommation en énergie fossile de nombreuses usines, un suivi rigoureux du cycle de cuisson par voie informatique et la réalisation de bilans thermiques ont permis d’optimiser le processus. Au niveau européen, l’énergie nécessaire à la fabrication des briques (1 m2 de mur) a ainsi diminué de 39 % entre 1990 et 2007. Enfin, dans les pays industrialisés, les coûts d’approvisionnement énergétique poussent certaines briqueteries à se diversifier dans la fabrication de briques en terre crue. Fabrication en terre crue Mur en adobe sur soubassement en pierre dans une maison ancienne de Burgos (Espagne). Fabrication traditionnelle de briques à Antananarivo (Madagascar). On retrouve la technique de brique crue en Lorraine où — dit un manuel de 1825 — on construisait aussi avec des briques desséchées au soleil et posées avec un mortier d'argile, l'exécution étant facile et peu coûteuse. « On labourait en plusieurs sens une portion de terre dont la surface est calculée en raison de la dimension du bâtiment à construire ; on battait avec une masse cette portion de terre et la forme en surface unie ; puis, avec des règles et un tranchant, on coupait cette terre battue en lignes droites, espacées de 8 à 9 pouces, et par d'autres transversales de quatre à cinq pouces de distance. Tous ces carreaux ainsi tracés présentaient un champ couvert de briques. On laissait cette terre bien sécher et prendre le plus de consistance possible, et, après un temps convenable, on enlevait chaque carreau qui présentait alors la forme d'une brique de deux pouces environ d'épaisseur. C'est avec de pareilles briques qu'on élevait un bâtiment, en posant chaque assise, à la manière ordinaire, sur un lit de la même terre délayée en consistance de mortier. » La technique prend le nom d'« adobe » sur les bords de la Méditerranée et par voie de colonisation en Amérique latine où elle est encore le patrimoine de beaucoup de familles pauvres, qui conservent cette tradition depuis des temps immémoriaux. La terre crue est une alternative à une industrie briquetière énergivore. Les coûts d’approvisionnements énergétiques des fours à briquepoussent d'ailleurs certaines briqueteries à une inévitable reconversion dans la fabrication de briques en terre crue. Fabrication en terre cuite Methode traditionnelle Avant la mécanisation, les hommes arrachaient l'argile à l'aide de fers, à plat. Une fois l'argile extraite, un travail de broyage permettait d'affiner la matière première. Ensuite, l'ajout d'eau en grande quantité permettait d'obtenir une pâte homogène, à la plasticité voulue. Le pétrissage, autrefois au pied, et désormais avec de puissantes machines, permettait d'éliminer les derniers cailloux. Cette préparation de l'argile se terminait par une phase de pourrissage, durant laquelle la terre glaise se « reposait ». Son façonnage se faisait dans un moule en bois dont les bords et le fond étaient ensablés afin que la glaise n'y adhère pas. Un morceau de glaise était placé dans le moule, puis aplani. La surface était égalisée et arasée de son excédent à l'aide d'un archet ou d'une plane humide (rasadou, rasador, en région toulousaine). Le tout était démoulé et déposé sur le sol, ou sur une grille pour une première phase de séchage. Une fois durcies, les briques étaient empilées en quinconce pour faciliter la circulation de l'air entre elles. Dans la région toulousaine, ces empilements de briques étaient nommés « châteaux » et étaient stockés sous un auvent entourant le four de la briqueterie. La cuisson s'opérait quand le nombre de briques sèches était suffisant. Elles étaient alors empilées selon le même principe à l'intérieur du four, par une étroite ouverture verticale aménagée dans un des côtés. Des rainures horizontales recevaient une planche servant de support à l'ouvrier chargé de placer les briques jusqu'en haut du four. L'ouverture était ensuite obturée avec de la terre. Le feu était allumé dans le foyer situé en sous-sol du four, et entretenu uploads/Geographie/ franceza 1 .pdf
Documents similaires










-
36
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 01, 2021
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1817MB