Géographie et cultures 31 | 1999 La postmodernité La géographie culturelle et l
Géographie et cultures 31 | 1999 La postmodernité La géographie culturelle et la signification du millénaire Denis Cosgrove Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/gc/10351 DOI : 10.4000/gc.10351 ISSN : 2267-6759 Éditeur L’Harmattan Édition imprimée Date de publication : 1 juillet 1999 Pagination : 49-64 ISBN : 2-7384-7993-0 ISSN : 1165-0354 Référence électronique Denis Cosgrove, « La géographie culturelle et la signification du millénaire », Géographie et cultures [En ligne], 31 | 1999, mis en ligne le 21 avril 2020, consulté le 30 avril 2020. URL : http:// journals.openedition.org/gc/10351 ; DOI : https://doi.org/10.4000/gc.10351 Ce document a été généré automatiquement le 30 avril 2020. La géographie culturelle et la signification du millénaire Denis Cosgrove 1 Je suis éditeur en chef et fondateur d’Ecumene : Environment, Culture, Meaning, journal qui publie les résultats de recherches dans le domaine de la New Cultural Geography. Les articles de cette revue concernent aussi bien le passé que le présent ; ils mobilisent souvent des sources historiques ; ils s’appuient sur les méthodes interprétatives et narratives conventionnellement associées aux humanités. Mon intérêt, au cours de cette présentation, sera situé sur le versant de la géographie culturelle qui a procédé à une révision des liens de notre discipline avec les humanités. Nous reconnaissons par là même qu’une large part du stimulus qui a poussé vers la « nouvelle » géographie culturelle est venu d’une convergence théorique et méthodologique entre les disciplines des humanités, telles que l’histoire, la philosophie, l’étude des langues et les sciences sociales, convergence qui sous-tend le vaste champ des « études culturelles ». Les études d’Ecumene sont fortement influencées par les programmes de recherche de ces « études culturelles », « au sein desquelles les »frontières« de la géographie, de l’histoire et de plusieurs autres disciplines sont couramment subverties et transgressées »1 ; le respect codifié des frontières disciplinaires y cède la place à un dialogue interdisciplinaire fluide et vibrant2. La « Géographie culturelle » anglophone a bien sûr connu des débats intellectuels variés au cours de la dernière décennie, à propos en particulier du rôle et des relations entre la théorie et les études empiriques, et à propos du statut ontologique de la culture3. Ecumene a volontairement évité d’arrêter une fois pour toutes une position dans ces débats, se contentant de demander que les articles soient fondés sur une recherche de première main et traitent leurs données dans une perspective éclairée par la théorie. Tirant parti de mon expérience d’éditeur d’Ecumene et de mes propres recherches, je désire réfléchir ici à l’approche que la géographie culturelle adopte en relation avec le temps et l’espace. Je choisis ce thème pour deux raisons : d’abord parce qu’il y a traditionnellement des relations étroites entre la géographie culturelle et la géographie historique et ensuite, à cause de la signification globale actuelle de ce que nous pourrions appeler la « culture du temps » dans la mesure où nous approchons de l’An 2000 et cherchons à évaluer la La géographie culturelle et la signification du millénaire Géographie et cultures, 31 | 1999 1 signification sociale et symbolique de cette date et celle des réactions qu’elle suscite. J’ai donc choisi de placer mes réflexions sous le titre « la géographie culturelle et la signification du millénaire ». 2 L’émergence de la « nouvelle » géographie culturelle fait partie d’une réponse intellectuelle beaucoup plus large à l’effondrement, au sein de la sphère universitaire, des frontières intellectuelles héritées du passé, ainsi qu’à la flexibilité croissante et au travail empirique que certains qualifieraient de postmoderne. Bon nombre de positions sont bien entendu regroupées sous cette étiquette : elles incluent le refus de faire confiance à la métathéorie, l’ouverture à l’idée que, dans la conversation scientifique, il puisse y avoir une multiplicité de voix qui fassent autorité, et le refus des taxonomies axiomatiques mises en œuvre au sein des études scientifiques, ou entre elles. Les positions du postmodernisme ne se contentent pas de privilégier l’espace comme agent actif à la fois dans la configuration donnée aux événements et dans la connaissance que nous en avons ; elles ont radicalement déstabilisé la fixité des espaces à propos desquels l’explication et la narration géographiques entraient en compétition ; elles introduisent en même temps une perspective inclusiviste à travers laquelle il est possible de façonner les identités dans un monde postcolonial. Quand on a présentes à l’esprit ces positions, il est ironique de constater que la « nouvelle » géographie culturelle a jusqu’ici tendu à confiner la langue de ses débats à l’anglais, maintenant ainsi la connexion entre la géographie humaine anglophone et la colonisation : elle assure, au sens large, des connexions entre la culture et le territoire à travers la transformation mutuelle de l’environnement et du corps qui y est plongé. Au centre comme à la périphérie de l’expérience coloniale européenne, la géographie culturelle a été longtemps dominée par les questions d’enracinement, de mobilité et d’identité, et n’a que rarement et récemment examiné leurs contraires : le déracinement et la dépossession. La géographie culturelle traditionnelle faisait une de ses clefs de l’origine et de la mobilité des expressions de la culture, et de la colonisation de Nouveaux Mondes, depuis l’étude des espèces domestiquées jusqu’à l’appropriation consciente par les peuples européens d’environnements transocéaniques. Ces centres d’intérêt étaient souvent partagés par les géographes de la diaspora coloniale britannique. Le thème de la mobilité a donné naissance à une autre orientation plus globale du projet de la géographie culturelle : la compréhension des expressions spatiales de la mobilité, en particulier urbaine, comme résultat de processus sociaux diversement théorisés. Cette orientation a été aussi dominée par le modèle spatial et historique eurocentrique - voire même anglocentrique - dont le Mythe des Continents du géographe Martin Lewis et de l’historien Karen Wigen ont montré qu’il avait sous-tendu leurs disciplines respectives depuis le XVIIIe siècle4. 3 Le « colonialisme » et « l’eurocentrisme » constituent évidemment eux-mêmes des exemples du type de « métarécits » qui sont en principe remis en doute par la pensée postmoderne et par les défis politiques liés aux positions relatives à la « fin de l’histoire », à « l’entrée dans l’ère postcoloniale » ou à « la fin des Lumières » que cette forme de pensée implique. Chacune de ces formules a une provenance et une finalité légèrement différentes. La thèse de Francis Fukuyama sur la « fin de l’histoire » transforme la défaite subie par le marxisme-léninisme et qui a mis fin à la Guerre froide, en position antihistorique plus large, et recentre l’attention scientifique sur les questions géopolitiques locales et contingentes au sein de la démocratie de marché libérale en tant que phénomène global. Les théories du postcolonialisme et de la La géographie culturelle et la signification du millénaire Géographie et cultures, 31 | 1999 2 critique des Lumières contestent les hypothèses humanistes et démocratico-libérales qu’implique l’hypothèse de la « fin de l’histoire », mettant l’accent sur la multiplicité des voix, la prise en compte d’hypothèses subalternes, les affirmations identitaires transgressives et hybrides. Elles étendent leurs critiques au-delà des relations sociales en prenant en compte celles qui concernent l’environnement. Pour donner forme à l’explication, ces positions, en dépit des différences que nous venons de souligner, pointent vers l’idée que l’espace et la spécificité des lieux semblent offrir des guides plus sûrs que les historiographies conventionnelles. L’espace et le lieu, plutôt que la géographie et l’environnement, parce que cette façon d’envisager les choses va bien au- delà de la simple reconnaissance des différences environnementales en tant que contexte des événements historiques. Lorsqu’ils dessinent les contours des principes pour réformer la « métagéographie », Lewis et Wigen, militent en conséquence pour « une vision [progressive] et créative... susceptible de visualiser des ’régions’ discontinues, et qui puisse prendre la forme spatiale de treillis, d’archipels, d’anneaux creux ou de mosaïques »5. 4 Si l’historicisme cède ainsi la place à une perception qui va plus loin du sens de l’espace et du lieu, cela semble renforcer plutôt que diminuer la prégnance de la temporalité. En fait, comme le montrent à la fois les travaux de Doreen Massey et de Simon Schama, le sens des lieux et l’expérience du paysage sont justement des phénomènes temporels, institués tout autant dans la mémoire et le désir que dans un espace géographique absolu6. Discutant de la disparition du lieu en Australie, Jane Jacobs avance que tandis que « les rêves du colonialisme et de la modernité gisent maintenant en ruine, ces ruines constituent un paysage de la mémoire, à partir duquel de nouveaux envols de l’imagination historique peuvent surgir »7. Mais construire le paysage à partir de traits morphologiques bien déterminés et ne le peupler que de la conscience du chercheur constitue peut-être une manière trop restrictive de poser la question. Une meilleure façon de procéder consisterait peut-être à dire que les ruines continuent à être habitées par des fantômes, par « le sens de la présence de ceux qui ne sont pas physiquement là »8, une présence évoquée par Schama lorsqu’il tisse sa voix inspirée à travers les descriptions de paysage. uploads/Geographie/ gc-10351.pdf
Documents similaires









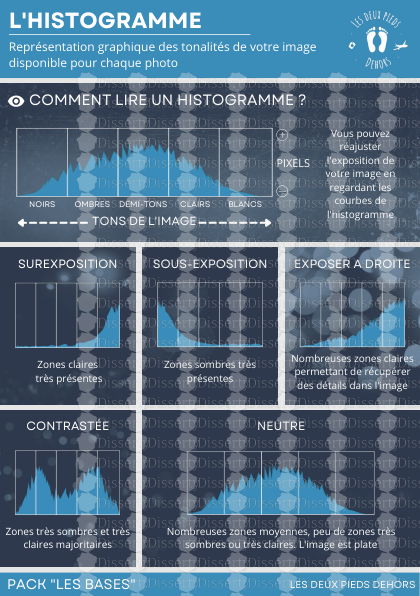
-
80
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 11, 2021
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2183MB


