LA VOCATION DE L’ARBRE D’OR est de partager ses admirations avec les lecteurs,
LA VOCATION DE L’ARBRE D’OR est de partager ses admirations avec les lecteurs, son admiration pour les grands textes nourrissants du passé et celle aussi pour l’œuvre de contem porains majeurs qui seront probablement davantage appréciés demain qu’aujourd’hui. Trop d’ouvrages essentiels à la culture de l’âme ou de l’identité de chacun sont aujourd’hui indisponibles dans un marché du livre transformé en industrie lourde. Et quand par chance ils sont disponibles, c’est financiè rement que trop souvent ils deviennent inaccessibles. La belle littérature, les outils de développement personnel, d’identité et de progrès, on les trouvera donc au catalogue de l’Arbre d’Or à des prix résolument bas pour la qualité offerte. LES DROITS DES AUTEURS Cet e-book est sous la protection de la loi fédérale suisse sur le droit d’auteur et les droits voisins (art. 2, al. 2 tit. a, LDA). Il est également pro tégé par les traités internationaux sur la propriété industrielle. Comme un livre papier, le présent fichier et son image de couverture sont sous copyright, vous ne devez en aucune façon les modifier, les utiliser ou les diffuser sans l’accord des ayant-droits. Obtenir ce fichier autrement que suite à un téléchargement après paiement sur le site est un délit. Trans mettre ce fichier encodé sur un autre ordinateur que celui avec lequel il a été payé et téléchargé peut occasionner des dommages informatiques suscepti bles d’engager votre responsabilité civile. Ne diffusez pas votre copie mais, au contraire, quand un titre vous a plu, encouragez-en l’achat. Vous contribuerez à ce que les auteurs vous réservent à l’avenir le meilleur de leur production, parce qu’ils auront confiance en vous. © Arbre d’Or, Genève, octobre 2005 http://www.arbredor.com Tous droits réservés pour tous pays Camille Jullian Histoire de la Gaule Tome I 4 Chapitre I : Structure de la gaule I. Étendue et nature de cette histoire — II. Limites et forme de la Gaule — III. Angles extrêmes — IV. Montagnes centrales — V. Massifs isolés — VI. Les plaines : hauts et bas pays — VII. Le grand réseau fluvial — VIII. Vallées secondaires — IX. Principales régions maritimes — X. Principales régions continentales. Nord et Sud — XI. Capitales naturelles de la Gaule : Lyon et Paris — XII. Carrefours régionaux I. — Étendue et nature de cette histoire Le nom de Gaule désigna, chez les Anciens, la contrée comprise entre la Mé diterranée, les Alpes, le Rhin, l’Océan et les Pyrénées1. C’est de cette contrée que je me propose d’écrire l’histoire, depuis environ l’an 600 avant Jésus-Christ jusque l’an 400 de notre ère. La première de ces dates est celle du plus ancien fait dont on ait conservé le souvenir précis, la fondation de Marseille. Et ce fait ne précède que de très peu l’immigration du peuple qui devait imposer son nom à la contrée, celui des Celtes ou des Gaulois. L’arrivée, presque simultanée, des Celtes et des Grecs, des derniers conquérants barbares venus par le nord et des premiers colons débar qués au sud : voilà le point de départ naturel de cette histoire. Elle peut prendre fin un millénaire plus tard. Au cinquième siècle, l’établis sement de Germains, le triomphe du Christianisme, la domination des Francs créent de nouvelles habitudes chez les hommes et annoncent une nouvelle ma nière de dénommer le pays. Faire l’histoire de la Gaule c’est raconter et expliquer les changements qui se sont produits dans l’aspect du sol et dans la manière de vivre et de penser des habitants. Nous ne séparerons pas de l’étude de l’humanité celle du terrain qui la nourrit. Le défrichement d’une grande forêt, le desséchement d’un vaste ma récage, ont presque autant d’importance, dans les destinées des sociétés, qu’une révolution politique ou qu’un chef-d’œuvre littéraire. Il n’est pas moins utile de 1 Peut-être est-ce Pythéas de Marseille (contemporain d’Alexandre) qui a le premier donné un nom général, et celui de Keltik», à toute la contrée comprise en Marseille, les Pyrénées, l’Océan et l’Elbe, au-delà duquel il faisait commencer la Scythie (Strabon, I, 4, 3 et 5 ; III, 2, 22). 5 Histoire de la Gaule connaître la façon dont les populations ont partagé et cultivé la terre, que celle dont elles se sont converties à une religion nouvelle. La diffusion d’une culture, la construction d’une longue route, la formation d’une ville capitale, amènent des conséquences aussi durables qu’une guerre et qu’une loi. Un historien doit donc examiner les rapports de l’homme avec le sol qu’il habite, au même titre que les relations des hommes entre eux. Il le doit d’autant plus que ces relations sont d’ordinaire déterminées par la terre elle-même. — Presque toutes les guerres, quel que soit le noble prétexte invoqué, naissent des convoitises collectives excitées par des portions de cette terre. Les révolutions qui réussissent sont celles qui changent les maîtres du sol. C’est par les routes naturelles que se règlent les échanges commerciaux ; c’est par elles aussi que s’expliquent la plupart des grandes villes, où se concentre le travail des mains et de la pensée : les cités mères de la Gaule antique et de la France mo derne, Lyon, Paris, Marseille, Bordeaux, Narbonne, Trèves, n’ont crû que parce que leurs habitants ont conformé leur vie à la qualité du terrain et à la situation du lieu. Il n’est même pas de religion, si pure que ses prêtres l’affirment, qui ne reflète l’horizon terrestre et les habitudes des yeux : après de superbes envolées dans l’idéal invisible, les plus puissants dieux eux-mêmes viennent se fixer sur un sommet ou se montrer près d’une fontaine. Enfin, le caractère et le rôle d’un peuple dépendent de la valeur du sol qu’il laboure, de la place de son pays dans le monde, et de la structure même de ce pays : j’appelle structure sa forme, le rapport de ses parties, et la nature de ses limites. II. — Limites et formes de la Gaule Si les limites naturelles d’un pays sont de larges accidents du sol qui l’isolent et le protègent, la Gaule était, en apparence, aussi nettement délimitée et aussi abritée que la Bretagne insulaire et que les presqu’îles d’Espagne ou d’Italie. La mer lui servait de frontière sur la moitié de son pourtour et c’était presque toujours, au nord comme au sud, une mer sans fin visible et tenant tout l’hori zon. Elle s’appuyait aux montagnes les plus hautes et les plus massives de toute l’Europe. Le fleuve qui la bordait était le plus important de l’Occident par sa longueur et par la largeur de son lit : « La Gaule avait été fermée et fortifiée par la nature », disaient les Anciens, « avec un art véritable2. » — Nous verrons plus loin si l’œuvre était aussi parfaite qu’ils se sont plu à le dire. Les contours de la Gaule étaient à la fois variés et précis. Une élégante di 2 Josèphe, De b. J., II, 28 (16), 4. Ammien, XV, 10, 1. 6 Histoire de la Gaule versité égayait ses frontières. La Grande-Bretagne n’a que la mer pour l’enclore. L’Espagne et l’Italie sont des péninsules soudées au continent le long de la ligne, droite ou courbe, que forme une muraille de montagnes. Autour de la Gaule, l’eau courante, les monts et la mer alternaient pour faire une ceinture continue et changeante. L’orientation de la frontière se modifiait aussi souvent que son aspect. — Sui vons-la en partant de Monaco, depuis cette montée de La Turbie qui marquait le point où la chaîne des Alpes expire sur la rive de la mer intérieure. De l’est à l’ouest, le rivage méditerranéen se présente en une double courbe. Renflé d’abord vers le sud, il avance dans la mer de Sardaigne3 les vives arêtes de ses caps et les échancrures de ses baies. — Puis, aux abords de Marseille, il se replie vers le nord, ramenant dans l’intérieur des terres la longue ligne, basse et régulière, blanche et sablonneuse, du golfe gaulois et du pays de Narbonne. Lorsque, au-delà de cette ville, la côte redescend obstinément au sud vers les terres africaines, les Pyrénées s’approchent alors, montrent les forêts de pins de leurs sommets rejoignent dans la plaine d’Elne la mer intérieure, et lui succèdent comme frontière. Désormais, c’est leur chaîne ininterrompue qui va continuer dans le couchant la clôture méridionale de la Gaule. — Mais, comme pour faire pressentir un changement prochain dans la direction de la frontière, la ligue marquée par le faîte des montagnes incline légèrement vers le nord. Chose remarquable ! les deux bases méridionales de la Gaule, si différentes de nature, ont à peu près la même longueur. Il y a 94 lieues, à vol d’oiseau, d’une extrémité à l’autre de la Méditerranée gauloise, depuis Monaco jusqu’au cap Cerbère : il n’y en a que 10 de plus entre les deux termes de la frontière pyré néenne. Car, au moment où la chaîne de montagnes, dépassant cette longueur, s’étend démesurément vers le plus lointain occident, elle coupe l’Océan Atlan tique, pour ainsi dire descendu du nord à sa rencontre, et uploads/Geographie/ histoire-gaule-1.pdf
Documents similaires


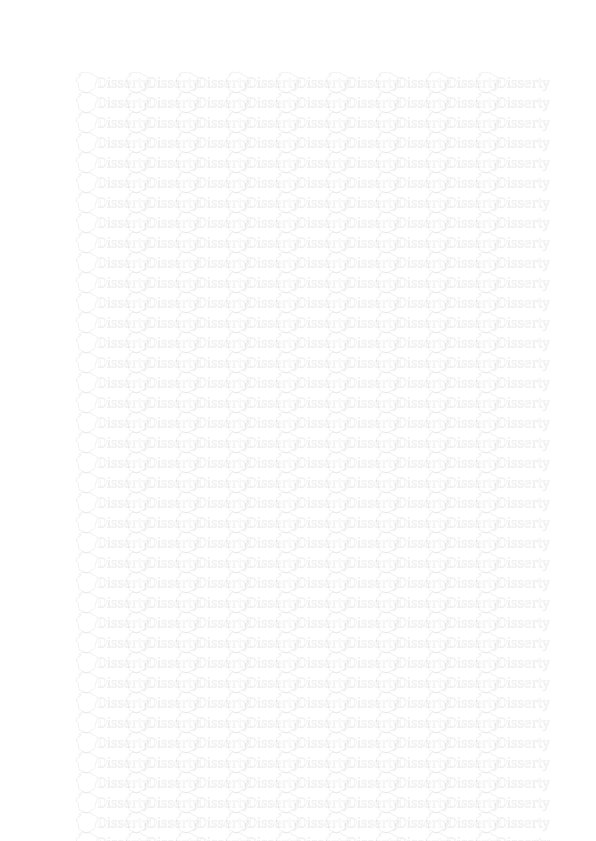







-
51
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 25, 2021
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 1.7164MB


