Mercedes Volait La communauté italienne et ses édiles In: Revue de l'Occident m
Mercedes Volait La communauté italienne et ses édiles In: Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, N°46, 1987. pp. 137-156. Citer ce document / Cite this document : Volait Mercedes. La communauté italienne et ses édiles. In: Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, N°46, 1987. pp. 137-156. doi : 10.3406/remmm.1987.2196 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/remmm_0035-1474_1987_num_46_1_2196 M. Volait LA COMMUNAUTÉ ITALIENNE ET SES ÉDILES Alexandrie levantine et cosmopolite : la formule, à défaut d'être heureuse, résume bien le mythe tenace qui structure, de nos jours encore, l'imaginaire occidental s'agissant de la cité portuaire du siècle passé. C'est là un mythe curieusement peu contesté, auquel, à vrai dire, l'œuvre suggestive de Durell a su donner une telle consistance qu'il demeure hasardeux de tenter de le déconstruire1. D'ailleurs une telle entreprise pourrait s'avérer fort ardue, tant la documentation de première main fait défaut. Les sources disponibles ne permettent guère de préciser ce que peuvent bien recouvrir ces notions de levantinisme et de cosmopolitisme2, ni même dans quelle mesure elles ont pu qualifier une spécificité alexandrine3. En admett ant, en guise de définition minimale, que ces deux termes renvoient directement à la présence notable sur le sol alexandrin, de minorités allogènes à l'Egypte, tant européennes que levantines; le caractère hagiographique — et très inégal sur le plan informatif — , des annales que chacune de ces communautés a plus ou moins régulièrement tenues à jour4, permet encore moins de cerner le rôle joué par ces dernières dans le processus de développement de la ville. Si les successives circonstances ayant favorisé la venue des étrangers en Egypte sont bien connues, si même les modes de pénétration du grand capital dans l'éc onomie locale le sont tout autant; les conditions d'existence de ces étrangers, ainsi que les effets socio-économiques d'une telle présence, sans cesse accrue, le sont beaucoup moins — si ce n'est de manière très globale, et toutes minorités confondues5. Cette présence a pour le moins fait l'objet d'appréciations très contradictoires : apparaissant tour à tour bénéfique aux yeux de ceux, le plus souvent chroniqueurs attitrés de telle ou telle colonie, qui y discernaient « la source vive de la régénéres- cence» d'une Egypte fortement archaïque6, et a contrario franchement néfaste pour d'autres observateurs, qui y voyaient surtout l'origine d'une exploitation éhontée ROMM 46, 1987-4 138 I M. Volait du pays et la mise en péril de ses valeurs les plus authentiques. Telle est notam ment la position de L. Auriant, exposée dans un opuscule au titre évocateur : L'Egypte, la proie de ses métèques. Métèques qui ne sont autres que : « des aventuriers de la pire engeance, déchargés en cargaisons d'année en année plus amples sur les quais d'Alexandrie : banqueroutiers, escrocs, faussaires, ruffians, trans fuges politiques, Grecs, Italiens, Maltais, Polonais, Juifs allemands et autrichiens, tous, pauvres hères ou tristes sires, à qui leur passé de crime ou de honte, leur médiocrité ou leur ignorance rendaient la vie impossible dans leur pays d'origine»7. Loin de reprendre à notre compte l'une ou l'autre de ces analyses, disons tou tefois que les privilèges accordés par Mohamed Aly aux étrangers purent sembler, à juste titre, tout à fait exorbitants, et firent longtemps de l'Egypte le pays béni des entrepreneurs. Alexandrie fut sans conteste le premier centre urbain à être le plus profondé ment affecté par l'impulsion décisive donnée aux relations commerciales avec l'Europe durant le règne du grand Pacha, puis par le boom cotonnier des années 1860-1866, ne serait-ce que par l'afflux des étrangers qui s'en suivit. S'ils ne s'y fixaient pas toujours, c'est d'abord à Alexandrie que débarquaient les étrangers, pour une installation même provisoire. Le peuplement d'Alexandrie leur est dû en partie8, et leur poids démographique va s'accroître en continu tout au long du siècle, malgré quelques fluctuations9. Le record semble atteint en 1882 : la ville compte alors 21,5 % d'étrangers — mais vraisemblablement bien plus si l'on inclut dans ce décompte les sujets ottomans, comptabilisés comme sujets natio naux jusqu'en 1907 10. Et si entre 1882 et 1897, les étrangers semblent lui préférer le Caire, ils demeur ent à Alexandrie, en chiffres absolus comme en pourcentage, en nombre supé rieur à celui enregistré pour la capitale. En moyenne et jusque dans les années 1930, les étrangers représentent 15 % de la population alexandrine, pour 8 % de la population cairote. Une préférence qui tendra par la suite à se déplacer vers les villes du Canal, pour lesquelles les Anglais vont nourrir un penchant certain, tandis qu'ils dédaignent Alexandrie, agaçante à leurs yeux à force de mercantilisme. «Politics play a relatively small role in Alexandria daily life, while all considerations of science, art and archeology are choked by the city's strenuous commercial activity. (Au Caire même) there is more to see, and less commercial talk»11. Pour être la deuxième ville du pays, Alexandrie n'en demeurera pas moins le premier centre des étrangers en Egypte. A ceci s'ajoute, au tournant du siècle tout au moins 12, leur prééminence dans certains secteurs d'activité apparemment lucrat ifs, tel le négoce, la banque ou le courtage, mais aussi les professions libérales, les fonctions civiles et militaires, ce qui leur confère une puissance économique considérable. Jusqu'en 1914, l'investissement de l'Egypte par le grand capital, notamment britannique et français, atteint son plein essor, et les retombées en seront directes pour les minorités étrangères locales, qui en étaient les principaux agents13. Cependant les années 1920 inaugurent une ère de déclin graduel, durant laquelle la situation des étrangers en Egypte ne va cesser de se détériorer 14. Après la crise de 1907, et parallèlement au mouvement d'égyptianisation de l'économie du pays, la puissance étrangère locale va être amenée à se rétrécir, même si les La communauté italienne et ses édiles I 139 Répartition géographique de la communauté italienne Egypte Le Caire Alexandrie 1871 1882 1897 1907 1917 1927 1937 13 906 a 16 000 b 14 251 (R) 18 665 b 24 454 34 926 40 198 52 462 49 107 c 47706 3 367 a 4 969 (R) 8 670 13 296 15 655 18 571 16 443 7 539 11579 11743 16 669 17 860 24 280 22881 Sources ; a) Regny : Statistique de l'Egypte d'après les documents officiels, 1872. b) Samarco : Gli italiani in Egitto, 1937. c) Briani : Italiani in Egitto, 1982. (R) Recensement de 1882. Les autres sources sont extraites des recensements décennaux. capitaux étrangers, gérés directement depuis les places financières européennes, restent prépondérants15. Encore faudrait-il pouvoir ici nuancer quelque peu16; entre communautés tout d'abord, car elles connaîtront des modes d'enrichissement fort inégaux; puis à l'intérieur, y compris, d'une même communauté tant les dif férenciations sociales tendront à s'y élargir. Aux côtés des communautés d'origine européenne, il faudrait pouvoir assigner un rang spécifique, en termes socio-économiques, à cette catégorie intermédiaire entre «indigènes» et «étrangers» qu'ont longtemps constituée les dits-sujets ott omans en Egypte — tout du moins antérieurement aux premières lois sur la natio nalité égyptienne (1926). Formé de Grecs et de Turcs, de Syriens et d'Arméniens, ainsi que d'une poignée de Soudanais, ce groupe pourrait bien avoir été, en ses couches les plus aisées, le véhicule privilégié de ces valeurs cosmopolites si typi ques d'une certaine société alexandrine. La classe dominante y est constituée de grandes familles turco-circassiennes, qui tirent l'essentiel de leur puissance éc onomique de la terre — grâce aux vastes domaines ruraux attribués par la dynastie régnante contre services rendus — tout en jouissant d'une influence politique cer taine; mais aussi de nombreux «orientaux» de confession chrétienne, banquiers et négociants francophones venus de la grande Syrie et solidement implantés à Alexandrie, où ils possèdent vers la fin du XIXe siècle une bonne partie des terrains urbains situés au centre de la ville17. Cependant les plus prospères d'entre eux n'auront de cesse de rechercher le statut, plus confortable à tout point de vue, de protégés des Puissances : ainsi les Sursock, d'origine beyrouthine, furent, à partir des années 1860, des administrés russes, les frères Karam, originaires de Tripoli et installés depuis 1848 à Alexandrie, furent des sujets hellènes, certains Zogheb, syriens établis de longue date en Egypte, furent, dès 1837, des protégés toscans et demeurèrent sujets italiens18, tandis que les Debbane purent acquérir la nation alité... brésilienne, ainsi que quelques titres de noblesse, et eurent donc à gérer les biens d'une communauté — brésilienne — dont il est légitimement difficile d'imaginer ce qu'elle pouvait bien représenter en Egypte19. C'est précisément cette ambiguïté entre origine et nationalité qui rend particu- 140 / M. Volait lièrement complexe et très imprécise toute comptabilité des étrangers en Egypte. En 1927, par exemple, l'on sait que les ressortissants anglais ne constituent que 36 % des sujets britanniques, tandis que les français d'origine ne représentent guère plus du tiers de la communauté française, selon les données du recensement. De ce point de vue, les grecs et les italiens d'Egypte forment les communautés les plus homogènes, puisque 80 % de leurs sujets sont originaires du pays même, et dans une proportion similaire, de confession chrétienne. Encore ce type de uploads/Geographie/ la-communaute-italienne-et-ses-ediles 1 .pdf
Documents similaires








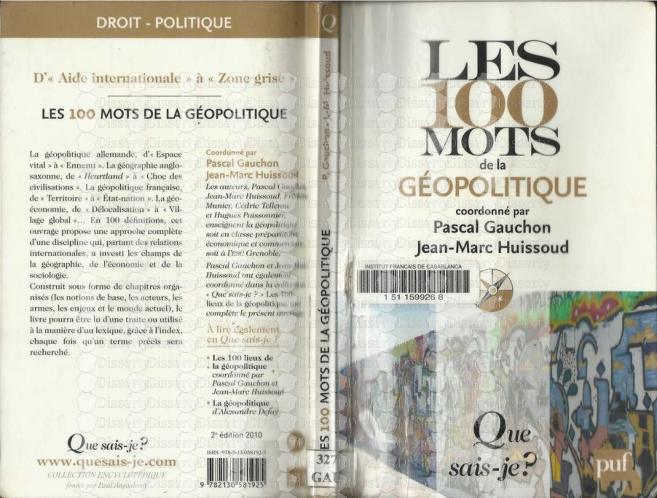

-
71
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 28, 2021
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 2.9171MB


