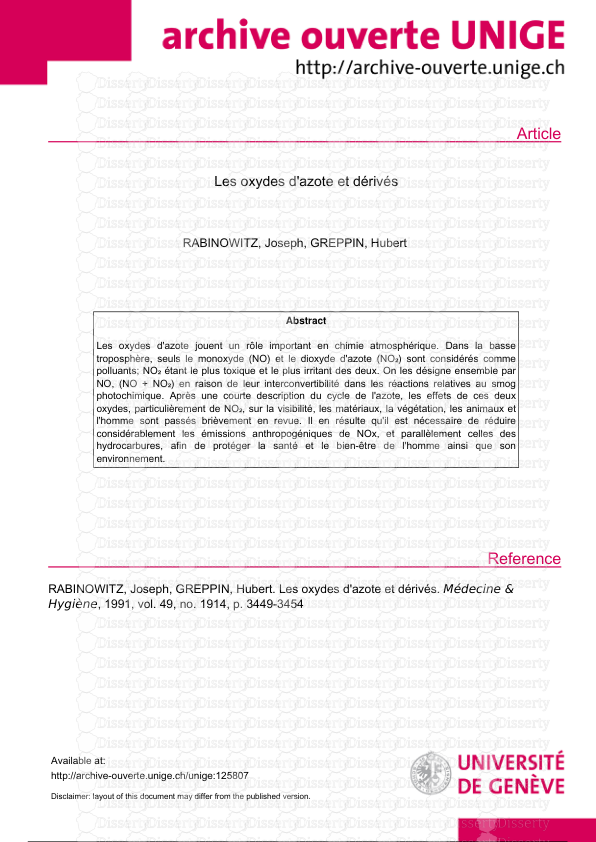Article Reference Les oxydes d'azote et dérivés RABINOWITZ, Joseph, GREPPIN, Hu
Article Reference Les oxydes d'azote et dérivés RABINOWITZ, Joseph, GREPPIN, Hubert Abstract Les oxydes d'azote jouent un rôle important en chimie atmosphérique. Dans la basse troposphère, seuls le monoxyde (NO) et le dioxyde d'azote (NO₂) sont considérés comme polluants; NO₂ étant le plus toxique et le plus irritant des deux. On les désigne ensemble par NO, (NO + NO₂) en raison de leur interconvertibilité dans les réactions relatives au smog photochimique. Après une courte description du cycle de l'azote, les effets de ces deux oxydes, particulièrement de NO₂, sur la visibilité, les matériaux, la végétation, les animaux et l'homme sont passés brièvement en revue. Il en résulte qu'il est nécessaire de réduire considérablement les émissions anthropogéniques de NOx, et parallèlement celles des hydrocarbures, afin de protéger la santé et le bien-être de l'homme ainsi que son environnement. RABINOWITZ, Joseph, GREPPIN, Hubert. Les oxydes d'azote et dérivés. Médecine & Hygiène, 1991, vol. 49, no. 1914, p. 3449-3454 Available at: http://archive-ouverte.unige.ch/unige:125807 Disclaimer: layout of this document may differ from the published version. Les oxydes d'azote et dérivés DEPARTEMENT DE BOll\NJ ET Of BIOLOGIE VEffll.l par J. Rabinowitz et H. Greppin (Genève) B 1BL1 o TH È Qu E Genève 49ème année E N° 1914 25 décembre 1991 Méd. etHyg. 49, 3449-3454, 1991 :ci, place de t'Univemtté CH-12· ;1 GENÈVE 4 78, av. de la Roseraie, 1211 Genève 4 Les oxydes d'azote jouent un rôle important en chimie atmosphérique. Dans la basse troposphère, seuls le monoxyde (NO) et le dioxyde d'azote (N02) sont considérés comme polluants; N02 étant le plus toxique et le plus irritant des deux. On les désigne ensemble par NO, (NO + N02) en raison de leur interconvertibilité dans les réactions relatives au smog photochimique. Après une courte description du cycle de l'azote, les effets de ces deux oxydes, particulièrement de N02, sur la visibilité, les matériaux, la végétation, les animaux et l'homme sont passés brièvement en revue. Il en résulte qu'il est nécessaire de réduire considérablement les émissions anthropogéniques de NO., et parallèlement celles des hydrocarbures, afin de protéger la santé et le bien-être de l'homme ainsi que son environnement. 1. Introduction L'azote, composant majoritaire (78% en volume) de l'air que nous respirons, est un élément indispensable à la vie et entre dans la composition de la matière vivante (protéines, acides nucléiques, etc.). Cependant, la plupart des organismes sont incapables de fixer directement N 2 (gaz inerte) atmosphérique à l'exception de quelques micro-organismes terrestres (et aquatiques). Ces derniers régissent presque totalement la transformation de ce gaz en dérivés azotés assimilables et vice- versa, à travers des séries de réactions compliquées dont l'en- semble constitue le cycle de l'azote. Or, ce cycle peut être per- turbé à la fois localement mais aussi à l'échelle planétaire par les activités humaines, notamment l'utilisation des combusti- bles fo siles, les pratique agricoles, la production indu Lrielle et l'élimination des déchets. A l'opposé, l'oxygène atmosphérique (21 % en volume) est utilisé directement (respiration) par toutes les formes vivantes, sauf les anaérobies. Sous l'action de processus aussi bien na- turels qu a:nthropogénique , l'azote et l'oxygène de l'air peu- vent se combiner ensemble et/ou avec d autres éléments pour former de produit toxique , notamment des oxydes d'azote que nous examinerons plus particulierement dans cet article. Lair ambiant peut contenir, bien qu'en très faibles quantités (des ppb, voire des ppt), toute une érie d'oxydes d'azote: N 20 (oxyde nitreux ou «gaz hilarant»), NO (monoxyde d'azote), N02 (dioxyde d'azote), OONO (trioxyde d'azote asymétrique), ON(O)O (trioxyde d'azote symétrique), N 20 3 (anhydride ni- treux), N 20 4 (dimère de N02), N 20 5 (anhydride nitrique). Dans la basse troposphère, seuls NO et N02 sont considérés comme polluants et on les désigne généralement ensemble par NO, à cause de leur interconvertibilité dans les réactions rela- tives au smog photochimique. Le dioxyde d'azote est le plus toxique et le plu irritant des deux. Par défi.nitio11, le dioxyd d'azote est d'ailleurs lui-même un oxydant photochimique, mais on le traite séparément non seulemtml en rai on de son action délétère directe sur la santé humaine et l'environne- ment, mais aussi parce que sa formation précède celle des au- tres oxydants photochimiques, l'ozone en particulier. En effet, lors d'épisodes de smog photochimique, N02 est l'oxydant principal en début de journée, alors que l'ozone et les autres oxydants (peroxyacétylnitrate, etc.) prédominent à partir de midi et une grande partie de l'après-midi (1). En plus de leur rôle dans les réactions conduisant au smog photochimique, NO et N02 peuvent être oxydés dans l'atmosphère en phase gazeuse ou liquide (aérosol, gouttelette de nuage, pluie) en aci- ,.i,. nitrinnP- HN03 qui est l'un des composants principaux, à côté de l'acide sulfurique, des précipitations acides dont les ef- fets sur l'homme et les écosystèmes ont été décrits dans un précédent article (2). L'oxyde nitreux N 20 est le plus abondant (0,33 ppm) dans l'air, même en absence de sources anthropogéniques, car il ré- sulte de processus biologiques naturels dans le sol (par exem- ple dénitrification). Il ne semble pas qu'il soit impliqué dans des réactions dans la troposphère conduisant au smog photo- chimique et n'est généralement pas considéré comme polluant. En revanche, dans la stratosphère, il participe à des réactions (cycle catalytique) aboutissant à la décomposition de l'ozone stratosphérique, toutefois avec une efficacité moindre que celle des chlorofluorocarbures. De plus, N 20 est un gaz à effet de serre, sa concentration troposphérique augmente à raison de 0,2 à 0,3% par an et pourrait donc contribuer à l'élévation de la température moyenne à la surface de la Terre que l'on prédit pour les décennies à venir (3). Quant aux autres oxydes d'azote cités OONO, ON(O)O, N 20 3 , N 20 4 et N 20 5, ils jouent un rôle important dans les réactions chimiques atmosphériques con- duisant à la transformation, au transport et à l'élimination des dérivés azotés de l'air ambiant ; mais ils sont toujours présents en quantités extrêmement faibles, même dans les environne- ments les plus pollués ( 4). L'ammoniac qui est généré globalement par la décomposi- tion de matières azotées dans les écosystèmes naturels ou lo- calement par des activités humaines telles que le maintien de populations animales denses (étables, etc.), pourrait aussi être converti en NO, dans l'atmosphère. Il participe également au cycle de l'azote (figure 1). D'autres dérivés des NO, identifiables dans l'air pollué comportent des nitrites, des nitrates, des acides et des compo- sés N-nitrosés (nitrosamines et nitrosamides). Des dérivés N-nitrosés ont aussi été retrouvés dans l'eau et les aliments ; ils peuvent présenter des risques pour l'homme, car ils induisent le cancer chez l'animal. On peut aussi trouver dans l'eau po- table des concentrations significatives de nitrates, qui ne sem- blent cependant pas être d'origine atmosphérique. Les nour- rissons seraient très sensibles aux nitrates (contenus dans l'eau ou les aliment ) qui peuvent provoquer chez eux des ca ·cte méthémoglobinémie (5). De plu les nitrates provenant prin- cipalement de l agriculture engrais) peuvent favori er l'eutro- phication de certains lacs et surtout d'écosystèmes côtiers, ou d'estuaires. Les problèmes évoqués montrent bien le rôle capital que jouent les constituants traces tels que les oxydes de N dans la chimie atmosphérique. Ils suggèrent également les nombreuses répercussions sur l'homme et les écosystèmes qui peuvent ré- sulter des émissions anthropogéniques importantes d~ ce type de composés, particulièrement des NO, (NO + N02), soit di- rectement, soit indirectement à travers leurs produits de trans- formation atmosphérique ou de ceux dont ils facilitent la syn- thèse. Lei, après une brève description du cycle de l'azote, nous examineron le. p opriétés et les divers effets des NO., du dioxyde d azote > 2 en particulier. 2. Le cycle de l'azote Par la photosynthèse (utilisation de l'énergie solaire), l'en- semble des organismes de la biosphère peut se maintenir et se développer de manière viable hors de l'équilibre thermody- namique, pour autant que la matière minérale et organique soit régulièrement recyclée, puisque le réservoir est limité sur terre. Ceci s'opère, moyennant une dépense d'énergie, à travers les ~ - 1 - 3449 ... 2 HARS . 1992 25 décembre 1991 MÉDECINE ET HYGIÈNE 49' année AIR NOx N2 NO N02 N2 .----t~ PANS,N03--t----t---------------------. AEROSOLS Plu1es N 10 ---~---illit~ ~IMINUTION H+ COMBUSTION AC IDES t-t----t-t-------.-----. '"1-..,,.oz"'o'""N""'E----.1------t .. EFFET DE SERRE UV N03-. TERRE EAU ( HNOl l VOLAT! LISA TI ON NH3 PRODUCTION ALIMENTA 1 RE NH4+ HETEROTROPHES DENITRIFICATION N03 NITRIFICATION N03- ACCUMULATION DANS LE SOL ET LA NAPPE PHREATIQUE N03 ----------- SOL H+ AUGMENTATION VEGETATION LITIERE SOLS ACIDES H+ RELARGAGE TOXICITE c=:::J MODIFICATION VOIRE DES- TRUCTION BIOCENOSES BAISSE REN- DEMENT AGRI- COLE EUTROPHISATION Figure 1. Schéma simplifié du cycle de l'azote avec l'impact des actions humaines (selon National Research Council 1978, modifié) (4). Les effets tampons du sol et des déchets végétaux (selon la composition chimique) sont présentés sous la forme d'une étoile, alors que la fixation industrielle d'azote n'est pas montrée (cf texte). Les perturbations causées par l'homme figurent à gauche et les effets qui en résultent à droite. divers cycles biogéochimiques des éléments constituant le vi- uploads/Geographie/ unige-125807-attachment01 1 .pdf
Documents similaires










-
59
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 13, 2021
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 6.3303MB