Histoire de France Sous la direction de JOË L CORNETTE Les rois absolus 1629 –
Histoire de France Sous la direction de JOË L CORNETTE Les rois absolus 1629 – 1715 Hervé Drévillon Ouvrage dirigé par Joë l Cornette HISTOIRE DE FRANCE DIRIGÉE PAR Joë l CORNETTE, agrégé de l’Université, ancien élève de l’École normale supérieure de Saint-Cloud, Professeur à l’Université Paris VIII-Vincennes- Saint-Denis. Jean-Louis BIGET, agrégé, docteur d’État, professeur émérite des Universités, a enseigné l’histoire du Moyen  ge aux Écoles normales supérieures de Saint-Cloud et de Fontenay-aux-Roses. Henry ROUSSO, agrégé d’histoire, ancien élève de l’École normale supérieure de Saint-Cloud, directeur de recherche au CNRS (Institut d’histoire du temps présent). Ouvrage publié avec le concours du Centre National du Livre. Le code de la propriété intellectuelle n’autorise que « les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » [ article L. 122-5] ; il autorise également les courtes citations effectuées dans un but d’exemple ou d’illustration. En revanche « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite » [ article L. 122-4] . La loi 95-4 du 3 janvier 1994 a confié au C.F.C. (Centre français de l’exploitation du droit de copie, 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris), l’exclusivité de la gestion du droit de reprographie. Toute photocopie d’œuvres protégées, exécutée sans son accord préalable, constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal. © Éditions Belin, 2011 PRÉFACE « La religion de la seconde majesté » Tertullien, repris par Bossuet Après les guerres de Dieu, où l’on tuait au nom du Très-Haut, voici les guerres du roi, où l’on offre son sang au nom d’un souverain devenu, ou redevenu, absolu. Dans le cadre d’une monarchie repensée, renouvelée, qui place le Prince au centre de tous les dispositifs, de toutes les légitimités, de toutes les représentations, cet État absolu, nouvelle manière, érige l’« extraordinaire » en matrice de réflexion et d’action. Il faut entendre par « extraordinaire » l’ensemble des moyens mis en œuvre au service d’une politique prioritairement justifiée par la guerre. Pratiquement continue des années 1630 aux années 1710, la guerre, essentiellement contre les Habsbourg de Madrid et de Vienne, mais aussi contre la République des burghers d’Amsterdam (à partir de 1672) et l’Angleterre de Guillaume III (à partir de 1689), et bientôt contre toute l’Europe ou presque, est en effet au cœur de ce livre, son moteur, en quelque sorte. Elle légitime l’emploi de moyens exceptionnels, « extraordinaires » précisément, modifiant les structures et le fonctionnement même de la monarchie : comme l’écrit Hervé Drévillon, « l’administration, l’armée, la justice et les finances furent ainsi placées sous le régime de la nécessité et de ses urgences ». Cet État de guerre, créateur de « noveletés », a provoqué de multiples déstabilisations et malaises, en forme, souvent, de fortes résistances et révoltes – notamment contre le « tour de vis fiscal » ; des révoltes populaires, aristocratiques, urbaines ou officières. Les « guerres domestiques » de la Fronde, entre 1648 et 1652, au mitan du Grand Siècle, en offrent, sans doute, l’expression la plus spectaculaire. Rien n’aurait été possible ou pensable sans le père et le grand-père des deux rois absolus de ce livre. C’est bien Henri IV, en effet, qui a refondé l’État, cet État désacralisé depuis les « matines sanglantes » de la saint- Barthélemy (1572) lorsque, décidant d’éliminer le « parti protestant », le souverain avait choisi son camp. La victoire du roi au panache blanc sur les ligueurs fut aussi la victoire des « politiques » ou des « bons Français », la victoire de ceux qui ont su faire taire les impératifs de leur foi, au profit d’un service supérieur à celui du Très-Haut. Dans le royaume du premier des Bourbons, il s’est ainsi opéré un véritable « transfert de religiosité » : la fidélité à l’État est devenue prééminente par rapport à la fidélité à Dieu, alors que ces années-là, précisément, ont vu l’entrée de la notion de « raison d’État » dans la sphère politique (Botero, Della ragion di Stato, Venise, 1589, traduit en français, dès 1590). L’impérieuse raison d’État est devenue moteur d’action à partir des années 1630 au moment même ou, par un étrange paradoxe, triomphait la réforme catholique, ce « siècle des saints », marqué par un profond renouvellement des pratiques spirituelles et pastorales dont Vincent de Paul est une figure emblématique. Hervé Drévillon montre bien qu’aucune réelle contradiction ne sépare la raison d’État et la raison de Dieu, notamment parce que cette politique s’ordonne au nom du « Très-Chrétien », un roi plus que jamais sacralisé : dans ses Rois thaumaturges, paru en 1924, le grand Marc Bloch écrit que « jamais époque n’a plus nettement et, peut-on dire, plus crûment que le XVIIe siècle, accentué la nature quasi divine de l’institution et même de la personne royale ». Tout se passe désormais comme si le roi existait pour l’État, et non l’État par le roi, « de sorte qu’on verra coexister sur deux siècles, intriquées en une secrète et mortelle contradiction, une monarchie d’abstraction, œuvrant à l’impersonnification de l’État, et une monarchie d’incarnation, réactivée dans sa traditionnelle identité de sang par la neuve exigence de durée » (Marcel Gauchet). Parallèlement, l’édit signé à Nantes en mars 1598, confirmé mais aussi réduit par la paix d’Alès (1629) avant d’être supprimé par Louis XIV (1685), a contribué à la fois à étouffer la Réforme en France (moins d’un Français sur 20 est adepte de la R.P.R., « religion prétendue réformée ») et à fonder, autour d’une religion d’État dont le souverain est le pivot, l’absolutisme et son aboutissement, une véritable religion royale qui culmine avec Louis le Grand et Versailles en « religion solaire ». Dans sa Politique tirée des propres paroles de l’Écriture Sainte, écrite dans les année 1670, publiée en 1709, Bossuet explique qu’« il y a [ … ] quelque chose de religieux dans le respect qu’on rend au Prince. Le service de Dieu et le respect pour les Rois sont choses unies [ … ] . Aussi Dieu a-t-il mis dans les Princes quelque chose de divin [ … ] . C’est donc l’esprit du christianisme de faire respecter les rois avec une espèce de religion, que [ … ] Tertullien appelle très bien « la religion de la seconde majesté » (III, 2). Et c’est ainsi que la France, fille aînée de l’Église, a sacralisé son Prince comme jamais ni nulle part ailleurs en Europe. Par ses excès et ses boursouflures dont la cour à Versailles, avec son rituel aussi contraignant qu’étouffant, offre l’image la plus outrée, cette « sursacralisation du roi » fut sans doute à l’origine de la crise de conscience européenne dont le royaume des lys a été le berceau. Spécialiste de la monarchie guerrière du XVIIe siècle, Hervé Drévillon était sans doute le mieux armé pour rendre compte des multiples déstabilisations que cet État-Leviathan, État de Guerre, a provoqué en ce siècle âpre, bouleversé par les exercices de Mars. D’autant que l’armée, ce « géant du Grand Siècle » au temps de Louis XIV, (jusqu’à plus de 400 000 hommes sous les armes), fut au cœur d’une révolution silencieuse : en effet, les exigences militaires ont imposé, notamment aux officiers (mais aussi aux simples soldats), une véritable professionnalisation, alors que l’idée d’un service autonome de l’État se développait et se dotait d’une éthique propre dont rend compte le fonctionnement, nouvelle manière lui aussi, du gouvernement. Car la monarchie de ce second XVIIe siècle fut le siège d’une métamorphose de grande ampleur traduite, par exemple, par le nombre de lettres émises par le département de la guerre : au temps d’Abel Servien, secrétaire d’État de la guerre de 1630 à 1635, 830 lettres étaient envoyées en moyenne tous les ans ; sous l’administration de François Sublet de Noyers, de 1635 à 1643, c’est 1 100 lettres qui sont émises par an. Au début de la guerre dite de la Ligue d’Augsbourg, sous l’administration de Louvois, 10 000 lettres annuelles sont expédiées depuis les bureaux du secrétaire d’État… C’est bien une « monarchie de papier » qui se met en place, de plus en plus administrative, technocratique et bureaucratique. « Je m’en vais, mais l’État demeurera toujours ». Ce sont là parmi les dernières paroles prononcées par le vieux Louis XIV à la veille de sa mort, en août 1715. Elles synthétisent, en une sobriété souveraine, la révolution silencieuse qui s’est opérée pendant son long règne : au-delà des clientèles, au-delà des réseaux de fidélités et des « lobbies », qui jusqu’alors étaient la règle des pratiques politiques (et pas seulement politiques), la fin du XVIIe siècle a vu l’émergence d’une haute administration de mieux en mieux structurée et performante, un « pouvoir administratif », tout à la fois civil et militaire, qui tend à devenir indépendant et autonome par rapport à ceux qui le dirigent. En résumé, les ministres passent, les bureaux restent… Le gouvernement du uploads/Histoire/ ebook-histoire-de-france-07-les-rois-absolus-1629-1715-2011.pdf
Documents similaires



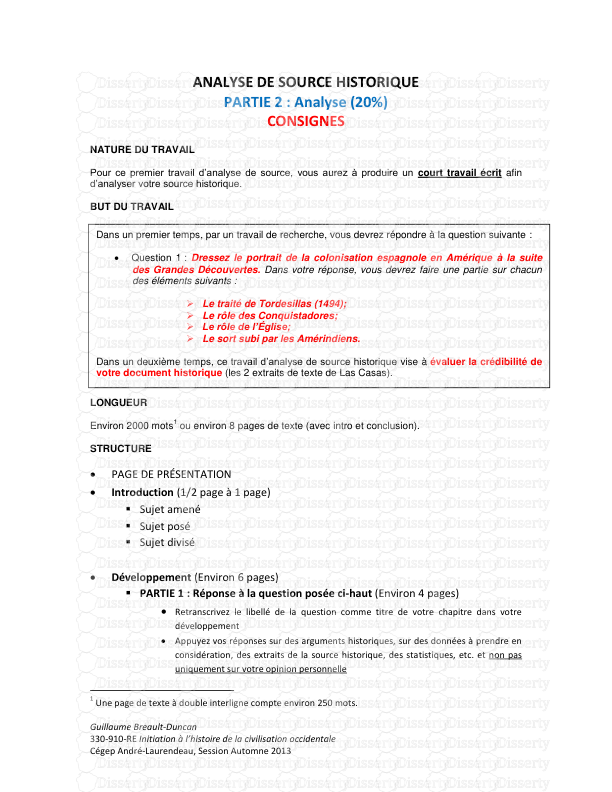






-
43
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 06, 2021
- Catégorie History / Histoire
- Langue French
- Taille du fichier 29.3775MB


