1 CONCOURS GÉNÉRAL DES LYCÉES Session 2014 Sciences de l'ingénieur Durée 5 heur
1 CONCOURS GÉNÉRAL DES LYCÉES Session 2014 Sciences de l'ingénieur Durée 5 heures Aucun document autorisé. Le matériel autorisé comprend toutes les calculatrices de poche, y compris les calculatrices programmables alphanumériques ou à écran graphique, à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu'il ne soit pas fait usage d'imprimante, conformément à la circulaire n° 99-181 du 16 novembre 1999. Poséidon au secours d’Éole pour produire l’énergie électrique Constitution du dossier texte (mise en situation et questionnement) ........................... pages 2 à 18 documents techniques DT1 à DT12 .................................... pages 19 à 30 documents réponses DR1 à DR5 ........................................ pages 31 à 35 Conseils au candidat Vérifier que tous les documents définis ci-dessus sont présents. La phase d'appropriation d'un système pluri-technologique passe par la lecture attentive de l'ensemble du sujet. Il est fortement conseillé de consacrer au moins 30 minutes à cette phase indispensable de découverte. Les documents réponses DR1 à DR5 (pages 31 à 35) sont à rendre agrafés avec la copie (même s’ils n’ont pas été complétés). 2 Partie 0 - présentation de l’étude Introduction Contribution à l’émergence de la filière La France doit atteindre en 2020 l’objectif de 23 % d’énergie renouvelable dans la production d’électricité. Ce chiffre est très ambitieux. Le Grenelle de l’environnement a structuré la réflexion sur le développement des énergies renouvelables et identifié « l’importance des démonstrateurs comme étape clé du processus d’innovation avec la demande d’une expérimentation à grande échelle d’un parc d’hydroliennes ». Le projet de parc hydrolien de Paimpol-Bréhat, qui constitue une première dans le monde, a pour enjeu de tester la faisabilité technique, économique, environnementale et administrative d’un tel parc de démonstration pré-industriel, pour favoriser le développement d’une filière énergétique française et ainsi atteindre un coût du kWh compétitif à l’horizon 2020. L’objet principal du projet est la production d’énergie électrique renouvelable qui entre dans les objectifs de la politique énergétique de la France. Le projet constitue également une piste pour diminuer la dépendance énergétique de la Bretagne. Le parc hydrolien EDF de Paimpol-Bréhat comprendra quatre hydroliennes d’une puissance unitaire de 500 kW, soit une puissance totale du parc de 2 MW. La première hydrolienne Openhydro a été installée en 2013. En 2014, trois autres hydroliennes de 500 kW la rejoindront. Le développement de la plupart de ces énergies renouvelables connaît plusieurs difficultés d’ordre économique et technologique, dues essentiellement au nombre réduit de zones économiquement exploitables et aux coûts élevés des techniques proposées. Cependant, l’énergie hydro-cinétique des courants de marée, que l’on peut récupérer grâce à des machines appelées hydroliennes, connaît un intérêt considérable pour les chercheurs et les industriels au regard de la grande similarité avec les technologies utilisées pour les éoliennes. Les systèmes hydroliens se développent ainsi plus rapidement car on peut désormais s’appuyer sur des techniques fiables et éprouvées. En outre, le potentiel énergétique mondial de l'hydrolien est estimé à une puissance de 100 GW, ce qui représente un gisement énergétique non négligeable et très prometteur. Avec une ressource hydro-cinétique avoisinant les 6 GW répartie entre le Raz-Blanchard (3 GW), Fromveur (2 GW) et Raz-de-Sein (1 GW), la France est l’un des pays les plus prometteurs en Europe occidentale après le Royaume Uni (10 GW). Le parc hydrolien EDF de Paimpol-Bréhat, au large de Ploubazlanec en Bretagne, est une première mondiale. EDF a décidé, en juillet 2008, de tester une technologie innovante de production d’électricité à partir de l’énergie prédictible des courants de marée. Dans la forte compétitivité entre les groupes industriels pouvant se positionner sur cette nouvelle filière énergétique porteuse, le groupe DCNS a été retenu pour à sa capacité à répondre aux problématiques liées au milieu marin et aux installations offshores. 3 Étapes du projet Pour maîtriser les risques financiers du projet, ERDF a décidé de le réaliser en deux phases. Une machine test en 2011 Une première phase est destinée à tester une machine en conditions réelles. Cette première hydrolienne a été installée durant l’été 2011 sur le site de la Horaine, pour être testée quelques mois sans raccordement au réseau. Elle a été ensuite sortie de l’eau et stockée sur une barge1, le temps de réaliser des modifications, voire de la maintenance, et dans l’attente de la seconde phase. L’objet a été de vérifier la pertinence des choix technologiques et éventuellement d’améliorer les performances et les conditions d’installation, pour limiter ainsi les risques industriels et environnementaux lors de la mise en place du parc de quatre machines. Les résultats obtenus permettent de valider en particulier les éléments suivants : conception, fabrication, installation, maintenance et impact environnemental. Un parc connecté au réseau en 2013 et 2014 La seconde phase consiste en l’installation, à terme, des quatre hydroliennes et en leur connexion à un convertisseur sous-marin, sur le site de la Horaine. Le passage d’un prototype de laboratoire à un démonstrateur commercial est le point clé de la réussite du projet. Cette étape permet donc la validation d’un parc hydrolien composé de quatre machines de 500 kW associées à un convertisseur immergé. Le raccordement au réseau ERDF se fera sur un poste à terre, à une distance de 15 km du parc hydrolien, par un câble immergé. Le passage à la phase d’industrialisation est conditionné par les résultats des essais en conditions réelles, en tenant compte des impératifs de rentabilité sur le cycle de vie des installations (réalisation, installation en mer, maintenance). Cahier des charges Une hydrolienne est une machine qui doit répondre aux critères suivants : se maintenir en place et résister aux forces hydrodynamiques du courant ; turbiner au mieux le flux d’eau du flot2 et du jusant3 pour produire de l’énergie mécanique ; transformer l’énergie mécanique en énergie électrique ; exporter la production électrique vers le réseau à terre ; produire une énergie électrique à un coût acceptable ; nécessiter un minimum de maintenance ; gêner au minimum la navigation et avoir un impact minimal sur la faune et la flore. Pour ces différentes raisons, une bonne implantation est indispensable et implique une parfaite connaissance des fonds marins et des courants. La maintenance doit être limitée. Les hydroliennes seront installées dans des zones de fort courant. Le temps d'intervention est donc contraint par les marées. Le temps disponible entre le flot et le jusant est d'environ deux heures. Les marées de faibles amplitudes (mortes eaux) sont réparties et limitent également l'organisation des opérations sur des périodes longues. C'est la raison pour laquelle le projet Openhydro DCNS doit être construit autour d'une solution robuste et la plus « simple » possible. 1 Barge : bateau à fond plat. 2 Flot : période pendant laquelle la marée est montante. 3 Jusant : période pendant laquelle la marée est descendante. 4 La conception du démonstrateur de Paimpol-Bréhat a nécessité une alternance de phases de modélisation et de validation par des tests. L’étude qui suit porte sur les différents éléments mis en œuvre depuis le démarrage du projet. Partie 1 - analyse du besoin L’objectif de cette partie est d’appréhender la solution proposée pour répondre au besoin exprimé par EDF de lancer la filière hydrolienne. Les ressources énergétiques des courants marins sont estimées à 10 TWh par an pour la France (source : LNHE, laboratoire national hydraulique et environnement). L’exploitation, même partielle, de ces ressources peut contribuer de façon non négligeable au marché de l’énergie et à la réduction des émissions de CO2. Q 1. À l’aide du diagramme FAST représenté sur le document technique DT3, compléter, sur le document réponse DR1, la chaîne fonctionnelle en précisant les noms des constituants des différentes parties. Indiquer les grandeurs d’effort (au- dessus de la demi-flèche) et de flux (au-dessous de la demi-flèche). Q 2. Sur le schéma de principe représenté dans le document réponse DR1, tracer la frontière du convertisseur. Indiquer les éléments suivants sur le schéma : machine synchrone, redresseur, bus continu, onduleur, et transformateur. Q 3. Justifier, à partir de l’introduction et des informations fournies dans les documents techniques DT1 et DT2, le choix de la technologie retenue par Openhydro et DCNS, en relevant les atouts écologiques d'intégration dans le milieu marin. Matériels immergés par des fonds de -35 à -38 m 5 Partie 2 - estimation des courants marins L’objectif de cette partie est de déterminer la mesure de la vitesse des courants marins en définissant l’autonomie énergétique du capteur avec les batteries utilisées par le constructeur, pour une campagne de mesures sur site. L'implantation des hydroliennes nécessite une parfaite connaissance des courants marins. Une mesure des courants a donc été confiée à l'Ifremer. L'utilisation d’un capteur de profil de courant de type ADCP (voir document technique DT4) permet de connaître la vitesse du courant à différentes hauteurs d'eau, et ainsi de valider le potentiel du site retenu pour le projet. Le point d’immersion est géographiquement défini et un socle de lestage y est coulé et fixé. Le capteur ADCP est immergé et fixé sur ce socle après planification du fonctionnement à l’aide d’un logiciel dédié, « Plan ADCP application » de Teledyne RD Instruments. uploads/Industriel/ concours-general-si-2014.pdf
Documents similaires




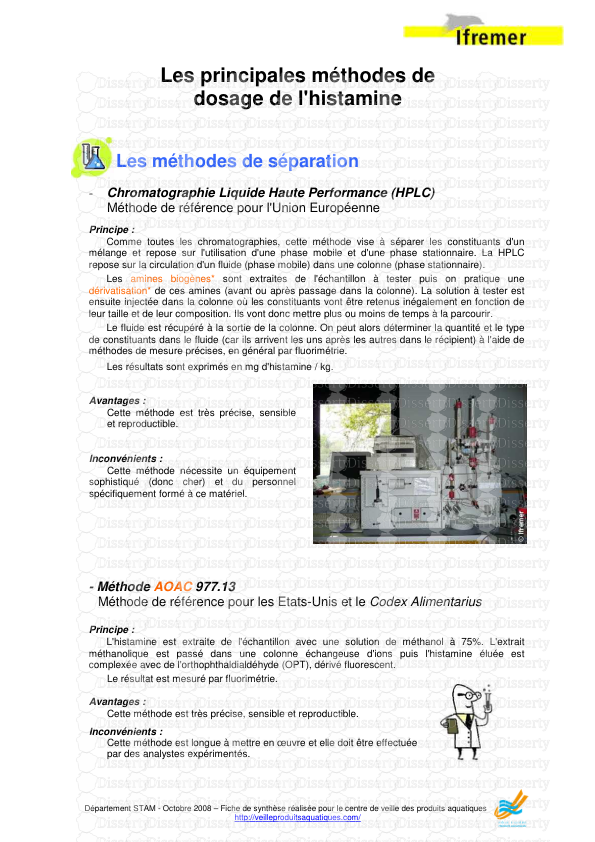




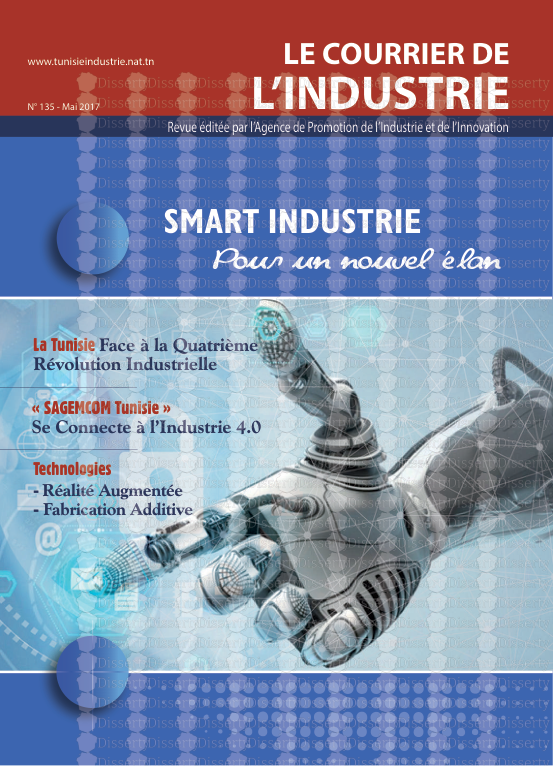
-
58
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 24, 2021
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 2.5891MB


