Mathieu SANDANA Mémoire de Fin d’Etudes d’ingénieur soutenu le 27/09/2012 en vu
Mathieu SANDANA Mémoire de Fin d’Etudes d’ingénieur soutenu le 27/09/2012 en vue de l’obtention du titre d’Ingénieur de l’Ecole Nationale Supérieure de Arts et Industries Textiles Conception, financement, fabrication et mise en place d’une machine de teinture textile écologique. Tutrice universitaire: Lova Razafimahefa Tutrice industrielle: Aurélia Wolff 2 Déclaration de non-‐plagiat J’atteste sur l’honneur que le présent rapport est le fruit d’un travail personnel que toutes les sources d’informations externes ont été mentionnées conformément aux usages en vigueur. Je certifie par ailleurs que je n’ai ni contrefait, ni falsifié, ni copié l’œuvre d’autrui afin de la faire passer pour mienne. 3 Remerciements Je tiens à remercier dans un premier temps Aurélia Wolf, directrice de Rosa Tapioca, pour la confiance qu’elle m’a accordée dans le cadre de ce projet ainsi que pour son implication. Je remercie Lova Razafimahefa, ma tutrice universitaire, pour son assistance et sa disponibilité. Je remercie Olivier Berut, qui nous a généreusement offert ses conseils avisés en terme de communication. Je remercie Craig Ambroise, acteur de l’innovation technologique dans le textile “Open Source” et relocalisée, pour son aide à la conception de la machine de teinture. Je remercie toutes les personnes ayant soutenu le projet dans le cadre de la campagne de financement participatif. Je remercie les différentes personnes, journalistes, blogueurs et internautes qui ont permis de faire connaître ce projet au moment de cette campagne. Enfin, je remercie tous les membre du FacLab (Laboratoire collaboratif) de l’université de Cergy-‐Pontoise, Olivier Gendrin, Adèle Khéniche et Laurent Ricard pour leur accueil et leur aide au sein du laboratoire. 4 Sommaire I. Présentation Générale:………………………………………………………………………..6 1. Le stage …………………………………………………………………………………………6 2.L’entreprise : Rosa tapioca………………………………...……………………………6 3.Les teintures végétales ……………………………………..……………………………7 a)Histoire ……………………………………………………………………………………..7 b)Chimie des teinture végétales ………………………………………………………8 i)Principe général…………………………………………………………………...8 ii)Molécules colorantes …………………………….……………………………..9 II. Les étapes du projet : ………………………………………………………………………10 1.Définition des objectifs et planification …..…………………………………….10 2.Conception de la machine ……………………………………………………………..12 a) Reconfiguration d’une machine à laver………………………………….………...12 b) Récupération d’une machine de teinture industrielle……………..………...14 c) création d’un nouvelle machine de teinture…………………………………......14 i) cuve…………………………………......…………………………………………………....14 ii) système de chauffage………………………………………………………………....15 iii) système d’agitation………………………………………………….……………......16 iv) fonctionnement général du modèle retenu……………….………………...16 3. Financement ….……………………………………………………………………………18 a) Principe du financement participatif …………..……………………………….18 b) Campagne de communication ………….....………………………………………18 4. Réalisation …………..………………………………………………………………………20 a) Les composants ..………………………………..………………………………….. 20 b) L’assemblage au Faclab ….………………...…...………………………………..22 5 5) Mise en œuvre...…….…………………………………………………………………...……..24 a) Obtention des matières tinctoriales..……..……………………………………24 b) Définition des procédés de teinture..………..……….…………………………24 i) extraction……………………………………………………………………….............24 ii)lavage…………………………………….…………………………………....................24 iii) mordancage……….…………...…...…………………………………………….......27 iv) teinture………………….…………………………………..……………………….....30 v) taux d’épuisement et récupération……………....….……….………………31 3)Tests…………………………………………………………………………………………….32 4) Industrialisation .………………………………………………….……………………..32 III. Impact écologique et économique ……………………………………………....33 1) Impact écologique général de la teinture textile …………….....…......…..33 2) Comparaison des impacts...……………………………………………………………..33 3) Evaluation économique.…..……………………………………………………………...35 Conclusion : …………………………………………………………………………………………….37 Bibliographie : ………………………………………………………………………………………..38 6 I. Présentation générale : 1. Le stage : Lors de mon semestre à l’étranger puis lors de mon stage de 2ème année, j’ai pu étudier les teintures à une échelle artisanale. Par défaut de temps et d’investissement financier je n’avais pas pu exploiter les potentiels écologiques et industriels de ce type de teinture. J’ai donc souhaité, dans le cadre de mon Projet de Fin d’Etudes, aller plus loin dans la démarche de développement durable à travers la réalisation d’une machine semi-‐industrielle destinée à réaliser ce type de teinture à une plus grande échelle et d’une manière plus économique et écologique. J’ai alors proposé ce projet à diverses entreprises textiles dans le domaine de la mode éthique, locale, équitable, écologique et biologique. Par l’intermédiaire de l’entreprise By Mutation j’ai été mis en contact avec Aurélia Wolff, directrice de Rosa Tapioca. 2. Rosa Tapioca Rosa Tapioca est une marque de prêt-‐à-‐porter féminin française créée en 2008 par l’entreprise Daphné Design. Depuis ses débuts, elle suit autant que possible les principes du développement durable que sont le localisme, le recyclage, et l’utilisation de matières biologiques. Les producteurs se situent en France ou en Europe, sauf pour la soie. La confection est réalisée à Paris et dans le bassin troyen. Contrairement à d’autres entreprises de mode éthique, elle ne mise pas entièrement sur cet aspect là dans le cadre de sa communication. En effet, le discours éco-‐responsable peut être risqué pour des collections moyen-‐haut de gamme. 7 3. Histoire des teintures végétales Les premières traces écrites évoquant la teinture textile datent du 3ème millénaire avant J-‐C et ont été retrouvées en Chine .1 Différentes civilisation à travers le monde ont étudié la flore afin d’y trouver des pigments pour la teinture textile. En Europe, au 19ème siècle la teinture textile représentait déjà une industrie importante. 2 Mais en 1856 William Perkins a synthétisé un colorant rouge à partir du goudron. La culture de la garance des teinturiers, dont les racines donnaient une couleur rouge, s’est alors arrêtée brusquement. Puis, toutes les autres plantes tinctoriales furent également délaissées au profit de teintures issues du pétrole. Ces nouvelles couleurs peu développées résistaient mal au lavage dans un premier temps mais elles étaient moins chères que les couleurs naturelles.1 A cause de cette rupture industrielle, les réactions moléculaires liées à la teinture végétale ont été relativement peu étudiées par les scientifiques.2 Mais aujourd’hui, avec la pénurie à venir du pétrole, et le besoin de valoriser la biodiversité et de réduire l’impact écologique de toutes les industries, on voit à travers le monde un regain d’intérêt pour ces procédés ainsi que pour les procédés de teinture écologique. Ainsi, les fibres synthétiques peuvent désormais être teintes par des technique écologique et économique de teinture n’utilisant pratiquement pas d’eau: il s’agit dpar exemple du procédé développé par Dyecoo Textile Systems qui repose sur le transport des molécules colorantes par le dioxyde de carbone supercritique (un état fluide obtenu pour de très hautes pressions et températures). Les molécules se diffusent en profondeur dans les fibres et le processus utilise un minimum d’eau.3 Notre projet consiste à trouver une solution plus écologique que les procédés standard pour la teinture des fibres naturelles par l’utilisation de teintures végétales. 8 4. Chimie des teintures végétales Principe général : Les teintures naturelles en cuve ont d’abord été étudiées et améliorées à travers le monde selon la méthode empirique. Aujourd’hui, les recherches doivent encore définir les différentes interactions complexes entre les fibres, les mordants et les molécules colorantes. Le mordançage est un processus par lequel une molécule métallique se lie avec une fibre avant de se lier à la molécule colorante, formant ainsi un complexe métallique insoluble. Le colorant est ainsi diffusé en profondeur dans la fibre.4 Dans le cadre de ce projet nous utilisons uniquement l’alun comme mordant. (KAl(SO4)2•12 H2O). Celui ci est soluble dans l’eau et c’est l’ion métalique Al(III) qui est impliqué dans les réactions de complexation. La présence de deux groupes hydroxyle (fig. 1) en position adjacente peut être responsable de la coordination entre la molécule colorante et l’ion métallique.4 fig 1. Groupement hydroxyle-‐ La chimie des liaisons se formant entre les colorants et les fibres est complexe et nous n’avons pas trouvé de littérature proposant des hypothèses concernant les liaisons entre les fibres naturelles et les complexes métalliques formés avec les molécules colorantes. Les résultats des tests de solidité (chapitre III.3) permettront de connaître les propriétés tinctoriales des différentes fibres. Ces réactions pourront faire l’objet d’analyses chimiques ultérieures réalisées en laboratoire pour l’entreprise Rosa Tapioca. Quelques molécules colorantes : Les différentes molécules colorantes naturelles existantes étant très nombreuses, nous nous intéresserons dans ce chapitre uniquement à celles que nous avons pu utiliser dans le cadre de ce projet : feuilles de carotte, peaux d’avocat, café, thé et pastel des teinturiers. Ces molécules sont solubles dans l’eau et peuvent former des complexes avec l’alun et les fibres naturelles. 9 Tannin : Le tannin est une molécule qui a la particularité de se fixer aux molécules de collagène (famille de protéine, souvent sous forme fibrillaire). L’acide gallique (fig.2), un tannin, est présent dans les feuilles de thé noir et vert (Camellia sinensis). 5 Fig 2. L’acide gallique, Chlorophylle: La chlorophylle est présente chez tous les végétaux mais elle est de structure fragile et n’offre pas une solidité suffisante pour la teinture des textiles. Pour obtenir des couleurs vertes on préfèrera utiliser une double teinture à base d’indigotine (bleu) et de lutéonile (jaune), plus résistante.5 Flavonoïdes: Les flavonoïdes sont présents dans presque tous les végétaux, elles permettent d’obtenir des colorants jaunes ayant souvent de faibles solidités à la lumière. Parmi les flavones, flavonoïdes plus solides à la lumière, il y a la lutéoline (fig. 3), présente dans des plantes tinctoriales comme le genêt (Genista tinctoria) et la gaude (Reseda luteola). 5 fig 3. lutéoline 10 II. Les étapes du projet : 1. Définition des objectifs et planification L’objectif du projet est de mettre en place des procédés de teintures végétales à partir de matières recyclées dans le cadre d’une production de petite échelle. L’intérêt pour l’entreprise est à la fois de mieux contrôler sa production et de créer un engouement autour de la marque. Nous avons dans un premier temps contacté plusieurs entreprises fabricant deu matériel de teinture en France et en Italie (Flainox, Cubotex, Color service srl, Obem s.p.a.) mais leurs propositions ne nous convenaient pas en termes de coûts et de dimensions, les uploads/Industriel/ rapportpfe.pdf
Documents similaires
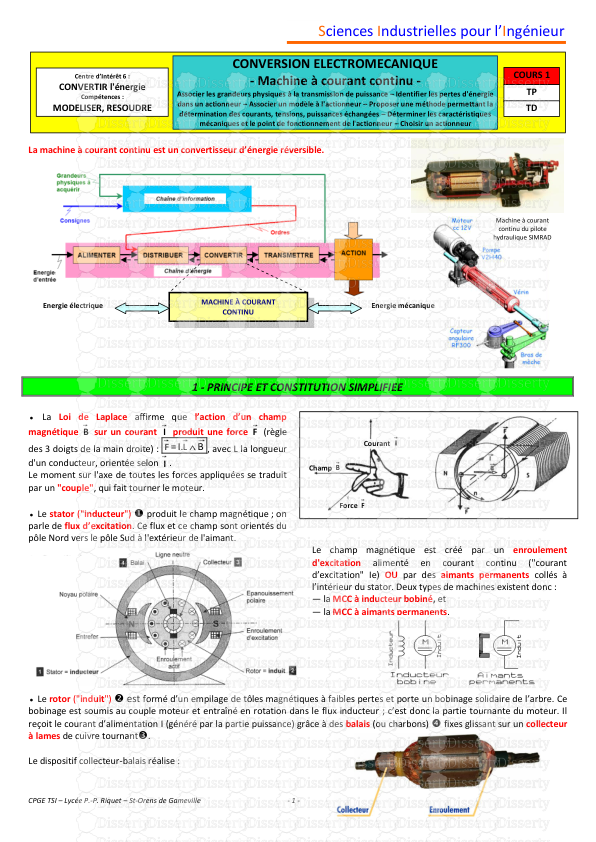









-
57
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 06, 2021
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 6.5554MB


