Résumé du cours de Métiers en ST Introduction : Le cours de Métiers en « Scienc
Résumé du cours de Métiers en ST Introduction : Le cours de Métiers en « Sciences et Techniques » est destiné à donner aux étudiants des troncs communs Technologie (ou ST) une visibilité sur les spécialités auxquelles ils peuvent prétendre à l’issue de la 1ère année de licence. Les étudiants de 1ère année n’ont en général aucune connaissance du monde industriel et les choix de spécialité sont le plus souvent subjectifs. Ce cours est donc venu combler une lacune et donner aux étudiants des informations sur le contenu des spécialités (des filières) ; sur les postes de travail qu’ils sont susceptibles d’occuper à l’issue de leur formation. C’est donc essentiellement un cours de vulgarisation scientifique, de culture générale « orientée » vers le monde de l’industrie en particulier et le monde professionnel en général. Dans la plupart des universités algériennes, on retrouve en 2ème année LMD, quatre domaines de formation, à l’issue du tronc (ou socle) commun ST : ce sont : - Le Génie des procédés - Le Génie électrique - Le Génie civil - Le Génie mécanique I. Le Génie des procédés : Anciennement appelé « Génie chimique » , le Génie des procédés regroupe l’ensemble des connaissances et des méthodes, basées sur les lois de la physique et de la chimie, qui permettent de réaliser des transformations physiques et chimiques à l’échelle industrielle. Il est important de souligner qu’on ne parle de « Génie des procédés », que si le processus industriel concerné comporte au moins une transformation chimique, donc que la formule chimique des produits finis est différente de la formule chimique des matières premières. Il faut également souligner l’importance du terme « échelle industrielle » qui implique une production en masse (en quantités industrielles) et en continu (à cadence industrielle). L’échelle industrielle implique donc l’utilisation de machines, d’équipements industriels divers qu’il faut savoir faire marcher simultanément et de façon continue. L’échelle industrielle n’a donc rien à voir avec les manipulations de laboratoire. Les processus industriels reposent en générale sur un ensemble d’opérations appelées « opérations unitaires » qui peuvent être identiques pour des fabrications industrielles différentes. Par exemple, on retrouve l’opération de « broyage », (avec des machines appelées broyeurs) aussi bien dans les industries alimentaires ; qu’en métallurgie. NB. Le génie des procédés est encore appelé « Chemical Engineering » dans les pays anglo-saxons. Filières du génie des procédés : - Fabrication des principaux réactifs chimiques utilisés par un grand nombre d’industries (ex. acide sulfurique, acide chlorhydrique, ammoniac, chlore etc..). Par exemple, la production mondiale d’acide sulfurique se chiffre en millions de tonnes par an. - Industrie des matériaux de construction (ciment, plâtre, briques etc..) - Industrie agroalimentaires (conserveries, laiteries, raffineries de sucre, production d’huiles et de margarines etc..) - Industries des savons et détergents, des désinfectants etc.. - Fabrication d’engrais chimiques - Fabrication des pesticides - Industries du pétrole et du gaz - Pétrochimie et plastiques - Industrie du papier - Industries de l’environnement (ex. épuration des eaux usées, purification de l’air etc..) - Production des shampoings et cosmétiques - Sécurité industrielle(HSE) - Industries textiles etc… Le domaine d’intervention d’un diplômé en génie des procédés est très vaste. La formation est basée sur la connaissance des lois de la chimie, sur la connaissance des propriétés chimiques des matériaux sur les transferts de matière et de chaleur pour aboutir à la maitrise des opérations unitaires. L’enseignant devra expliquer aux étudiants quelques opérations de fabrications industrielles. II. Le Génie civil : C’est l’ensemble des connaissances scientifiques et techniques, basées sur les lois de la physique qui permettent de concevoir et de réaliser des constructions fixes. On parle de génie civil par opposition au « génie militaire » qui est plutôt axé sur la réalisation d’ouvrages à caractère militaire (ex. fortifications, ponts mobiles etc..) Domaines d’intervention du Génie civil : - Constructions à usage d’habitation, de la petite maison individuelle jusqu’aux cités entières. - Constructions industrielles (usines) - Installations portuaires - Ponts et tunnels - Barrages et digues Un diplômé en Génie civil est en principe capable de concevoir une construction, de réaliser les plans, d’effectuer les calculs nécessaires à l’établissement des devis matériels et financiers, sans oublier le suivi de la réalisation (la réalisation physique étant effectuée par une ou plusieurs entreprises de construction). En général, l’ingénieur ou le master en génie civil travaille dans un bureau d’études de génie civil ou dans un cabinet d’architecture (mêmes missions et mêmes responsabilités). L’ingénieur en génie civil maitrise en principe plusieurs domaines d’expertise ce qui lui permet de travailler aussi bien dans la construction à usage d’habitation que sur des routes, des barrages, des systèmes hydrauliques alors que l’architecte est plutôt axé sur les constructions de bâtiments en y intégrant le coté esthétique. Quelqu’un a dit que l’architecte était un rêveur qui imagine des bâtiments et l’ingénieur est celui qui les transforme en réalité en faisant les dessins et les calculs nécessaires. Quoiqu’il en soit, il n y’a pas de frontière précise entre les attributions d’un ingénieur en génie civil et celles d’un architecte. A titre d’exemple, un projet de génie civil passe en général par les étapes suivantes : 1- Contact entre un propriétaire de terrain (ou son représentant) et un bureau d’études (ou cabinet d’architecture). Le propriétaire est désigné par le nom de « maitre de l’ouvrage », le bureau d’études est appelé « maitre d’œuvre » (= responsable de la bonne exécution du projet). Pour les projets importants, on passe généralement par un appel d’offres national ou international, par des soumissions puis par une sélection. En général, c’est le moins disant à offre technique comparable qui est sélectionné. 2- Maturation du projet après une série de réunions entre le maitre de l’ouvrage et le représentant du bureau d’études (chef de projet). 3- Etablissement des plans définitifs, des devis matériels et financiers et des échéanciers. 4- Sélection d’une ou plusieurs entreprises de réalisation selon que l’on considère un lot unique ou des lots séparés (gros œuvres, maçonnerie, menuiserie etc..) 5- Versement d’une avance de 5 à 10% à l’entreprise de réalisation pour que celle-ci puisse installer son chantier et entamer les travaux. 6- Avancement des travaux à un rythme plus ou moins régulier sous le contrôle du bureau d’études (= suivi de réalisation) et d’un laboratoire agrée (qui contrôle la qualité des matériaux de construction et la conformité de la construction elle-même. 7- L’entreprise de réalisation reçoit des versements (d’argent) à intervalles plus ou moins réguliers en fonction de l’avancement des travaux. 8- A la fin des travaux, une réunion « technique » permet d’identifier les insuffisances éventuelles qui feront l’objet de « réserves ». on effectue alors une réception provisoire, un délai de 6 à 18 mois est en général suffisant pour permettre aux éventuels défauts d’apparaitre et de les corriger. Après ce délai et après donc la levée de réserves, le maitre de l’ouvrage et le maitre d’œuvres procèdent à la réception définitive du projet et libèrent les sommes restantes. III. Génie électrique : C’est l’ensemble des connaissances et des méthodes basées sur les lois de la physique (électricité, magnétisme, énergétique etc..) qui permet de produire,de transporter et d’utiliser l’énergie électrique. On distingue généralement deux parties dans le génie électrique : - L’électrotechnique qui est la science (appliquée) qui permet de produire l’énergie électrique, de la transformer, de la transporter et de l’utiliser en général pour les « gros travaux ». On considère habituellement l’électrotechnique comme la science des courants forts. - L’électronique, science appliquée, science des applications « électroniques » axée sur le (traitement du signal, le signal étant une information que l’on cherche à envoyer d’un point A (origine de signal)) à un point B (réception du signal). L’information est donc convertie en courant électronique faible (quelques milliampères qui se déplace à vitesse très élevée (de l’ordre de 106 km/s). le gain de temps est donc évident. L’électronique est considérée comme étant la science des courants faible, bien que rien n’empêche d’utiliser des courants forts pour transmettre un signal, si ce n’est le souci de sécurité et d’économie. 1- Electrotechnique : 1.1- Production de l’énergie électrique : L’électricité n’existe pas dans la nature sous forme directement utilisable. Il fau donc la produire. On sait le faire depuis que l’on a appris le lien entre électricité (déplacement d’électrons) et magnétisme. La production d’électricité nécessite une source d’énergie primaire. La civilisation actuelle est basée sur l’utilisation des combustibles fossiles (charbon, pétrole et gaz naturel) qui sont brulés dans les centrales thermiques. La chaleur obtenue permet de chauffer de l’eau, de produire de la vapeur qui fait tourner des turbines (grandes roues) reliées à des enroulements de conducteurs d’électricité autour d’un noyau magnétique (principe de la dynamo qui allume les phares des bicyclettes et des motos). Les combustibles fossiles que l’on utilise à grande échelle depuis environs un siècle ont causé un désastre (une catastrophe) pour l’humanité (pollution, changements climatiques, maladies etc..). Il existe d’autres sources d’énergie primaires plus sures : - Energie nucléaire : basée sur l’utilisation d’un combustible nucléaire (= Uranium ou uploads/Industriel/ resume-du-cours-de-metiers-en-st.pdf
Documents similaires






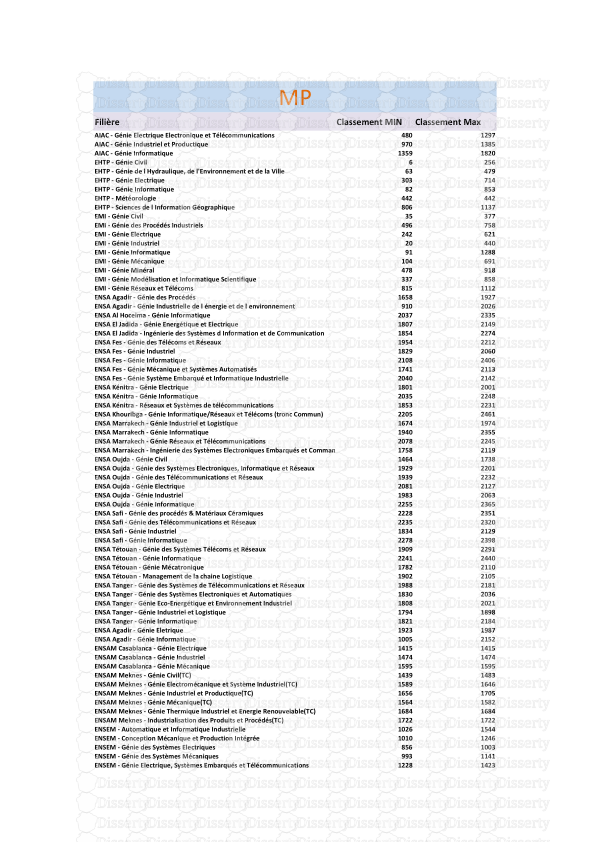



-
32
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 06, 2022
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1538MB


