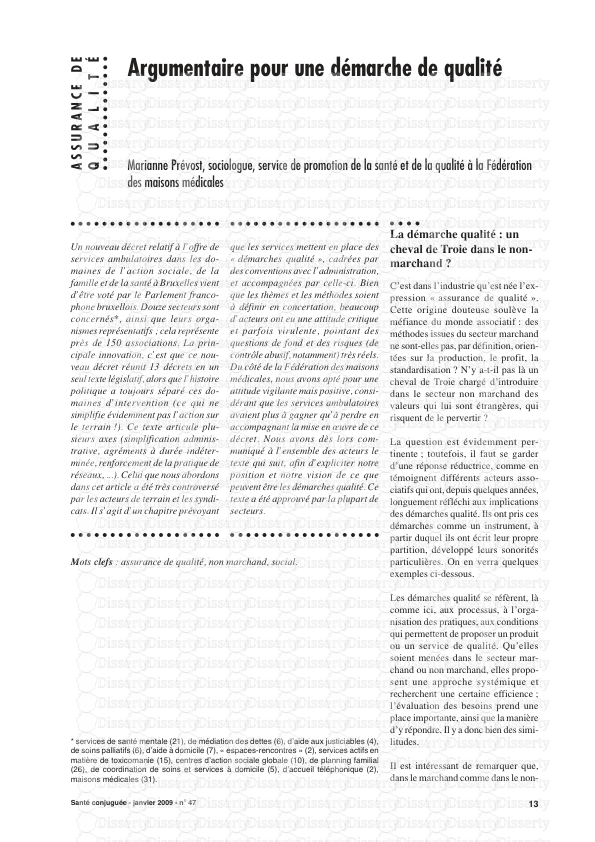13 Santé conjuguée - janvier 2009 - n° 47 A S S U R A N C E D E ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
13 Santé conjuguée - janvier 2009 - n° 47 A S S U R A N C E D E ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Q U A L I T É Argumentaire pour une démarche de qualité Marianne Prévost, sociologue, service de promotion de la santé et de la qualité à la Fédération des maisons médicales ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Mots clefs : assurance de qualité, non marchand, social. ○ ○ ○ ○ La démarche qualité : un cheval de Troie dans le non- marchand ? C’est dans l’industrie qu’est née l’ex- pression « assurance de qualité ». Cette origine douteuse soulève la méfiance du monde associatif : des méthodes issues du secteur marchand ne sont-elles pas, par définition, orien- tées sur la production, le profit, la standardisation ? N’y a-t-il pas là un cheval de Troie chargé d’introduire dans le secteur non marchand des valeurs qui lui sont étrangères, qui risquent de le pervertir ? La question est évidemment per- tinente ; toutefois, il faut se garder d’une réponse réductrice, comme en témoignent différents acteurs asso- ciatifs qui ont, depuis quelques années, longuement réfléchi aux implications des démarches qualité. Ils ont pris ces démarches comme un instrument, à partir duquel ils ont écrit leur propre partition, développé leurs sonorités particulières. On en verra quelques exemples ci-dessous. Les démarches qualité se réfèrent, là comme ici, aux processus, à l’orga- nisation des pratiques, aux conditions qui permettent de proposer un produit ou un service de qualité. Qu’elles soient menées dans le secteur mar- chand ou non marchand, elles propo- sent une approche systémique et recherchent une certaine efficience ; l’évaluation des besoins prend une place importante, ainsi que la manière d’y répondre. Il y a donc bien des simi- litudes. Il est intéressant de remarquer que, dans le marchand comme dans le non- Un nouveau décret relatif à l’offre de services ambulatoires dans les do- maines de l’action sociale, de la famille et de la santé à Bruxelles vient d’être voté par le Parlement franco- phone bruxellois. Douze secteurs sont concernés*, ainsi que leurs orga- nismes représentatifs ; cela représente près de 150 associations. La prin- cipale innovation, c’est que ce nou- veau décret réunit 13 décrets en un seul texte législatif, alors que l’histoire politique a toujours séparé ces do- maines d’intervention (ce qui ne simplifie évidemment pas l’action sur le terrain !). Ce texte articule plu- sieurs axes (simplification adminis- trative, agréments à durée indéter- minée, renforcement de la pratique de réseaux, ...). Celui que nous abordons dans cet article a été très controversé par les acteurs de terrain et les syndi- cats. Il s’agit d’un chapitre prévoyant que les services mettent en place des « démarches qualité », cadrées par des conventions avec l’administration, et accompagnées par celle-ci. Bien que les thèmes et les méthodes soient à définir en concertation, beaucoup d’acteurs ont eu une attitude critique et parfois virulente, pointant des questions de fond et des risques (de contrôle abusif, notamment) très réels. Du côté de la Fédération des maisons médicales, nous avons opté pour une attitude vigilante mais positive, consi- dérant que les services ambulatoires avaient plus à gagner qu’à perdre en accompagnant la mise en œuvre de ce décret. Nous avons dès lors com- muniqué à l’ensemble des acteurs le texte qui suit, afin d’expliciter notre position et notre vision de ce que peuvent être les démarches qualité. Ce texte a été approuvé par la plupart de secteurs. * services de santé mentale (21), de médiation des dettes (6), d’aide aux justiciables (4), de soins palliatifs (6), d’aide à domicile (7), « espaces-rencontres » (2), services actifs en matière de toxicomanie (15), centres d’action sociale globale (10), de planning familial (26), de coordination de soins et services à domicile (5), d’accueil téléphonique (2), maisons médicales (31). ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 14 Santé conjuguée - janvier 2009 - n° 47 marchand, c’est lors d’un moment de transformation et de progrès que l’ac- cent est mis sur la qualité. Dans l’in- dustrie, le développement de la pro- duction, de la mobilité et du commerce mondial nécessitent la mise au point de normes communes : pour faciliter les échanges et rendre les produits compatibles, notamment ceux qui doivent être sécurisés. Les démarches de qualité et les normes concerneront non seulement le produit lui-même mais viseront aussi à examiner l’orga- nisation et le contexte de fabrication. Et les travailleurs, qui ne sont plus les automates du taylorisme sont associés à ces démarches, car ils disposent de savoirs pratiques et de logiques d’ac- tion intervenant dans le processus de production. Quant aux clients, ils sont de plus en plus considérés : la concur- rence commerciale impose de les séduire et de les convaincre. Restent évidemment entièrement ouvertes les questions de fond liées au type de projet incarné par une société mar- chande en pleine croissance… Dans le secteur non marchand, public ou associatif, le mouvement vers la qualité apparaît dès les années 70. Il est contemporain d’une désinstitu- tionalisation qui prend des formes diverses selon les secteurs. Un peu partout, on cherche à redéfinir les pratiques, on questionne hiérarchies, mandarinats et modes de gestion ; on considère les usagers comme des ac- teurs participants, et non plus seule- ment comme des « bénéficiaires à prendre en charge ». Certains vont jusqu’à parler d’une « révolution culturelle » ; et la recherche de qualité, dans un contexte de questionnement et de créativité, implique l’évaluation régulière des services offerts et de la manière de les produire. Les démarches de qualité dans le secteur non marchand ont donc bien des points communs avec celles qui se développent dans le secteur mar- chand, en terme d’origine, de con- cepts, de méthodologie, et de finalité : il s’agit de « faire mieux ». Mais le parallélisme s’arrête là ! Tout simplement parce que le « faire mieux » ne signifie pas la même chose dans l’un et l’autre monde : pour le secteur non marchand, il ne s’agit pas de mieux vendre mais de trouver du sens. Il ne s’agit pas de créer toujours plus de besoins artificiels, mais de faire place au désir, d’accompagner des sujets en souffrance et en difficulté psycho-sociale. Il ne s’agit pas de transformer l’humain en « ressource » soumise au marché mais de rendre à l’humain une place niée par le marché. Etc. La question des valeurs, centrale dans nos projets ne peut que l’être aussi dans les démarches de qualité : les valeurs, les finalités guident l’élabo- ration des démarches, la définition d’objectifs, de critères et d’indicateurs d’évaluation. Dès lors, les démarches de qualité peuvent soutenir le renfor- cement et l’évolution des pratiques dans le secteur non marchand en fonction de ses propres références, comme le montrent les quelques exemples cités ci-dessous. ○ ○ ○ ○ Démarches qualité : mise en pratique dans le secteur associatif D’autres secteurs ont déjà, il y a quelques années, réfléchi dans ce sens. En l995, la CIRAT (Coordination inter régionale des associations et de leurs travailleurs) proposait un « label de qualité associative » pour les petites et moyennes associations, ainsi qu’une charte définissant les critères de qua- lité suivants : décision libre de s’asso- cier, avec participation et capacité de décision pour les différents acteurs ; définition d’un projet commun, conçu comme « ouvrant une brèche dans les orientations dominantes de nos so- ciétés où tout est subordonné à la performance économique… » ; fonctionnement de type démocratique, avec des lieux décentralisés et inter- actifs de pouvoir, de décision, d’éva- luation et de contrôle, … ; vigilance vis-à-vis des risques de discordance entre parole et discours, de rigidi- fication institutionnelle… A la même époque, l’Office de la naissance et de l’enfance avait élaboré un « code de qualité » et délivrait une attestation de qualité valable trois ans aux institutions en faisant la demande et acceptant son évaluation. Le but de ces démarches : améliorer l’accueil des enfants et de leurs parents, mais aussi le rendre plus cohérent, assurer une continuité entre les différents milieux d’accueil. La qualité concerne ici le service offert (principes pédago- giques, activité et santé, accessibilité, encadrement, relations avec l’environ- nement) mais aussi la manière de le produire (évaluation régulière, partici- pation des accueillantes, consultation des parents…) et la formation continuée. Même type d’intérêt chez Lire et Ecrire, qui a fait un long travail avec le Collectif Alpha et des associations étrangères pour élaborer un outil destiné aux animateurs : « Un cadre pour évoluer vers plus de qualité ». Argumentaire pour une démarche de qualité (suite) ○ ○ uploads/Industriel/ sc47r-prevost.pdf
Documents similaires










-
71
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 20, 2022
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 0.0838MB