Le règlement REACH Conséquences pour la prévention des risques chimiques en mil
Le règlement REACH Conséquences pour la prévention des risques chimiques en milieu professionnel Documents pour le Médecin du Travail N° 109 1er trimestre 2007 7 dmt TC 112 M.REYNIER Chargée de mission à la Direction scientifique de l’INRS d o s s i e r m é d i c o - t e c h n i q u e Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté en décembre 2006 le règlement REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals) (1), après de longs débats qui ont mis en évidence les enjeux socio-économiques de ce texte. Ce règlement, qui entrera en vigueur le 1er juin 2007, vise à améliorer les connaissances sur les substances chimiques et à mieux maîtriser les risques pour l’homme et pour l’environnement sans porter atteinte à la compétitivité de l’industrie. Cet article présente les étapes essentielles et l’apport du nouveau dispositif pour la prévention des risques chimiques en milieu professionnel. En résumé L’objectif de cet article est de présenter les étapes es- sentielles du règlement européen REACH relatif aux sub- stances chimiques qui entre en vigueur le 1er juin 2007 et son apport pour la prévention des risques chimiques. Quatre dispositions importantes sont introduites : - une procédure d’enregistrement des substances pro- duites ou importées en quantité supérieure ou égale à 1 t/an ,qui s’étalera sur dix ans à partir du 1er juin 2008 ; - l’évaluation, par l’Agence ou les Autorités compé- tentes des États membres, des dossiers ou des sub- stances sélectionnés en fonction du tonnage, des risques potentiels ou d’autres critères ; - un inventaire des classifications et étiquetages des substances dangereuses ; - une nouvelle procédure d’autorisation incitant les fa- bricants et utilisateurs à la substitution des substances les plus dangereuses ; - la création d’une Agence européenne des produits chimiques (ECHA), en charge des aspects techniques et administratifs du système ; REACH confie aux industriels la charge de la preuve en matière d’évaluation des risques. Les apports de REACH résident dans : - la production d’informations sur les dangers, les usages, les expositions et les risques des substances ; - la communication de ces informations dans la chaîne d’approvisionnement et, éventuellement, vers le public ; - le renforcement du principe de substitution pour les substances les plus dangereuses. P artant du constat que la légis- lation communautaire était insuffisante pour faire face à la mé- connaissance des effets de nombreuses substances existantes et que davantage d’efforts devaient être consacrés à la protection de la santé publique et de l’environnement, REACH intro- duit quatre dispositions nouvelles importantes : - une procédure d’enregistrement des substances ; - un inventaire des classifications et étiquetages des substances dangereuses ; - un nouvel outil de gestion des risques, l’autorisa- tion, incitant les fabricants et utilisateurs à la substitu- tion des substances très dangereuses ; - la création d’une Agence européenne des produits chi- miques (ECHA), en charge des aspects techniques et ad- ministratifs du système ; basée à Helsinki, elle devrait être opérationnelle un an après l’entrée de vigueur de REACH. Le nouveau dispositif (cf. figure 1) diffère par ailleurs des textes actuellement en vigueur en ce qu’il confie aux industriels la charge de la preuve en matière d’évaluation des risques : dans REACH, c’est aux fa- bricants et importateurs qu’incombe la responsabilité de démontrer que les substances peuvent être fabri- quées, utilisées et détruites sans entraîner des risques pour la santé humaine et pour l’environnement. Les autorités européennes et nationales devraient, quant à elles, concentrer leurs efforts pour contrôler et évaluer les substances les plus préoccupantes, telles que les CMR (2) ou les perturbateurs endocriniens. En France, les principaux ministères concernés par l’application de REACH sont le ministère de l’Écolo- (1) Réglement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, publié au JO de l’UE L 396 du 30 décembre 2006. (2) CMR : cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction. radioactives, médicaments, pesticides, biocides, addi- tifs alimentaires). Par ailleurs, certaines catégories de substances font l’objet d’un traitement particulier : - les polymères, en raison de leur nature particu- lière, sont exemptés d’enregistrement ; ce sont en fait les monomères qui servent à fabriquer les polymères qui sont soumis à l’obligation générale d’enregistre- ment ; - les substances utilisées à des fins de recherche et développement sont exemptées pour une durée de 5 à 10 ans, voire 15 ans pour les substances destinées à la mise au point de médicaments ; - les intermédiaires (3) font l’objet de mesures spéci- fiques : non isolés, c’est-à-dire non retirés des disposi- tifs de synthèse pendant le processus, ils sont exemptés d’enregistrement ; les autres peuvent bénéficier d’une forme d’enregistrement simplifié s’ils sont produits, transportés et utilisés dans des conditions où les risques sont parfaitement maîtrisés (système clos). Contrairement aux substances nouvelles qui seront enregistrées avant fabrication ou mise sur le marché, l’enregistrement des autres substances (4) sera progres- sif (cf. figure 2) et pourra s’étaler : - jusqu’au 1er décembre 2010, pour les substances produites à 1000 t/an ou plus (dont le nombre est es- timé à environ 2500), les substances CMR de catégo- rie 1 ou 2 produites à 1 t/an ou plus ainsi que les Documents pour le Médecin du Travail N° 109 1er trimestre 2007 8 gie et du développement durable, qui jouera le rôle de coordinateur, le ministère chargé du Travail et le mi- nistère chargé de la Santé. Ils s’appuieront sur l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET) et sur le Bureau d’évaluation des risques des produits et agents chimiques (BERPC). L’enregistrement des substances L’enregistrement s’applique à partir du 1er juin 2008 et s’étalera sur 10 ans. Il fait obligation aux fabricants ou importateurs de substances de déposer un dossier d’enregistrement auprès de l’Agence européenne. Il concerne les substances produites ou importées, telles quelles ou contenues dans des préparations, en quan- tités supérieures ou égales à 1 tonne par an. Par ailleurs, les substances présentes dans des articles (ob- jets ou produits d’équipement) peuvent, sous certaines conditions (en particulier lorsqu’elles sont destinées à être rejetées au cours de l’emploi) faire l’objet d’une obligation d’enregistrement. L’enregistrement n’est pas applicable aux substances déjà couvertes par d’autres réglementations (substances Fig. 1 : le système REACH. (3) Substances utilisées dans l’industrie chi- mique ou pharmaceu- tique pour la synthèse d’autres substances. (4) Les substances bénéficiant d’un régime transitoire sont celles qui figurent dans l’in- ventaire EINECS et celles qui ont été pro- duites mais pas mises sur le marché durant les 15 ans qui précè- dent l’entrée en vigueur de REACH. 99634 007-14 16/03/07 19:39 Page 8 Documents pour le Médecin du Travail N° 109 1er trimestre 2007 9 substances PBT (5) produites à 100 t/an ou plus (envi- ron 850 substances) ; - jusqu’au 1er juin 2013, pour les substances produites en quantités comprises entre 100 et 1000 t/an (environ 2500 substances) ; - jusqu’au 1er juin 2018, pour les substances pro- duites en quantités comprises entre 1 et 100 t/an (soit environ 5000 substances produites entre 10 et 100 t/an et 25 000 substances produites entre 1 et 10 t/an). Pour bénéficier de ce régime transitoire, les indus- triels ont la possibilité de notifier à l’Agence, entre le 1er juin et le 1er décembre 2008, leur intention d’enre- gistrer les substances. Cette procédure de pré-enregis- trement a pour objectif de favoriser les accords entre opérateurs concernés par la même substance, pour la soumission d’un dossier d’enregistrement unique et le partage des données. LE CONTENU DU DOSSIER D’ENREGISTREMENT Le dossier d’enregistrement comprend notamment : - des informations sur la substance : propriétés phy- sico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques, usages et conseils d’utilisation ; - la classification et l’étiquetage de la substance ; - un rapport sur la sécurité chimique si les quantités sont supérieures à 10 tonnes par an (cf. infra). Les informations exigées augmentent en fonction des quantités produites ou importées, des dangers po- tentiels de la substance et du degré d’exposition (ta- bleau I). Pour les substances produites ou importées en quantité inférieure à 10 tonnes par an, les informa- tions toxicologiques et écotoxicologiques à fournir sont réduites et ne sont exigées que pour certaines catégo- ries de substances telles que les substances nouvelles, les CMR de catégorie 1 ou 2, les substances dange- reuses qui ont un usage dispersif ou diffus. Afin de limiter les essais sur animaux, d’autres moyens peuvent être utilisés pour évaluer les proprié- tés des substances, sous réserve qu’ils conviennent pour la classification et l’étiquetage et pour l’évaluation des risques : - les données humaines pertinentes seront prises en considération ; - le recours aux méthodes alternatives, telles que les méthodes in vitro ou l’extrapolation à partir de substances structurellement proches (modèles (Q)SAR), sera en- couragé ; le développement de ces méthodes est reconnu comme l’un des objectifs de REACH ; - des dérogations pourront être demandées, lorsque le déclarant pourra prouver qu’une exposition humaine est exclue, pour certaines études lourdes exigées au Fig. 2 : le uploads/Industriel/ tc112-2.pdf
Documents similaires





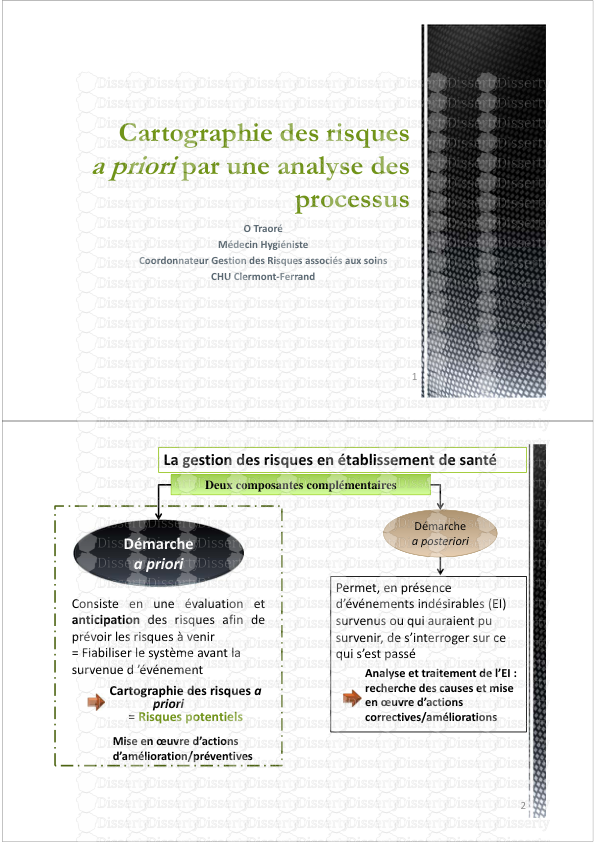




-
102
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 27, 2022
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1249MB


