La reconversion des thermes de Dioclétien à Rome: un exemple historique comme p
La reconversion des thermes de Dioclétien à Rome: un exemple historique comme paradigme pour l’actualité. Alessandro Bianchi Les cas complexes de reconversion et de reconstruction partielles des bâtiments anciens dans les lieux historiques témoignent d'un état de l'art bien plus ample et problématique qu'on pourrait le penser à première vue, surtout en Italie. La situation d'apparente stagnation dans laquelle verse la théorie de la restauration aujourd'hui est compréhensible, étant donnée la prégnance des arguments qui sont avancés par les différents courants de pensée. Les conservateurs philologiques voudraient une restauration pour ainsi dire "scientifique" visant la reconstitution du bâtiment "comme il était et où il était", en adaptant les fonctions modernes aux structures existantes; par contre les archéologues les plus radicaux tentent de répandre leur sphère d'influence aux bâtiments historiques plus récents (début XXeme siècle), en modifiant par conséquence l'idée de "restant architectural" en celle de "pièce archéologique", inviolable par nature théorique; finalement les architectes tout-court, sans préjugés par formation, voudraient agir avec la liberté la plus ample, selon le principe qui fut celui de l'architecte italien E. N. Rogers "conserver est un acte créateur". A. Chastel, disciple et héritier du courant révisionniste de H. Focillon, soutenait que depuis toujours l'art italien est marqué par de la reconversion critique de la ville et le changement des formes qui la constituent. Ainsi immeubles, églises et monuments sont connotés par une manipulation continue qui a déterminé sur eux des stratifications structurales et décoratives. Chastel écrivait : "Si nous pouvons parler d'abus dans la tradition en Italie, il est au champ de l'art que nous devons regarder, pour expliquer l'inclinaison à travailler toujours dans les mêmes lieux et sur les mêmes bâtiments […] mais avec le nouveau sentiment d'une distance historique qui invite les créateurs à ne pas s'inspirer à l'ancien qui pour l'égaliser, peut-être pour le dépasser"1. Alors nous assistons à l'éventualité de pouvoir reconstruire l'histoire d'un bâtiment par voie analytique à travers la lecture des manières de bâtir qui se superposent par "concrétion" dans les édifices, en rappelant l'attention des chercheurs scrupuleux sur l'approche logique et symbolique d'une société vers son propre paradigme de représentation. À travers ces processus, aujourd'hui nous reconnaissons les signes d'une époque qui nous a précédés: ainsi nous pouvons affirmer paradoxalement qu'un observateur inconscient pourrait aussi délinéer l'histoire architecturale et artistique de la ville seulement en observant et en classifiant les éléments qui se conservent, comme si elle était un "livre de texte"2. Les architectes ne peuvent pas oublier que le dialogue avec la ville est inéluctable, car il constitue vraiment la racine de leur existence culturelle en elle. À titre d'exemple, on peut rappeler que la figure de l'architecte se sépare de celle de l'artisan pour devenir une figure noble avec la Renaissance, au même moment que la ville renaît, et il s'habille de nouvelles manières qui dérivent de la tradition romaine et grecque. Dans cette acception, la ville à laquelle nous nous référons n'est pas entité abstraite et réalisable partout, parce que la ville a un sens quand elle révèle une mémoire: la ville est, en cet exemple, elle-même un bâtiment commémoratif macroscopique3. Michel-Ange4 aussi - et nous en venons au sujet de cette présentation - avec le restauration de l'église de Sainte-Marie des Anges à Rome située dans le tepidarium des Thermes de Dioclétien, démontre un profond respect de l'ancien bâtiment à travers la discrétion des ouvrages qui exaltent la spatialité des thermes anciens. Avec des additions modestes, la grande salle à la croisée a été transformée en une place liturgique à croix grecque répondant parfaitement aux idéaux de la Renaissance. En tant que “contemporain”, Michel-Ange intervient sur une architecture réalisée au IVeme siècle après J.C. : lui-même - le “divin Michel-Ange”, comme Gian Lorenzo Bernini le définit - affronte le problème du réemploi de l'ancien : sa solution est encore un modèle valide, malgré toutes ses particularités, pour évaluer les traits distinctifs d'un artiste qui a caractérisé l'histoire de l'architecture occidentale. L'exemple de Michel-Ange est sûrement un paradigme de comparaison approximatif, souvent inapproprié aux bâtiments sur lesquels nous nous trouvons à opérer; cependant, il peut aussi être considéré comme type, c'est-à-dire comme modèle intellectuel et culturel de comparaison par rapport aux thématiques de la conversion architecturale actuelle. En 1561 Michel-Ange reçoit la charge du Pape Pio IV pour transformer le Tepidarium des Thermes de Dioclétien en église, l'Église de Sainte Marie des Anges, sur l'idée précédente du prêtre sicilien Antonio del Duca du 1550. La raison de la reconversion est la même: l'année du jubilé. Del Duca obtient du Pape Giulio III la charge de traduire un édifice d'origine païenne en un consacré, opération pour longtemps impensable durant tout l'arc temporel médiéval, car l'hybridation du lieu liturgique n'était pas admise avec un milieu contaminé – pour origines – du païennetée. Pour un autre courant de pensée, “bien que les mécènes humanistes – dit J. S. Ackerman – aient déshabillé les ruines de chaque marbre et chaque colonne autant qu’il fût possible de transporter, leur respect pour les anciens était si grand qu'ils n'osèrent jamais provoquer une comparaison ouverte en adaptant les bâtiments classiques aux usages chrétiens”5. Et c'est le même profond respect qui s’infiltre dans le domaine ecclésiastique aussi (cause la philosophie platonicienne qui se répand en âge de la Renaissance en chaque cadre de la société), pour l'Ancien (il se voie la lettre pour main de Raffaello Sanzio et Baldassarre Castiglione adressée au Pape Giulio II sur l'Ancien6), à affaisser chaque perplexité sur la permission de la reconversion. “Del Duca – dit Bruno Zevi – n'était pas un architecte et il n'allait pas pour le mince: il voulait quatorze autels et il les aurait partout rangés […] Il choisit une directrice enfin: l'entrée arrivait de la rue Pia, c'est-à-dire de nord-ouest; les pèlerins traversaient les constructions périmétrals des thermes, puis le gymnase qui servait de portique, en pénétrant finalment dans la nef constituée en planimétrie par sept carrés; à droite et à gauche, files de chapelles: la ronde sud-occidentale avait été destinée à la sacristie”7. Michel-Ange, fils de la mûre saison classique romaine, à la fin de sa vie, il avait besoin d'une trame classique pour la disjoindre et la décomposer (aujourd'hui nous dirions pour “la de-bâtir”). Les thermes se prêtent à son opération – le sujet est classique – mais sa main s'arrête devant la volonté d'un geste exubérant, bouleversant, comme celui-là trempé succesivement par l’architecte Luigi Vanvitelli. Michel-Ange est incertain entre deux hypothèses: a) entrée du rond-point, et c'est- à-dire de l'axe inférieur, qu'elle apparaît plus respectueuse du monument; b) entrée de l'axe le plus grand, comme avait suggéré d’abord Del Duca, mais contrairement à lui, avec la double entrée, comme si la nef du Tepidarium dût devenir une rue intérieure de la ville. La solution, en définitive, est une synthèse des deux positions: le maître, dans la tentative de cacher le moins possible l'ancienne architecture et de la rendre le plus possible urbaine en ne limitant pas les entrées, il adopte les trois entrées en fondant une sorte de croix grecque, dont le troisième bras est fermé par l'autel. Dépourvu de décorations, le projet de Michel-Ange considère à faire vibrer les voûtes blanches puissantes. Il dit Tolnay: “Voûtes qu'ils semblent des voiles gonflées au-dessus de l’espace, seulement retenues par les arbres des colonnes. Donc elles n'apparaissent pas comme formes statiques, mais presque elles fussent créées par le regonflage vers le haut et de l'action des colonnes qui tirent vers le bas”8. À la suite de la mort de Michel-Ange, le programme architectural de la reconversion des Thermes en église continua par moments avec des réticences et reprises jusqu'à le 1572, an dans lequel avec Pape Gregoire XIII les travaux furent acheminés à une activité fiévreuse en vue de l'Année Saint 1575. Mais il dit encore Zevi, le programme de Michel-Ange fut si corrompu: “1. construction de six chapelles le long de la directrice rond-point-autel; 2. élimination graduelle de l'église du jeu spatial de quatre chappelles angulaires couvert à voûtes; 3. changement du choeur en tribune absidée qui en rétrograde le maître-autel et en décorant la zone du presbytère; 4. fermeture des entrées au nord-ouest et au sud-est, préludes aux destinations à chapelles de deux espaces latérales”9. Telles opérations ne comprirent absolument la valeur qui Michel-Ange avait attribué aux thermes, et en base à laquelle s'était apprêté à transformer la destination du monument. Et c'est-à- dire qu'une structure thermale, par importance et ampleur, n'est pas assimilable à un bâtiment isolé et individuellement identifié, et que donc ne peut pas etre traiter comme telle. Les thermes ont la propre caractéristique de “partie de ville” (tout ce qui se voie écrit par Aldo Rossi en L'architecture de la ville10), avec les propres rapports intérieurs, mais surtout avec la trame serrée de relations avec le tissu urbain environnant. Et en définitive, l'installation thermale, une “ville dans la ville”, avec ses propres espaces intérieures et extérieures, rues et places, lieux publics et privés: en transformant les destinations de quelques espaces aussi (dans le cas spécifique uploads/Ingenierie_Lourd/ 2001-bianchi-la-reconversion-des-thermes-de-diocletie.pdf
Documents similaires

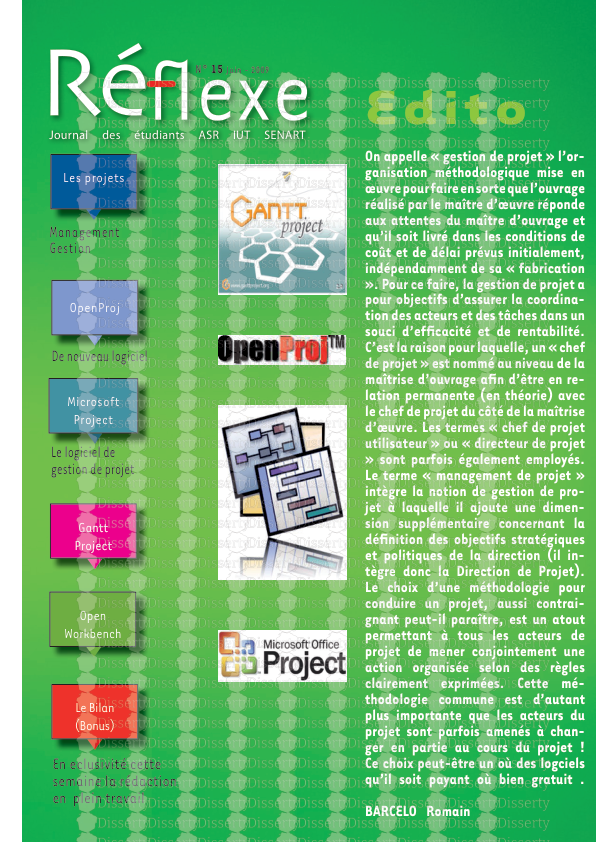








-
170
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 17, 2021
- Catégorie Heavy Engineering/...
- Langue French
- Taille du fichier 3.9428MB


