Le premier objet d’une mission d’audit de projet est d’évaluer la manière dont
Le premier objet d’une mission d’audit de projet est d’évaluer la manière dont les risques sont maîtrisés pour répondre de manière satisfaisante aux spécifications de coûts,de délais et de performances techniques fixées par le commanditaire1. Les caractéristiques de ces démarches d’exception contraignent l’auditeur à porter un jugement sur une réalité mouvante, exercice délicat qui se démarque des missions de contrôle des activités récurrentes de l’entre- prise. Pour ce type d’audit, il convient en effet de faire la part des choses entre les ajustements liés à des événements qui n’étaient pas prévisibles – par exemple le lance- ment sur le marché d’une nouvelle technologie ayant un impact sur la solution retenue pour le projet –, et les ajustements qui relèvent de la seule responsabilité du management du projet – par exemple la faiblesse des procédures de pilotage. La « méthodologie » de l’audit est le cheminement simple mais rationnel qui aidera l’auditeur à conduire sa démarche de contrôle. 1. Le cadre d’analyse de l’audit 1.1. Le projet informatique comme processus d’exception La notion de projet renvoie à l’idée d’une réalisation originale qui est assortie de contraintes de coûts et de délais et d’une grande complexité technique. Elle évoque dans les esprits la réalisation de programmes aérospatiaux, d’ouvrages d’art (ponts, tunnels, …) et d’opérations d’aménagement et de construction (non exhaustif) relevant des secteurs de pointe qui ont vu émerger la ges- tion de projets dans les années 1960. Les projets informatiques sont moins connus du grand public,peut- être parce que leur production débouche le plus souvent sur des images d’écrans,des programmes et d’autres éléments quasi - immatériels (cas des développements d’applica- tion). Ces derniers n’en sont pas moins soumis pour autant, à des degrés divers, aux mêmes contraintes et principes de mana- gement que les grands projets d’ou- vrage. La norme AFNOR X 50-105 de 1991 définit les projets comme « une démarche spécifique qui permet de structurer méthodiquement et progressivement une réalité à venir ». Le texte précise plus loin que le projet est caractérisé par la satisfaction d’un besoin spécifique et particulier, un objectif autonome, avec un début et une fin, et un caractère novateur. Le projet est ainsi défini dans ce qu’il a de plus singulier par opposition aux activités répétitives de l’entre- prise. Celles-ci se réalisent dans un contexte organisationnel stabilisé et concourent directement à la forma- tion des marges bénéficiaires alors que les tâches de développement d’un projet, quel qu’il soit, sont confrontées à des aléas et des incer- titudes, et génèrent essentiellement des coûts. De telles démarches sont à coup sûr plus risquées que la conduite des activités courantes. La réalisation d’un projet informatique commence généralement par l’ex- pression du besoin du commanditaire et s’achève par la livraison d’un pro- duit. Entre ces deux moments extrêmes, vont se succéder les phases de cadrage, de développe- ment (conception et spécifications) et de réalisation (du logiciel et des tests pour les applications) qui débouchent sur une production spécifique (les livrables). Chaque production est définie et approuvée au cours d’étapes (les jalons). 21 • La revue n° 82 - Mars 2006 Audit dossier Les spécificités de l’audit de projet Raoul Belot, Auditeur dans un groupe financier Raoul Belot a participé à la réalisation et au contrôle d’un nombre significatif de projets dans des domaines d’activité diversifiés. Il est l’auteur de l’ouvrage « Anti- ciper l’audit de projet » paru aux éditions AFNOR. Il est actuellement Auditeur au sein d’un grand groupe financier. 1. Personne qui fixe les objectifs du projet,définit ou fait définir les besoins fonctionnels et les contraintes futures d’utilisation du « produit », et en assume la responsabilité financière. Le commanditaire délègue la partie technique de ses prérogatives à un maître d’ouvrage.Il est le client du projet mais il n’est pas nécessairement le futur utilisateur. L’articulation du projet autour des phases et étapes permet d’atteindre progressivement l’objectif final.Sans cet engagement graduel de la démarche, les obstacles survenant en chemin ne pourraient pas être écartés. Cependant, différents fac- teurs, qui tiennent à la complexité technique du projet et à la lourdeur de l’organisation et des moyens à mettre en place,amènent à procéder à un découpage complémentaire du projet en fonction de critères de savoir-faire qui peut prendre la forme d’un organigramme technique (le WBS des Anglo-Saxons). La presse spécialisée mentionne régulièrement le coût des erreurs de conception et des dérapages de planning des projets. Les causes des dérives peuvent être imputables à la maîtrise d'œuvre ou à la maîtrise d'ouvrage,voire au manque de coor- dination entre les deux. Il peut s'agir encore de problèmes généraux d'organisation autour du projet. Au- delà de ces problèmes de coûts et de délais,on constate un pourcentage significatif d’abandons avant même d’entrer dans la phase de dévelop- pement. 1.2.Le contexte d’intervention et les objectifs de l’audit Les circonstances de la demande d’intervention conditionnent géné- ralement le sujet d’audit : difficultés prévisibles qui ont été détectées à l’occasion d’une revue du projet ; remplacement du chef de projet ; incident contractuel (risques de contentieux avec les fournisseurs) ; survenance d’un événement grave (fraude, accident…) ; relations conflictuelles entre services, etc. L’audit est amené à garantir que le projet se trouve dans un état satis- faisant ou qu’il est nécessaire de le mettre en conformité avec les objec- tifs, règles et procédures qui consti- tuent le référentiel des équipes char- gées de le mettre en œuvre.Lorsqu’il existe des écarts entre la situation projetée et la situation constatée, la mission d’audit est alors l’occasion de préconiser les actions de progrès pouvant favoriser la réalisation des objectifs. Les auditeurs sont susceptibles d’in- tervenir à n’importe quel moment. Pour le passé,les dossiers des revues de projet (revues d’évaluation tech- nique, revues d’avancement, ...) les informeront sur les éléments de mesure suivants : • les niveaux de performances atteints, • les risques déjà pris en compte, • les temps passés, • la partie du coût global déjà réa- lisée, • et la qualité des réalisations. Pour le futur, ces mêmes revues sont censées avoir évalué : • les performances attendues, • les risques restants, • les délais restants, • les prévisions de dépenses, • les coûts engagés, • et la qualité des réalisations. Lorsque la mission est engagée à la fin du projet, les auditeurs ne dispo- sent plus que de mesures puisque, à ce moment-là, les prévisions sont « épuisées ». Il faudra se livrer en conséquence à une « remontée dans le temps » pour tenter de com- prendre la façon dont le projet a été mené et la façon dont les arbitrages ont été rendus. La documentation du projet, en particulier le rapport d’achèvement, s’il a été élaboré suivant les règles de l’art, est alors incontournable. Les modifications qui sont intervenues en cours de route en disent généralement long sur la cohérence de la situation de départ et sur les faiblesses de cadrage du projet.Il conviendra d’analyser de la même manière la cause des dys- fonctionnements apparus dans la conduite de la démarche. L’histoire du projet servira ainsi à améliorer la pratique future de l’entreprise. 2. Le déroulement de la mission d’audit Elle se décompose généralement en trois phases : • la phase d’étude préliminaire,qui comprend la prise de connaissance de l’entité à contrôler, le dépistage des risques et l’orientation de la mission ; • la phase de réalisation de l’audit à proprement parler (exécution des travaux de contrôle) ; • la phase de conclusion de la mission (synthèse, présentation orale et rédaction du rapport). 2.1.La phase préliminaire ou la phase de préparation de la mission La démarche commence par un ordre de mission dont la forme et le contenu varient en fonction du contexte d’intervention. Il s’agit le plus souvent d’un document som- maire informant les responsables concernés de l’objet, des circons- tances et du calendrier de l’interven- tion. L’ordre de mission est suivi d’un premier contact avec les responsables du projet pour leur présenter la démarche projetée, mais surtout pour obtenir de leur part le « passeport » nécessaire à la suite des opérations. La détection des risques du projet passe par une phase de reconnais- sance des différents domaines dou- blée d’un examen critique de l’orga- nisation, des procédures et des processus mis en œuvre par les entités auditées. Les objectifs de pré-audit pour un projet d’une importance significative sont les suivants : 2.1.1. Prendre connaissance des caractéristiques du projet La présentation du projet doit logi- quement constituer le thème central des premiers échanges avec les responsables de l’entité auditée. En ce début de mission, il s’agit de s’informer,à grands traits seulement, sur l’histoire, les caractéristiques dossier :Audit 22 • La revue n° 82 - Mars 2006 23 • La revue n° 82 - Mars 2006 Audit dossier générales et techniques (choix de la solution), et l’état d’avancement du projet de façon à : • Situer le projet dans son environ- nement pour en comprendre les enjeux Les auditeurs vont s’interroger sur les origines du projet, lesquelles doivent pouvoir se raccorder avec les objectifs généraux de l’entreprise. Pour les projets à dominante straté- uploads/Ingenierie_Lourd/ 82pp21-25.pdf
Documents similaires


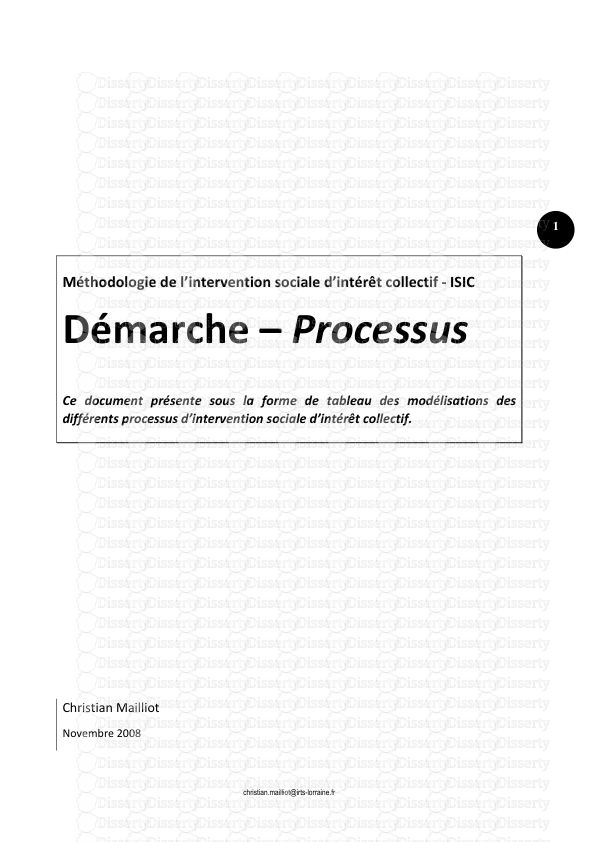







-
102
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 07, 2021
- Catégorie Heavy Engineering/...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1740MB


