1 Nicolas Bué, Fabien Desage, Laurent Matejko (CERAPS, Lille 2) Paru dans Dolez
1 Nicolas Bué, Fabien Desage, Laurent Matejko (CERAPS, Lille 2) Paru dans Dolez (B.), Paris (D.), (dir.), Métropoles en construction. Territoires, politique et processus, L’Harmattan, 2004, p. 71-93. La « métropole » n’est-elle qu’un mot ? Retour critique sur un « lieu commun » « Eh bien que voyez-vous ? » « Personne » répondit Alice. « Je donnerais cher pour avoir des yeux comme les vôtres », fit observer, d’un ton irrité, le monarque. « Etre capable de voir Personne, l’Irréel en personne. Et à cette distance, par dessus le marché ! Vrai, tout ce dont je suis capable pour ma part c’est de voir parfois quelqu’un de bien réel ! ». Lewis Carroll , De l’autre côté du miroir, 1872. La politique des « métropoles d’équilibre » de la DATAR1, au début des années 60, redonne une actualité à un terme ancien, tombé quelque peu en désuétude (Ginet, 1997). C’est cependant au début des années 90 que son usage connaît un regain spectaculaire, supplantant les notions d’agglomération ou d’arrondissement. L’exemple lillois − qui sera essentiellement mobilisé ici − suffit à s’en convaincre : la CCI de Lille-Roubaix-Tourcoing devient ainsi CCI Lille Métropole en 1997, la Voix du Nord crée au début des années 1990 une rubrique quotidienne « Lille-Métropole », le Lille Olympique Sporting Club, comme beaucoup d’autres clubs sportifs, devient le Lille Métropole Olympique Sporting Club à la fin des années 90. Last but not least, la Communauté Urbaine de Lille change de nom le 13 décembre 1996 et devient Lille-Métropole Communauté Urbaine. On pourrait multiplier à l’envie les exemples de « métropolisation nominale », qui touchent entreprises, offices HLM ou administrations2. Si le mot connaît un succès profane, il est également de plus en plus fréquemment mobilisé dans les travaux des universitaires consacrés au développement spatial, économique et politique des grandes aires urbaines3, bien au-delà des seuls géographes4. 1 Délégation à l’Aménagement Territorial et à l’Action Régionale. 2 Même la revue du Conseil Général du Nord (Magazine Le Nord), l’une des institutions qui a le plus à craindre du renforcement de l’intercommunalité, comporte depuis peu une sous-rubrique « métropole ». 3 Pour ne citer que quelques exemples traversant les frontières disciplinaires, on retiendra en histoire : « La naissance d’une métropole : les politiques urbaines des années 70 à nos jours », dans Trénard (L.) et Hilaire (Y.- 2 La première caractéristique de cette notion se situe donc dans son indéniable ubiquité sociale. Cette circulation entre univers savant et profane, mais également entre disciplines, ne contribue pas, loin s’en faut, à sa clarté5. D’autant moins que sa signification a largement évolué depuis les années 60 et reste sujette à de nombreuses interprétations contradictoires (Ginet, 1997). Elle est tantôt mobilisée comme concept pour caractériser une certaine centralité urbaine, tantôt comme figure rhétorique de l’internationalisation ou encore comme simple commodité de langage, synonyme d’agglomération. Dans un premier temps, et à l’aune de nos travaux respectifs sur le sujet − achevés (Matejko, 2001 ; Bué, Desage, Matejko, 2003) ou en cours − nous essaierons de montrer que le succès de cette notion doit probablement beaucoup à son imprécision et à la plasticité des usages qu’elle autorise. Il doit également à la présence de « passeurs », acteurs multipositionnés dans différents univers sociaux (savants, politiques et experts) dont l’intérêt à faire exister la notion rencontre celui d’un certain nombre d’acteurs à y croire. Au terme de métropole est fréquemment adjoint celui de « métropolisation », censé rendre compte de la dynamique de transformation en cours des aires urbaines en métropoles. Sans vouloir nier toute portée à ces mutations, nous soulignerons dans un second temps les risques d’évolutionnisme d’une telle approche, quand elle tend à présenter ces transformations comme l’adaptation inévitable et uniforme des territoires et des gouvernements urbains aux évolutions économiques mondiales6. Au-delà de la chimère fonctionnaliste de l’« optimum territorial » que cette conception entretient (Lefèvre, 1999), on doit également souligner sa propension à négliger les résistances institutionnelles à la métropolisation ou à les réduire à une affaire de volontarisme. Pour le dire autrement, les travaux sur la métropolisation s’exonèrent trop souvent d’une analyse fine des politiques M.) (dir.), Histoire de Lille. Du XIXème siècle au seuil du XXIème, Perrin, 1999 ; en géographie : Paris (D.), Stevens (J.-F.), Lille et sa Région urbaine. La bifurcation métropolitaine, L’Harmattan, collection « Métropoles » (sic), 2000 ; En science politique : Jouve (B.), Lefevre (C.) (dir.), Villes, Métropoles. Les nouveaux territoires du politique, Anthropos, 1999. 4 Même si ces derniers jouent un rôle particulier dans sa diffusion, comme nous le verrons ensuite. 5 C’est l’un des nombreux points communs qu’elle partage avec la notion de « gouvernance » à laquelle elle est par ailleurs fréquemment associée. Voir sur ce point l’article de Franck Bachelet dans cet ouvrage, ainsi que le numéro spécial de la Revue Internationale de Sciences Sociales consacrée à la gouvernance (n° 155, mars 1998). 6 Les propos de Bruno Bonduelle sont emblématiques de ces incantations prophétiques à la métropolisation. Il déclarait ainsi dernièrement à la Voix du Nord (3 et 4/11/2002) : « Le modèle de métropolisation se généralise dans le monde entier. Toutes les villes du pourtour sud de Lille deviennent progressivement des satellites de la métropole. (…) C’est tout ce territoire qui devient métropole. Avec la Belgique transfrontalière, nous voilà à 2.5 millions d’habitants ; nous pouvons enfin rivaliser avec les grandes métropoles européennes comme Barcelone, Milan ou Munich ». 3 publiques d’agglomération, qui leur permettrait pourtant d’évaluer dans quelle mesure émergent (ou non) des normes d’intervention spécifiquement métropolitaines, au-delà de sa célébration consensuelle et communicationnelle. On ne saurait donc s’en tenir à une approche exclusivement spatiale du phénomène. Nous montrerons enfin que les limites actuelles de la métropolisation sont également politiques. Les dernières élections dans la communauté urbaine de Lille ont en effet permis de mesurer la faible lisibilité et l’absence de politisation des enjeux intercommunaux dans la campagne, en dépit des évolutions législatives importantes apportées par la loi Chevènement. L’espace public métropolitain reste donc à construire et il n’est pas sûr qu’un changement du mode de scrutin y suffise, s’il n’est pas accompagné d’un véritable travail politique d’explicitation des enjeux. En insistant sur certains points aveugles de la métropolisation, nous nous plaçons donc résolument du côté des sceptiques. I/ Genèse et fortune d’un discours performatif7 « Les phénomènes observés dans le champ politique semblent, dans une proportion écrasante, relever de faits de langage. Le politiste a le sentiment que la presque totalité des matériaux qu’il traite sont d’ordre linguistique ». Frédéric Bon, in Grawitz et Leca (dir.), 1985, p. 537. 1) Appropriation locale de la notion de métropole Les termes de métropole urbaine et de métropole d’équilibre apparaissent dans les années soixante. En 1962, pour faire pièce au développement démographique de la région parisienne, le gouvernement choisit, dans le cadre du Vème plan (Giblin-Delvallet, 1990), huit agglomérations, appelées métropoles d’équilibre, dont celle de Lille-Roubaix-Tourcoing. Les élites technico-administratives agissent et pensent alors dans le cadre d’un référentiel planificateur et stato-centré dont la DATAR est le bras armé. La définition du terme de métropole appartient à des Hauts-fonctionnaires, ingénieurs des Ponts, géographes et économistes, qui le déclinent en projets d’infrastructures et d’équipements lourds. Le rapport Hautreux-Lecourt-Rochefort crée ainsi la « métropole du Nord » en 1963. 7 Sur ce type de discours qui fait advenir ce dont il parle, voir J.-L. Austin (1970). 4 La conception essentiellement technicienne du développement économique qui sous- tend cette politique nationale d’aménagement du territoire − certes tempérée dans sa mise en œuvre par la tutelle de ministres gaullistes et d’une haute administration plus politisée qu’il n’y paraît (Dulong, 1997) − se heurte aux systèmes de pouvoir locaux ainsi qu’à la défense d’intérêts spécifiques. La loi sur les communautés urbaines de 1966 entreprend ainsi d’ajuster le gouvernement des grandes agglomérations à la mise en œuvre de ces politiques d’équipement8. Le nouvel établissement public est ainsi doté de compétences liées aux grands services urbains (collecte des déchets, transport et voirie, gestion des sols), mobilise un budget en constante augmentation et incarne symboliquement la Métropole Nord. L’histoire de l’institutionnalisation de cet instrument et de son apprivoisement par les élus et les groupes d’intérêts locaux reste à écrire, mais la diffusion progressive du discours sur la métropole − monopole des aménageurs d’Etat avant 1973 − par les mêmes est frappante. L’étude des conditions de sa diffusion constitue un préalable afin de ne pas tomber dans les fausses évidences de ce qui apparaît comme le résultat d’un processus collectif complexe. Si le terme de métropole exprime un état de concentration spatiale de richesses, de pouvoirs et d’informations en une entité urbaine, celui de métropolisation traduit le mouvement de concentration de ces mêmes ressources. A partir des années 1990, la transformation des agglomérations en métropoles devient le leitmotiv de plusieurs groupes d’intérêts, composés notamment d’entrepreneurs, qui tentent de promouvoir un développement économique fondé sur la captation des ressources tertiaires supérieures et l’internationalisation plutôt que sur l’industrialisation. C’est le moment où fleurit une communication des villes rivalisant uploads/Ingenierie_Lourd/ bue-desage-matejko-la-metropole-n-x27-est-elle-qu-x27-un-mot.pdf
Documents similaires





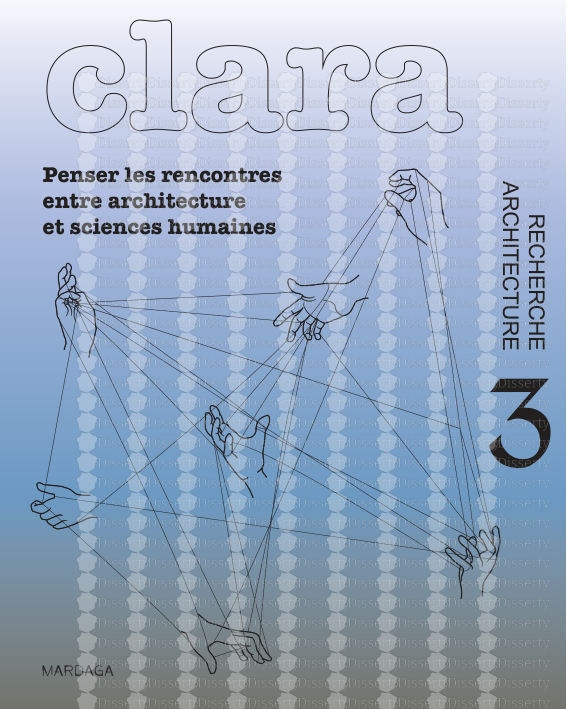




-
63
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 19, 2022
- Catégorie Heavy Engineering/...
- Langue French
- Taille du fichier 0.3128MB


