Cinq architectes, un esprit du temps Vincent Konaté 2 3 Introduction C’est l’hi
Cinq architectes, un esprit du temps Vincent Konaté 2 3 Introduction C’est l’histoire d’un meeting, réunissant cinq architectes trentenaires au bord de la gloi re. Cela se passe au MoMA de New York, en 1969. Il s’agit de Peter Eisenman, Michael Graves, Charles Gwathmey, John Hejduk et Richard Meier. Peter Eisenman et son cousin Richard Meier, ainsi que Michael Graves animent depuis 1964 un groupe de recherche architecturale baptisé CASE qu’ils ont fondé sur le mo dèle des CIAM et de Team X. Charles Gwathmey et John Hejduk ne font pas partie de ce groupe : c’est l’intérêt commun de ces cinq architectes pour les villas blanches de Corbusier qui poussera Arthur Drexler (alors directeur du MoMA) à les réunir lors d’un symposium qui les présentera trop hâtivement comme les épigones du mouvement moderne. Car l’évolution de ces architectes contredira le syncrétisme excessif des critiques qui les avaient réunis sous des titres tels que les White ou L’Ecole de New York. Architecture blanche, déconstructivisme, post-modernisme, contre-design, chacun suivra une voie qui l’éloignera de ces condisciples et de leur origine commune. La trajectoire des Five semble refléter le destin du modernisme. Ce mouvement qui conférait une unité au monde de l’architecture par l’impulsion qu’il lui donnait, a-t-il explosé ? Et la cohérence de l’avant-garde architecturale, a-t-elle disparue avec lui ? Si Siegfried Giedion était toujours parmi nous, pourrait-il encore écrire en exergue de son best-seller qu’il existe en dépit d’une apparente confusion une véritable unité, quoique in consciente, une secrète synthèse dans notre civilisation actuelle ? Trouverait-il les mots pour décrire le Zeitgeist de notre époque? A la biographie critique des cinq architectes de l’exposition éponyme, nous confronte rons différentes réflexions de théoriciens qui ont influé sur l’orientation théorique de ces architectes, mais aussi sur celle de toute une génération. 4 5 Charles Gwathmey Charles Gwathmey est né en 1938 à Charlotte, en Caroline du Nord. Son père, Robert Gwathmey, est peintre et professeur de dessin à Cooper Union. Il fréquente l’Ecole d’Ar chitecture de l’Université de Pennsylvanie de 1956 à 1959, où il a Louis Kahn comme professeur, puis à l’Ecole d’Architecture de l’Université de Yale, dans laquelle officient James Stirling, Shadrach Woods, Paul Rudolph et Vincent Scully, de 1959 à 1962 an née d’obtention de son diplôme d’architecte. Durant l’année 1962-1963, il poursuit ses études en France. En 1966, après s’être installé à son compte, il construit une maison pour ses parents à Long Island qui sera largement médiatisée en tant qu’archétype de la maison sur la plage. Elle se compose de trois pavillons: une résidence et deux ateliers d’artiste agencés sur leur terrain d’un hectare d’une manière rappelant l’étude de l’Acropole d’Athènes par Le Corbusier. Les bungalows en eux-même, accrétions de volumes primaires (les cages d’escaliers contenues dans des demi-cylindres, les sheds étant des prismes à section trian gulaire) dans des gabarits cubiques sont une seconde référence au maître. Cependant le bardage de cèdre utilisé pour le revêtement intérieur et extérieur des édicules confère à cet avatar de l’architecture moderne une sensualité inédite. Charles Gwathmey s’associe avec Robert Siegel en 1971. Cette première partie de carriè re est marquée par la conception quasi exclusive de la même typologie de bâti : maisons de plage, toujours dans la même région de Long Island. Elles permettent néanmoins à l’architecte d’expérimenter les possibilités du langage moderniste qu’il emploie: cohé rence modulaire, différentiation par la couleur, rapport des parties au tout. Les années 1980 verront une notable augmentation du volume de commande de Gwathmey&Siegel. En 1992, ils obtiennent la prestigieuse investiture pour la rénova tion et l’agrandissement du musée Solomon R. Guggenheim de New York. Le projet consiste en l’adjonction d’un parallélépipède de dix étages qui contient trois nouvelles galeries. Il permet de diversifier les expériences de la promenade architecturale en ajou tant des itinéraires possibles au parcours spiralé de l’origine et en l’enrichissant de vues sur l’extérieur. Mais cette évolution dans la taille et la nature des programmes confiés s’accompagne d’une évolution des méthodes de conception. La première partie de la carrière de Char les Gwathmey est marquée par la déclinaison des préceptes corbuséens tels que le jeu des volumes assemblés sous la lumière et la promenade architecturale. Puis les bâtiments de grande taille dont lui sont confiées les études orientent son intérêt vers des questions de construction modulaire et d’élaboration de détails-types qui rapprochent ses préoccupa tions de celles des travaux américains de Mies van der Rohe. Résidence et studio Gwathmey, 1966, Long Island présentée à l’exposition Five Architects Résidence et studio Gwathmey, 1966, Long Island présentée à l’exposition Five Architects Agrandissement et rénovation du musée Solomon R. Guggenheim, 1992, New York Siège de Morgan, Stanley, Dean, Witter & Co, 1995, New York Peter Eisenman Peter Eisenman est né en 1932 à Newark dans le New Jersey. Il obtient son bachelor en 1955 à l’université de Cornell sous la tutelle de Colin Rowe, puis son Master à l’univer sité de Columbia en 1960. Il poursuit son cursus en obtenant en 1963 un doctorat en philosophie à l’université de Cambridge, au Royaume-Uni, dont le thème, «The Formal Basis of Modern Architecture», sert de canevas pour un article qu’il publie en octobre 1963 dans Architectural Design : «Toward an Understanding of Form in Architecture». La première partie de sa carrière est marqué par un cycle de projets, onze maisons dont la première, House 1, est bâtie en 1966, et la dernière, House 11a, est laissée à l’état de projet en 1975. Les projets de ce cycle sont tous conçus selon le même procédé: à une volumétrie de base, l’architecte fait subir une série de modifications géométriques (rotations, homothéties, etc.) dont le résultat est investi des différentes fonctions du programme. Le point de départ, le nombre et la nature des manipulations sont définis de façon arbitraire. Cependant, l’appartenance de ses modifications au même champ sémantique de la géométrie donne à ces maisons une aura de logique évanescente, de co hérence parasitée. En effet, ces recherches visent l’émergence d’un langage architectural dont la compréhension ne dépend ni du bagage culturel, ni du ressenti de l’observateur, mais de sa capacité innée à comprendre la logique d’une structure langagière. La démarche de Peter Eisenman s’oriente ensuite vers une intégration du site dans l’ex périmentation formelle. Pour le projet de Cannaregio, lancé par la ville de Venise en 1978 pour l’aménagement d’un espace public, il projette sur le site la trame structurelle de l’hôpital de Venise par Le Corbusier, qu’il matérialise par une série de vides. Certains de ces vides sont équipés d’un objet non-habitable extrait d’un de ces anciens projets. Le procédé, hautement arbitraire, s’adresse plus volontiers au monde de la critique architec turale qu’à un hypothétique usager. L’hermétisme du langage employé, mis en tension par sa présence dans un lieu public réédite l’expérience tentée avec sa première série de maisons: la genèse de signifiants. L’émergence d’un nouveau type de monument est ren due possible par le biais d’une expérience purement formelle, qui est une hypothèse cri tique vis-à-vis de la doctrine communément attribuée au mouvement moderne (d’où la référence au Corbusier) : la forme doit-elle être le résultat du processus de conception ? Les évènements concourent à faire de Peter Eisenman l’architecte idoine pour la cons truction du mémorial pour les juifs d’Europe assassinés, dont la conception s’étend de 1998 à 2005, à Berlin. L’intérêt que l’architecte a porté aux notions de disparition, d’absence, de trace tout au long de sa carrière trouve ici une naturelle voie d’expression. Le thème du monument étalé, au caractère topographique, dont le vocabulaire géomé trique semble pertubé par des forces à l’échelle de l’espace qu’il occupe est un dévelop pement de la réflexion initiée sur Cannareggio. Mais surtout cette rationalité pervertie désigne avec force l’Holocauste: un évènement incompréhensible mais préparé avec la froide logique de la raison, qui fit douter le monde sur la capacité rédemptrice qu’on attribuait depuis les Lumières à cette dernière. House I, 1967, Princeton présentée à l’exposition Five Architects House II, 1969, Hardwick présentée à l’exposition Five Architects Cannaregio, 1976, Venise Mémorial pour les juifs d’Europe assassinés, 1998-2005, Berlin 6 7 Richard Meier Richard Meier est né en 1934, également à Newark. Il obtient son diplôme d’architecte à l’université de Cornell en 1957, après quoi il entame un long voyage en Europe qui le mènera de la Grèce jusqu’en Scandinavie. A son retour au Etats-Unis, il travaille chez Skid,Owings&Merrill, de 1959 à 1960 et chez Marcel Breuer, entre 1960 et 1963. En 1963, il s’installe à son compte et intègre le corps enseignant de l’université de Prince ton. La maison Smith, construite en 1965, est située au bord d’un lac, en pleine nature. Meier utilise pour la conception de la maison une méthode évoquant les grilles d’analyse des CIAM. Le design final résulte de la conjonction des solutions aux contraintes du site, du programme, de la circulation, de l’entrée et de la structure. L’utilisation du tracé régulateur soutient cette élaboration rationnelle et justifiée par la géométrie. Cependant cet attrait pour les méthodes du mouvement moderne uploads/Ingenierie_Lourd/ cinq-architectes-un-esprit-du-temps.pdf
Documents similaires

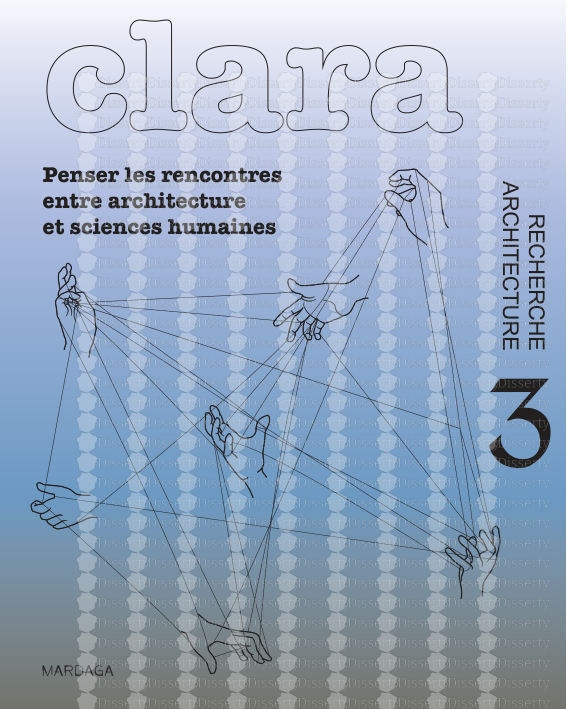








-
40
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 31, 2021
- Catégorie Heavy Engineering/...
- Langue French
- Taille du fichier 1.3246MB


