DEVELOPPEMENT DES USAGES MOBILES ET PRINCIPE DE SOBRIETE RAPPORT A MONSIEUR LE
DEVELOPPEMENT DES USAGES MOBILES ET PRINCIPE DE SOBRIETE RAPPORT A MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE Jean-François Girard Philippe Tourtelier Stéphane Le Bouler, rapporteur Novembre 2013 2 3 Ré sumé opé rationnél Le contexte La préoccupation des pouvoirs publics en ce qui concerne l’exposition des populations et des usagers aux champs électromagnétiques n’est pas nouvelle. La prise en charge erratique du problème dans la sphère publique répond aux caractéristiques habituelles de la mise sur agenda : la montée de la controverse sur le plan juridique avait ainsi largement suscité la table ronde « Radiofréquences, santé, environnement » de 20091, sur le fondement d’une demande adressée par le Premier ministre de l’époque, François Fillon, aux ministres respectivement en charge de la santé, de l’environnement et de l’économie numérique. En 2013, le contexte a changé : les technologies et les usages évoluent ; une nouvelle génération d’équipements se met en place ; des clarifications ont été apportées sur le plan juridique, quant aux normes mobilisables, aux compétences des acteurs et à la division du travail entre les juridictions ; les travaux d’expérimentation engagés à la suite de la table ronde de 2009 sont désormais achevés2 : ils fournissent une matière très intéressante pour rénover les procédures en vigueur en ce qui concerne les antennes-relais. La proposition de loi déposée par Madame Laurence Abeille, députée du Val-de-Marne, à l’automne 2012 a opportunément remis à l’agenda du législateur les questions de réglementation en matière de téléphonie mobile. A la faveur d’un renvoi en commission, le gouvernement a annoncé la remise d’un rapport sur le « principe de sobriété », objet de discussions au sein de la Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale. Le présent rapport a été demandé par le Premier ministre dans ce cadre. Il offre la possibilité de valoriser l’ensemble des travaux conduits dans la période récente en proposant des pistes nouvelles de régulation. Il entend aussi éclairer quelques-uns des enjeux du récent projet de règlement européen «établissant des mesures relatives au marché unique européen des communications électroniques et visant à faire de l'Europe un continent connecté»3. Les conditions d’une meilleure acceptabilité sociale La controverse sur la téléphonie mobile fait assurément partie des sujets prégnants lorsqu’on interroge les populations sur les risques technologiques ou sur le degré de confiance accordée aux pouvoirs publics, aux experts et aux autorités sanitaires. D’aucuns y verront peut être le signe d’un défaut de hiérarchisation des risques ou de la schizophrénie de la population, dans sa grande majorité adepte par ailleurs des technologies de la mobilité. Mais c’est un fait : l’acceptabilité des développements nécessaires à ces technologies est médiocre quand bien même celles-ci sont ardemment recherchées. Les émissions de champs électromagnétiques des stations de base seront volontiers considérées comme une pollution subie, mal perçue à faible niveau et mal vécue, voire franchement inacceptable, à des niveaux d’exposition supérieurs à la moyenne (quand bien même celle-ci est très faible – et les travaux d’expérimentation l’ont montré) ou lorsque des publics particuliers (enfants notamment) sont concernés. Dans le même temps, quel que soit par ailleurs l’entrain que mettent - ou ne mettent pas – les opérateurs et les fabricants pour déployer des technologies protectrices s’agissant des terminaux, les usages précautionneux ne se développent pas spontanément dans le public. Retrouver l’acceptabilité sociale, rebâtir la confiance n’est pas seulement une affaire de hiérarchisation des risques ou d’information du public, quand bien même ces éléments sont importants, y compris pour susciter des comportements d’usage plus protecteurs. 1 Cf.: http://www.radiofrequences.gouv.fr/ 2 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_COPIC_31_juillet_2013.pdf et http://www.developpement- durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-synthese_VF.pdf 3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0627:FIN:fr:PDF 4 Le rétablissement de la confiance a besoin de transparence, de concertation, de pédagogie. La population n’est pas schizophrène : on lui vante les usages de la mobilité à grand renfort de marketing ; elle s’en saisit. L’information sur les stations de base, la délibération sur leur implantation doivent être avant tout porteuses de sens : quels sont les besoins en infrastructures liés aux usages ? Quelles sont les options disponibles en termes de localisation, d’équipements ? Quels sont les choix qui s’offrent à nous ? Il faut sûrement un effort de pédagogie au niveau national pour tout simplement éclairer les choix collectifs. Il faut surtout une délibération organisée localement au plus près des réalités de terrain non pas tant pour débattre à l’infini des risques pour la santé de ces installations mais pour exercer concrètement des choix éclairés. Hiérarchiser les sources d’émission Le Premier ministre a demandé à la mission de « recenser les différentes sources d’émission » et de les « hiérarchiser au regard des niveaux d’exposition de la population et des conséquences connues de ces champs sur la santé telles qu’elles ressortent des travaux de l’Anses ». La mission a tenu à avoir « compétence liée » en quelque sorte ; elle a tenu à ce que ce travail de hiérarchisation soit reconnu comme une prérogative de l’Anses, dont la méthodologie d’évaluation et l’ouverture aux parties prenantes garantissent la qualité de l’approche et la contribution au débat public. La mission n’a aucune plus-value sur ce plan par rapport à ces travaux. Le fait que l'exposition des personnes aux champs électromagnétiques soit composite et ne fasse pas une place prépondérante aux antennes-relais, par rapport à d'autres sources d'émission dans le domaine de la téléphonie et au-delà, est en soi un élément de hiérarchisation important. Cela appelle un effort de pédagogie pour bien expliquer les choses à une population inquiète ou interrogative. Cet effort de pédagogie doit être organisé ; il exige de la méthode ; rapidement se pose la question de l'institution qui doit en avoir la charge. Mais la place relativement modeste des antennes-relais dans la pollution électromagnétique désigne aussi en creux une partie du problème : la question de l'exposition masque ou recouvre d'autres préoccupations, d'autres inquiétudes qu'il faut traiter pour elles-mêmes, notamment au plan local. Dans la hiérarchie de l'exposition individuelle des personnes, les émissions liées aux terminaux individuels sont plus importantes que celles liées aux stations de base. Cette question est aujourd’hui renouvelée – mais non pas bouleversée – par l'évolution des technologies et des usages, côté terminaux et côté infrastructures relais. L'évolution des terminaux et de leur usage dans le passage de la 2G à la 3G a représenté un progrès en ce qui concerne l'exposition individuelle. La densification du réseau d'antennes-relais, avant même le passage à la LTE/4G, a également modifié la donne, de façon ambivalente. D'un côté, la dissémination des dispositifs relais indoor (femtocells, picocells...) et outdoor multiplie les sources d'émission proches, donc la possibilité de "points chauds" de proximité. D'un autre côté, cette densification participe à l'optimisation de l'émission des terminaux, d'où l'importance de travaux tels que ceux du projet Lexnet, financé par la Commission européenne, qui a bien compris tout l’intérêt qu’il y avait à reprendre cette question de l’exposition dans un contexte où les usages se démultiplient et où l’organisation des réseaux se densifie et évolue. Ce qui importe, en termes d'exposition, ce n'est pas tant de minimiser in abstracto l'exposition des populations aux champs émis par les antennes relais mais de travailler concrètement à la meilleure configuration de réseau, qui permette de limiter l'exposition toutes sources. Reprendre le problème au plan politique Disons-le clairement : le problème, ce n'est pas d’abord le niveau d'émission en tel ou tel point du territoire (même s'il faut s'efforcer de limiter les "points chauds"), le problème, c’est la confiance perdue au niveau local. Les opérateurs ont fabriqué les conditions de la défiance et de la suspicion pendant des années : négocier des accords discrets avec les bailleurs, ne pas prévenir les riverains ou les résidents, dans un contexte de controverse sur les risques pour la santé, a provoqué une réaction de rejet. Les pouvoirs publics ont entretenu ce climat de défiance en se montrant incapables de communiquer valablement en situation d'incertitude scientifique (beau cas d'école pourtant), en laissant les autorités 5 locales en dehors de la régulation (quel autre exemple local a-t-on de maires qui ne soient pas associés à l'organisation de réseaux structurants?), en promouvant à ses limites le dogme de la concurrence par les infrastructures (qui craque aujourd'hui sous le poids de la contrainte économique). Les rapports n'ont pourtant pas manqué qui montraient la voie de l'apaisement et d'une démarche enfin mature, à la mesure des enjeux économiques, sociétaux et scientifiques de ce dossier. Dès 2002, le rapport de l'Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) des sénateurs Lorrain et Raoul4 disait l’essentiel, les rapports successifs de l'Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement (AFSSE) et de l'Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET) ont fait des préconisations utiles, le "Grenelle des ondes" avait fixé, dans la concertation un certain nombre de principes. En partant de ces travaux, en valorisant au mieux ceux du COPIC, en s’inspirant aussi d’expériences étrangères intéressantes, il nous faut bâtir une régulation plus cohérente et mieux fondée. La conviction de la mission est que le registre d’action pertinent est la protection de l’environnement, ce qui permet de prendre en compte la protection de la uploads/Ingenierie_Lourd/ developpement-des-usages-mobiles-et-principe-de-sobriete-rapport-final.pdf
Documents similaires






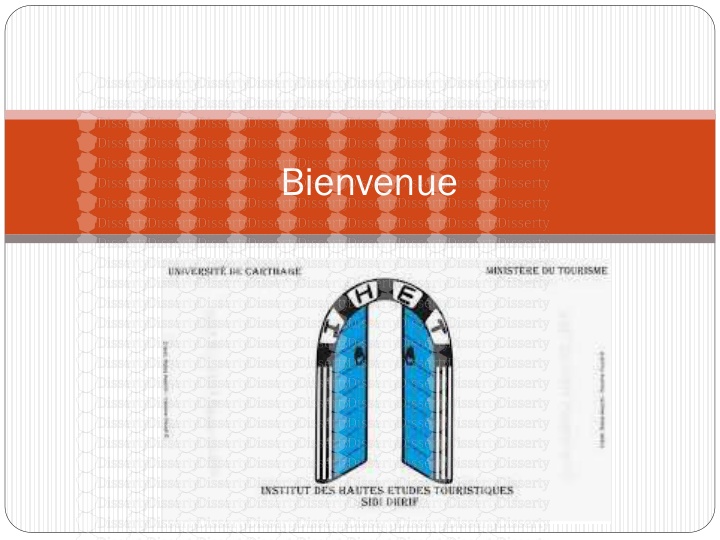



-
90
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 09, 2021
- Catégorie Heavy Engineering/...
- Langue French
- Taille du fichier 4.2798MB


