46 Les giratoires en béton André Jasienski, ingénieur, directeur promotion, rec
46 Les giratoires en béton André Jasienski, ingénieur, directeur promotion, recherches et développement FEBELCEM, Bruxelles (B) En Belgique, fi n des années 1980, profi tant de l’expérience d’autres pays européens notam- ment de l’Angleterre et de la France, la gestion du trafi c dans les carrefours a été organisée par des giratoires. La gestion des giratoires peut toutefois s’avérer complexe et nous n’avons pas toujours cherché la diffi culté, comme le montrent ces deux photos. En effet, on n’oserait imaginer ce type de carrefour à Bruxelles avec en prime notre signalisation bilingue. Le présent exposé traitera principalement des points suivants: • les sollicitations spécifi ques des giratoires • le choix du revêtement • les revêtements en dalles de béton • le béton armé continu • les points particuliers. Rapidement, sur les carrefours sollicités par un trafi c lourd et dense sont apparues des dégradations importantes des revêtements. Nous ne ferons pas un exposé sur le calcul des sollicitations propres aux giratoires mais les deux diagrammes suivants illustrent d’une part les sollicitations spécifi ques à l’approche du giratoire et d’autre part la différence entre les sollicitations d’une chaussée en alignement droit et dans l’anneau d’un giratoire. On peut constater qu’outre le transfert d’une partie de la charge sur la roue extérieure, la force centrifuge induit un effort horizontal sur le revêtement. 47 Les conséquences de ces sollicitations sont: un orniérage du revêtement, un glissement de la couche de roulement, un arrachement des granulats en surface, voire même, un faïençage par défaut de portance de la chaussée au droit du passage des roues extérieures des véhi- cules. Pourquoi prévoir un revêtement en béton? • Le revêtement des voies d’accès et de l’anneau doit résister à l’orniérage, aux sollicitations dynamiques des charges lourdes à vitesse réduite, à l’érosion, aux cycles de gel-dégel en présence de sels de déverglaçage,... • Le matériau doit s’adapter aux contraintes de mise en œuvre, rapidité d’exécution, phasage, géométrie de l’ouvrage,... • De plus, le revêtement doit répondre à des exigences de sécurité, adhérence, maintien de l’uni transversal, clarté,... • Enfi n, il doit aussi satisfaire aux exigences d’exploitation, contraintes d’entretien limitées, nettoyage, marquage, ... et limiter au maximum les gênes à l’usager. La première solution adoptée consiste à construire ces giratoires en dalles de béton. De nombreux exemples existent déjà en Belgique mais également dans d’autres pays tels que la Hollande, l’Autriche, mais aussi l’Australie,... La présence des joints devra alors être soigneu- sement étudiée. En Belgique, des giratoires en dalles armées ont déjà été réalisés comme à Scherpenheuvel où l’auteur de projet a utilisé des bétons de couleur différente. Parmi les différents types de joints, nous citerons les joints transversaux de retrait, de dilata- tion et de construction. Les joints longitudinaux sont principalement de deux types, les joints de fl exion et ceux de construction. Le schéma des joints nécessite une étude préalable détaillée et ne peut en aucun cas être improvisé sur chantier. Deux exemples illustrent ces diffi cultés. La présence d’angles aigus doit à tout prix être proscrite au risque de voir des dalles se rompre. Au vu de ces constatations et devant construire un giratoire sur un itinéraire particulièrement sollicité: sortie d’une carrière, d’une cimenterie et d’une zone industrielle dans laquelle sont installées notamment une centrale à béton et une centrale d’enrobage, soit en période de pointe ± 200 poids lourds à l’heure, la Direction des Routes de Mons du Ministère wallon de l’Equipement et des Transports a envisagé en 1993 la construction d’un giratoire dont le revê- tement serait en béton armé continu. Pourquoi construire un giratoire en béton armé continu? • Les armatures transversales permettent de reprendre les efforts radiaux de poussée au vide • Les armatures longitudinales permettent de supprimer les joints de retrait et donc d’éviter les charges de coin. La présente communication s’attardera plus sur la conception et la réalisation de ces ouvrages en béton armé continu, car ils ont été mis au point en Belgique et que le pays en compte aujourd’hui plus de trente. Sur le profi l en travers type retenu pour les différents giratoires étudiés et construits depuis 1993, on peut constater la surépaisseur de la fondation en béton maigre sur la partie exté- rieure de l’anneau. Cette surépaisseur permet de renforcer la structure de la chaussée dans sa zone la plus sollicitée. L’importance de cette surépaisseur est déterminée par un calcul de dimensionnement. Ce dimensionnement doit être adapté aux circonstances locales de chaque carrefour. 48 Réalisation sur chantier des giratoires en BAC Je ne mentionnerai dans cet exposé que les particularités du BAC dans les giratoires. Toutes les règles de l’art propres au BAC classique sont bien entendu applicables également aux giratoires. Différents aspects seront abordés: les coffrages, le ferraillage, le bétonnage manuel ou à la machine à coffrages glissants ainsi que divers points particuliers. Si le bétonnage est réalisé au moyen d’une machine à coffrages glissants le revêtement est bétonné avant les éléments linéaires. Si le bétonnage est réalisé au moyen d’une poutre vibrante, les éléments linéaires peuvent servir de coffrage tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’anneau. Au droit des accès le coffrage est réalisé au moyen d’éléments; de madriers de 50 cm à un mètre de longueur et de hauteur égale à l’épaisseur du béton à mettre en œuvre. Ces madriers sont solidarisés au moyen d’attaches à incruster dans le bois pour permettre le glissement parfait de la poutre vibrante. Le ferraillage • L’armature longitudinale suit parfaitement la courbure du giratoire. Pour conserver l’angle de recouvrement alpha avec la perpendiculaire à la tangente (le rayon) à l’axe de la voirie, il y a lieu d’augmenter la longueur de recouvrement à l’intérieur de l’anneau. • L’armature transversale fait un angle de 60° avec la tangente à l’axe de la voirie. Afi n d’éviter un espacement trop grand à l’extérieur de l’anneau, l’écartement de 70 cm entre deux transversales est mesuré au 1/3 de la largeur de l’anneau à partir du bord extérieur. De plus, lors de la construction de giratoire de plus de 20 m de rayon intérieur, une barre transversale complémentaire est mise en œuvre sur le demi anneau extérieur afi n d’éviter un changement brusque de section d’acier. Ces armatures complémentaires sont décalées d’un mètre. Le bétonnage • à la poutre Cette technique a le plus souvent été utilisée compte tenu de la possibilité d’adapter une poutre vibrante à la largeur de bétonnage. Cette poutre glisse à l’intérieur de l’anneau sur la bordure du semi-franchissable ou sur la bordure intérieure du rond-point. Afi n de corriger les éventuelles dénivellations de ces bordures, la poutre vibrante prend appui sur la bordure par l’intermédiaire d’une poutre articulée de 2 m minimum de longueur. La hauteur de la poutre par rapport à la bordure doit pouvoir être réglée pour l’adapter à la saillie imposée à la bordure. Après mise en œuvre et nivellement du béton par une grue, et avant le passage de la poutre vibrante, le béton est vibré au moyen d’aiguilles vibrantes; il est conseillé de prévoir une aiguille vibrante par 1,50 m de largeur de bétonnage. La raclette lisseuse permet de faire disparaître les petites dénivellations dues aux arrêts de la poutre. • à la machine à coffrages glissants Cette technique de bétonnage pose plusieurs problèmes. Il faut disposer d’une machine pouvant bétonner sur 8 voire même 9 m de largeur pour les giratoires de grande dimension. Les amorces des voies d’entrée et de sortie sont diffi cilement réalisées dans la même phase. Si le giratoire se bétonne en une seule journée, le nettoyage de la machine en fi n de béton- nage doit s’exécuter sur le revêtement non entièrement durci et la machine est bloquée sur le giratoire pendant quelques jours, le temps nécessaire au béton pour atteindre une résis- tance suffi sante pour être circulé. 49 Quelques mesures particulières Le bétonnage en une phase et une journée La fermeture du bétonnage de l’anneau se réalisant sur un béton non encore durci, il y a lieu de prévoir une passerelle pour permettre la fi nition du joint sans marcher dans le béton. De plus, si le bétonnage est supérieur â 150 m3, deux équipes sont nécessaires, elles se relaie- ront après ± 10 heures de travail. Le bétonnage en deux phases Si pour des raisons de circulation, le carrefour ne peut être isolé, le bétonnage en deux pha- ses peut être envisagé. Que le bétonnage soit réalisé au moyen d’une machine à coffrages glissants ou d’une poutre vibrante, les deux extrémités du revêtement doivent alors être char- gées pour éviter les mouvements importants d’extrémités dus au retrait et aux variations de température; le chargement préconisé s’effectue sur toute la largeur du revêtement, sur une épaisseur minimum de 50 cm et une longueur de 15 m. En cas de manque de place, cette longueur peut être réduite pour autant que l’épaisseur du chargement soit augmentée. Une poutre (ou culée) d’ancrage peut remplacer le chargement. Le bétonnage par temps chaud Les précautions nécessaires à tout bétonnage par temps chaud doivent être uploads/Ingenierie_Lourd/ les-giratoires-en-beton.pdf
Documents similaires


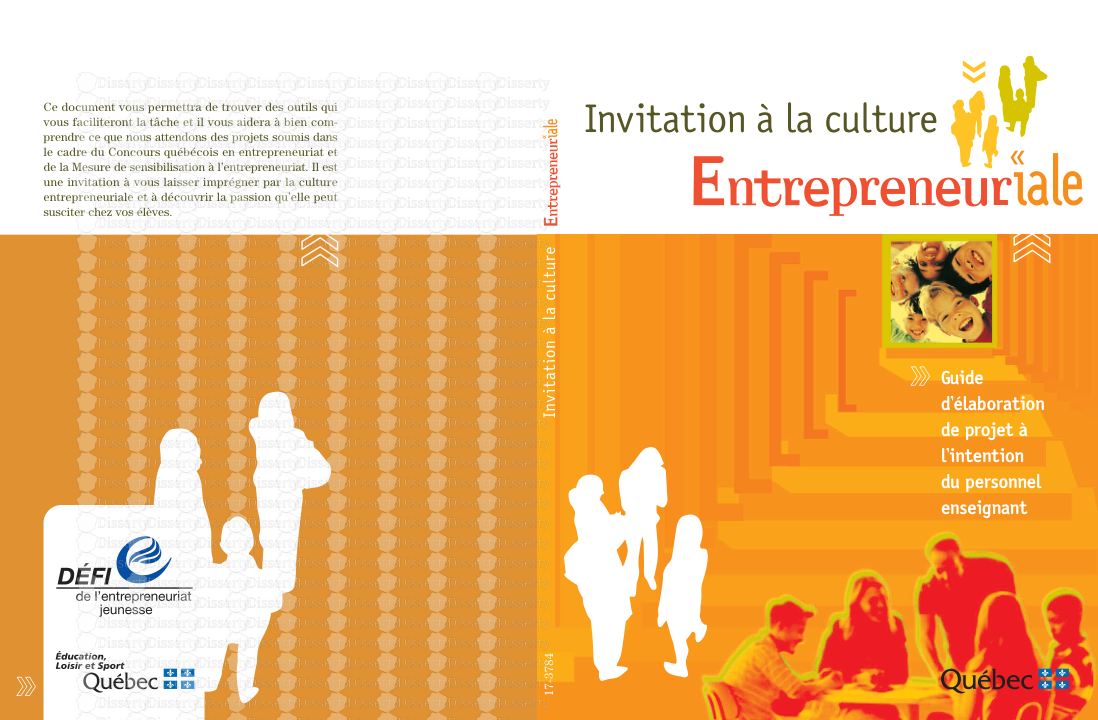







-
43
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 08, 2021
- Catégorie Heavy Engineering/...
- Langue French
- Taille du fichier 0.5621MB


