See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://ww
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/327285593 Perméabilité à l'eau des bétons : développement d'une méthode alternative par séchage Conference Paper · November 2018 CITATION 1 READS 4,644 2 authors: Some of the authors of this publication are also working on these related projects: Behaviour of concretes with high content of GGBS View project Thesis: Ageing Behavior of Concrete Creep, applied to Concrete Vercors View project Maxime Lion Électricité de France (EDF) 40 PUBLICATIONS 333 CITATIONS SEE PROFILE Julien Sanahuja Électricité de France (EDF) 94 PUBLICATIONS 1,552 CITATIONS SEE PROFILE All content following this page was uploaded by Maxime Lion on 08 November 2018. The user has requested enhancement of the downloaded file. Conférence Internationale Francophone NoMaD 2018 Liège Université _____________________________________________________________________________________________________ Liège, Belgique 7-8 Novembre 2018 1 PERMÉABILITE A L’EAU DES BETONS : DÉVELOPPEMENT D’UNE MÉTHODE D’ESSAI ALTERNATIVE PAR SÉCHAGE LION MaximeA, SANAHUJA JulienB A Electricité De France (EDF), Direction Industrielle, Département TEGG, Aix-en-Provence, France B Electricité De France (EDF), EDF Lab Les Renardières, France Résumé : Cette communication présente une méthode alternative d’évaluation de la perméabilité à l’eau des bétons qui s’appuie sur une approche couplée essais-modélisation grâce à un outil développé sous Python. La méthode d’essai retenue est la suivante : séchage à 20°C - 50% HR de rondelles de béton de 6 cm d’épaisseur, initialement saturées en eau, et enrubannées latéralement. Une méthode graphique est proposée de manière à pouvoir situer rapidement le niveau de perméabilité et la classe de durabilité potentielle des bétons à partir des pertes de masse mesurées pendant les premières semaines. La méthode proposée permet d’appréhender des qualités de béton qui ne peuvent pas l’être à partir des mesures classiques au perméamètre (bétons ayant des perméabilités à l’eau inférieures à 10-11 m/s, soit 10-18 m2). Cette méthode permet d’entrevoir une meilleure prise en compte du paramètre perméabilité à l’eau dans la qualification de bétons ayant des fonctions d’étanchéité ou encore dans le cadre d’une approche performantielle en tant qu’indicateur de durabilité. Mots-clés : perméabilité, béton, séchage 2 1. INTRODUCTION La perméabilité à l’eau des bétons, qui définit la capacité de l’eau à s’écouler en leur sein sous l’effet d’un gradient de pression, est une propriété intéressante à plusieurs titres : elle peut participer à la qualification de bétons utilisés pour des ouvrages ayant des fonctions d’étanchéité, elle peut définir un indicateur de durabilité dans le cadre d’une approche performantielle et enfin elle correspond à un facteur d’influence notable de certains mécanismes (éclatement thermique des bétons, séchage,…) et est un paramètre souvent considéré dans les modélisations. Cette propriété soulève cependant la problématique de la difficulté de sa mesure, en particulier pour les bétons de bonne qualité. Cela empêche généralement sa prise en compte effective dans les démarches de qualification des bétons d’étanchéité ou les approches performantielles, et pose question sur les valeurs à considérer dans les calculs-modélisations. Un travail commun ingénierie-R&D a été mené par le passé au sein d’EDF pour modéliser le séchage unidirectionnel d’ouvrages en bétons. Ce travail a abouti au développement par EDF R&D d’un outil sous Python permettant de modéliser le séchage à partir de mesures réalisées sur éprouvettes de béton en laboratoire (Sanahuja et al., 2017). Cette modélisation intégrant une évaluation indirecte de la perméabilité à l’eau, il a été décidé de mettre à profit cette capacité pour mener une étude orientée sur l’évaluation de cette propriété à partir d’essais de séchage. Cette communication retranscrit l’étude en question et propose une méthode alternative d’évaluation de la perméabilité à l’eau des bétons. 2. INTÉRÊT DE LA PERMÉABILITE À L’EAU 2.1 Ouvrages avec fonctions d’étanchéité La qualification de bétons ayant une fonction d’étanchéité aux liquides a longtemps été appréhendée par EDF à travers un critère de perméabilité à l’eau (< 10-11 m/s) via une méthode d’essai interne (perméamètre à charge constante). La figure 1 illustre la perméabilité à l’eau mesurée au laboratoire béton de la Direction Industrielle du groupe EDF (EDF, 2011) sur des bétons de différentes classes de résistance. On voit que les bétons ont une perméabilité à l’eau largement inférieure à 10-11 m/s dès lors qu’ils respectent une classe de résistance C25/30 et qu’une évaluation précise devient impossible au- delà. Ce graphique illustre le fait que cette méthode d’essai permet surtout de discriminer les bétons de faible résistance. Figure 1. Perméabilité à l’eau mesurée pour des bétons de différentes classes de résistance (EDF, 2011). Pour ces raisons, le critère de perméabilité a été retiré du CCTG 2016 (EDF, 2016) au profit d’un critère sur la porosité qui, indirectement, préjuge du respect d’une perméabilité minimale requise. 3 2.2 Approche performantielle des bétons Le guide AFGC (AFGC, 2004) définit plusieurs classes de durabilité potentielle en fonction de certaines plages de valeurs données pour chacun des indicateurs de durabilité retenus (porosité, perméabilité à l’eau, perméabilité à l’air, coefficient de diffusion des chlorures,…). On peut noter que les classes de durabilité sont exprimées pour différentes plages de perméabilité à l’eau : - Keau < 10-20 m2 (< 10-13 m/s) : classe de durabilité potentielle très élevée - Keau comprise entre 10-20 et 10-19 m2 (10-13 et 10-12 m/s) : classe de durabilité potentielle élevée - Keau comprise entre 10-19 et 10-18 m2 (10-12 et 10-11 m/s) : classe de durabilité potentielle moyenne - Keau comprise entre 10-18 et 10-17 m2 (10-11 et 10-10 m/s) : classe de durabilité potentielle faible - Keau > 10-17 m2 (> 10-10 m/s) : classe de durabilité potentielle très faible On peut alors relever que la valeur de 10-11 m/s permet essentiellement d’écarter les bétons de faible qualité, ce qui est cohérent avec les observations précédentes. 3. MÉTHODE RETENUE La méthode retenue est le séchage par deux faces opposées de rondelles de 6 cm d’épaisseur, initialement saturées, dans un environnement 20+/-1 °C – 50+/-5 % HR. Ces conditions ont été sélectionnées à partir d’études antérieures (Sanahuja et al., 2017) ayant donné satisfaction. Cet environnement a été également choisi par rapport à un aspect pratique, compte-tenu qu’il s’agit de l’ambiance requise pour la mesure du retrait normalisé dans le cadre de la caractérisation des ciments. La démarche globale de l’essai est la suivante : o Pesées dans l’air et dans l’eau d’un corps d’épreuve (rondelle) saturé en eau § Détermination de la masse initiale du corps d’épreuve (Mi béton) § Détermination du volume du corps d’épreuve o Enrubannage latéral du corps d’épreuve § 2 couches d’aluminium adhésif § Vernis o Immersion dans l’eau pendant 1 semaine § Reprise de l’eau potentiellement libérée durant la phase d’enrubannage o Pesée dans l’air du corps d’épreuve § Détermination de la masse initiale du corps d’épreuve saturé en eau avec enrubannage (Mi totale) § Détermination de la masse apportée par l’enrubannage (Me = Mi totale – Mi béton) o Mise en environnement 20+/-1 °C et 50+/-5 % HR § Disposition permettant aux 2 faces d’être exposées à l’environnement o Pesées dans l’air périodiques (*) § Détermination de la masse du corps d’épreuve enrubanné après t jours de séchage M totale(t) § Détermination de la perte de masse après x jours de séchage : % perte de masse = [Mi béton - (M totale(t) – Me) ] / Mi béton (*) Le matériel de pesage doit avoir une incertitude de mesure adaptée aux pertes de masse évaluées, potentiellement très faibles. L’évaluation de la perméabilité est réalisée à partir d’un outil développé par EDF R&D sous Python qui intègre l’ensemble de la modélisation détaillée dans une communication antérieure (Sanahuja et al., 2017). La modélisation s’appuie sur le principe du mouvement seul de la phase liquide induite par les gradients de teneur en eau liquide (pression capillaire). Les écoulements induits par séchage ne sont donc pas des écoulements strictement visqueux en milieu saturé tels que la loi de Darcy décrit la perméabilité. En ce sens, on peut considérer que la perméabilité à l’eau déduite à partir d’essais de 4 séchage correspond à une perméabilité équivalente à l’eau. Ce concept a par exemple fait l’objet d’études poussées au LCPC (Coussy et al., 2001). Il a été cependant décidé de se baser plutôt sur les travaux de thèse de Olchitzky (Olchitzky, 2002) menés à l’ENPC sur des argilites qui ont l’avantage d’être plus facilement implémentés dans un outil à vocation opérationnelle. Un certain nombre d’hypothèses simplificatrices sont adoptées par Olchitzky (Olchitzky, 2002) : transport darcéen du gaz et diffusion de la vapeur dans le gaz négligés par rapport au transport darcéen du liquide, pression de gaz toujours à l’équilibre et prise comme référence (pg = 0), incompressibilité de la phase solide du milieu poreux, domaine mécaniquement libre de contraintes et champ de contrainte nul dans tout le domaine, linéarisation de la courbe de pression capillaire-degré de saturation, termes du second ordre négligés. À l’échelle du point matériel, pression et concentration en eau sont reliées par : (1) avec c la concentration massique en eau dans le milieu poreux, p la pression (de signe négatif) dans l’eau, ϕ la porosité, Sr le degré de saturation, la déformation volumique, ρ la masse volumique de l’eau. Les uploads/Ingenierie_Lourd/ permeabilite-a-l-x27-eau-des-betons-developpement-d-x27-une-methode-alternative-par-sechage.pdf
Documents similaires








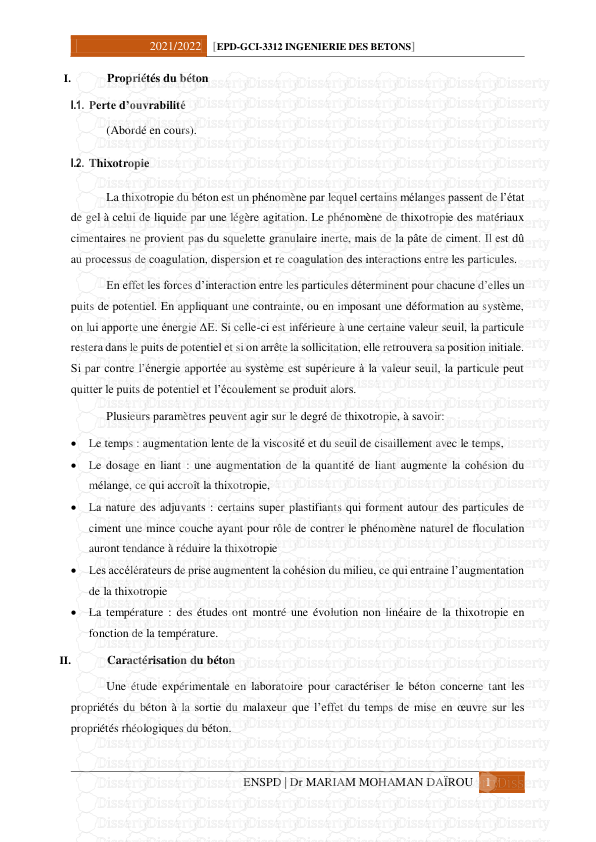

-
50
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 13, 2022
- Catégorie Heavy Engineering/...
- Langue French
- Taille du fichier 4.4785MB


