© www.etudes- musulmanes.com Nasr Hâmid Abû Zayd [ Le dilemne de l'approche lit
© www.etudes- musulmanes.com Nasr Hâmid Abû Zayd [ Le dilemne de l'approche littéraire du Coran (2ème partie) ] Amin al-Khûli, le champion du renouveau (al-tajdîd). Quand Amîn al-Khûlî commença sa carrière, les vents du renouveau pénétraient la vie égyptienne. Il appliqua la méthode du tajdîd à l'étude du langage (al-nahû), de la rhétorique (al-balâgha), du commentaire coranique (al-tafsîr) et de la littérature (al-adab)(1). Il n'est pas facile de déterminer lequel de ces quatre champs d'étude offre le meilleur modèle de la méthodologie du renouveau d'al- Khûlî. Lui-même considère que la renaissance débute toujours -- l'histoire l'a souvent montré -- par l'innovation dans les arts et la littérature(2). Une telle innovation est en effet vitale pour développer la conscience intellectuelle et esthétique du peuple égyptien, afin de mener à son achèvement une renaissance égyptienne complète(3). Une littérature novatrice a besoin d'une nouvelle méthode littéraire qui rende compte de son fonctionnement et de sa structure. Une telle méthode implique un renouveau des études linguistiques et rhétoriques, d'où la nécessité d'un renouveau dans ces deux disciplines. Pour autant que renaissance et tajdîd impliquent mouvement et réveil, il doit d'abord y avoir une étude approfondie de la tradition ancienne dans chaque domaine du savoir. La devise d'al-Khûlî est la suivante : "awalu al-tajdîd qatlu al-qadîmi bahthan" (le renouveau commence par le meurtre de l'ancien par le moyen de la recherche)(4); dans le cas contraire, le résultat serait une perte et non une reconstruction (tabdîd lâ tajdîd)(5). Si, dans le passé, l'étude de la littérature -- comme du langage ou de la rhétorique -- était pratiquée à des fins religieuses, cela ne doit plus être le cas maintenant(6). Pourquoi les Arabes ont-ils accueilli le Coran ? Pour al-Khûli, l'étude littéraire du Coran n'est pas matière à option. Son avis est que la réception du Coran -- et, par voie de conséquence, celle de l'islam -- par les Arabes est venue de ce qu'ils ont reconnu sa supériorité absolue sur tout texte humain. En d'autres termes, les Arabes ont accueilli l'islam sur la base d'une reconnaissance du Coran comme texte littéraire(7). La méthode littéraire devrait donc supplanter tout autre approche, qu'elle soit religieuse, théologique, philosophique, éthique, mystique ou juridique(8). Il faut préciser ici que le "romantisme" -- ou, pour être plus précis, sa version arabe -- était la théorie littéraire dominante à l'époque(9). Via cette théorie, al-Khûlî développe les liens entre l'étude linguistique, la rhétorique et la littérature d'une part, et le commentaire coranique de l'autre. Si la théorie classique de l'i'jâz était fondée sur la notion classique de balâgha (rhétorique), cette notion doit être maintenant remplacée par la théorie moderne de la balâgha liée à la critique littéraire. Ce lien demande une connexion nouvelle avec la psychologie, relation parallèle à celle qu'il y a entre critique littéraire et esthétique (10). L'étude de la balâgha devrait donc se centrer sur le style littéraire et son impact émotionnel sur le récepteur/lecteur(11). Son objectif sera alors de développer la conscience esthétique de l'auteur et du lecteur ; on pourrait alors la nommer plus justement fann al-qawl (l'art du discours) (12). Seule l'approche littéraire du Coran, à travers les méthodes linguistiques modernes, peut mettre en évidence son i'jâz, qui est fondamentalement émotionnelle (i'jâz nafsî)(13). Deux disciples -- outre son épouse Bint al-Shâti', décédée en 1999 --, parmi les étudiants directs d'al-Khûlî, ont appliqué la méthode littéraire dans les études coraniques et sont devenus très connus : Khalafallah et Shukrî 'Ayyâd. Mais il faudrait aussi signaler que Sayyid Qutb, le fameux idéologue du nouveau fondamentalisme islamique, a écrit ses premiers travaux sur le Coran en utilisant une méthode littéraire similaire, encore que plutôt impressionniste. On peut le constater dans trois de ses ouvrages : Al-taswîr al-fannî fî al-qur'ân, Mashâhid al-qiyâma fî al-qur'ân et son Commentaire Fî zilâl al-qur'ân. Khalafallah : prémisses et problèmes Dans sa thèse majeure intitulée Jadal al-qur'ân (Les polémiques du Coran), et qui fut dirigé par al- Khûlî, Khalafallah applique systématiquement les principes de la méthode littéraire comme suggéré dans le Commentaire d'al-Khûlî sur l'article "tafsîr" de la traduction arabe de la première édition de l'Encyclopédie de l'islam. Dans une certaine mesure, sa thèse de doctorat développe la méthode proposée par al-Khûlî. La thèse, dans sa version publiée, se divise en deux parties dont chacune comprend sept chapitres ; il y a en outre une introduction, l'exposé de la méthode et une conclusion. Al-Khûlî a rédigé la préface de la dernière édition. La première partie est intitulée al-ma'ânî wa al-qiyam al-târikhiyya wa al-ijtimâ'iyya wa al-khuluqiyya wa al-dîniyya (Significations et valeurs historiques, sociales, éthiques et religieuses). Elle est divisée en trois chapitres : signification historique, signification psycho-sociale, signification éthique et religieuse. Bien entendu, le premier chapitre traite de la question problématique des rapports entre historiographie et littérature, conduisant à la question plus délicate encore de la validité historique et du même coup de l'authenticité du récit coranique d'un point de vue critique. La deuxième partie est intitulée al-fann fî al-qasas al-qur'ânî (L'art narratif dans les récits coraniques). Elle est divisée en sept chapitres. Le premier aborde la question générale du récit coranique (al-qissat al-qur'âniyya) qui se répartit en quatre catégories : historique, allégorique, mythique et "récit de péché". Le deuxième chapitre est consacré à l'unité narrative (al-wahdat al- qasasiyya) ; le troisième aux intentions et objectifs (al-maqâsid wa al-aghrâd) ; le quatrième aux sources (al-masâdir). Dans le cinquième chapitre, l'auteur analyse les éléments du récit (al-'anâsir) qui sont les personnages, les actions et le dialogue. Dans le sixième chapitre, il se demande dans quelle mesure le récit coranique a contribué au développement de l'art narratif dans l'histoire de la littérature arabe. En ce qui concerne la méthodologie, Khalafallah semble suivre les étapes suggérées par son professeur Amin al-Khuli. La première consiste à collecter les récits du Coran ; la deuxième à les classer par ordre chronologique (tartîb al-nuzûl) pour les analyser et les expliquer en fonction du contexte originel : l'environnement social, l'état émotionnel du Prophète et le développement du message islamique(14). Khalafallah affirme qu'une telle contextualisation aidera à découvrir les niveaux sémantiques originaux du récit coranique, le niveau originel compris par les Arabes à l'époque de la révélation(15). Il est bon de noter ici que Khalafallah ne procède pas à une étude thématique en rassemblant les fragments d'histoires dispersés dans les différentes sourates ; il considère chaque pièce narrative comme un récit indépendant. Ainsi, l'histoire de Moïse par exemple n'est pas considérée comme une histoire unique. Chacun des récits où Moïse est cité représente une unité narrative autonome qui sera étudiée pour elle-même. Une analyse thématique aurait été contradictoire avec l'insistance mise par Khalafallah sur la dimension contextuelle. Il apparaît que Khalafallah ne se faisait pas d'illusion sur les risques auxquels l'exposait son approche. Il dit combien il lui fut difficile de mener à bien son travail de thèse et combien il se mettait en danger. Mais il affirme que le savoir académique et scientifique requiert de savoir prendre de tels risques(16). Les récits coraniques: des allégories ? Khalafallah rapporte les difficultés auxquelles eurent à faire face les commentateurs du Coran, notamment les théologiens (al-mutakallimûn). De telles difficultés sont principalement provoquées soit parce qu'on veut imposer une idéologie prédéterminée concernant le Coran, soit parce qu'on veut prouver l'authenticité de ses récits. Dans les deux cas, on passe à côté de la signification du texte coranique(17). Par ailleurs, le discours orientaliste sur le Coran interroge son authenticité historique en arguant du fait que ses récits contredisent ou du moins ne concordent pas avec les faits historiques(18). Etudier les récits coraniques comme des narrations littéraires -comme le suggère l'approche linguistique- rendra la question de l'authenticité historique inopérante, ou du moins la fera apparaître comme une fausse question. En citant quelques remarques émanant d'auteurs classiques comme al-Qâdî 'Abd al-Jabbâr, al- Zamakhsharî ou al-Râzî, ou de sources plus modernes comme 'Abduh, Khalafallah insiste en conclusion sur le fait que les récits coraniques sont à prendre comme des allégories (amthâl) qui n'ont pas pour but de rapporter des faits historiques. Comme allégories, ils appartiennent à la catégorie des mutashâbihât (versets ambigüs ou obscurs). Lorsque les auteurs classiques ont essayé d'expliquer cette ambiguïté, ils ont lourdement rempli leurs ouvrages de données empruntées aux traditions religieuses précédentes (al-isrâ'iliyyât). L'approche linguistique n'a que faire de tels apports, puisqu'elle établit une différence entre la structure de l'histoire (jism al- qissa) et sa signification. Cette distinction est expliquée tant par les classiques que par les modernes. L'explication classique, produite à partir de l'étude des amthâl, distingue dans la structure du mathal entre la signification (al-ma'nâ) et ses implications (al-luzûm) qui ne sont pas nécessairement identiques(19). L'explication moderne s'appuie sur des œuvres littéraires mettant en scène des personnages ou des événements historiques comme la reine égyptienne Cléopâtre chez Shakespeare, Bernard Shaw, Ahmed Shawqî ou Walter Scott(20). L'objet de leurs œuvres peut paraître historique, mais leur signification, leur message, n'est pas nécessairement fidèle à l'histoire. Les auteurs s'autorisent à user librement de l'histoire dans leur composition littéraire, ce qu'un historien ne pourrait assurément pas se permettre. Outre ces arguments uploads/Litterature/ abou-zeid-le-dilemme-de-l-x27-approche-litteraire-du-coran-partie-2 1 .pdf
Documents similaires
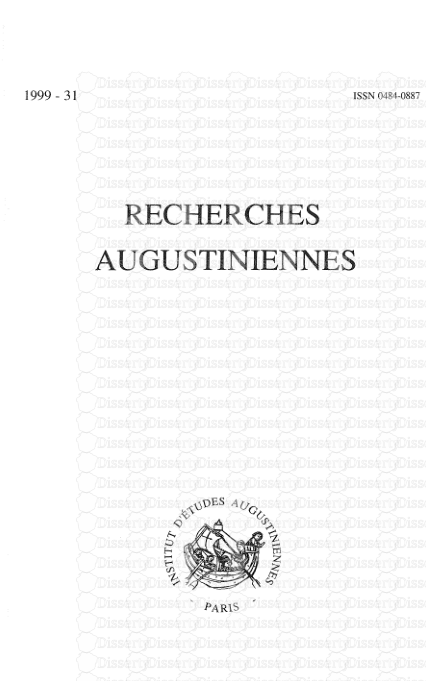









-
80
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 20, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1875MB


