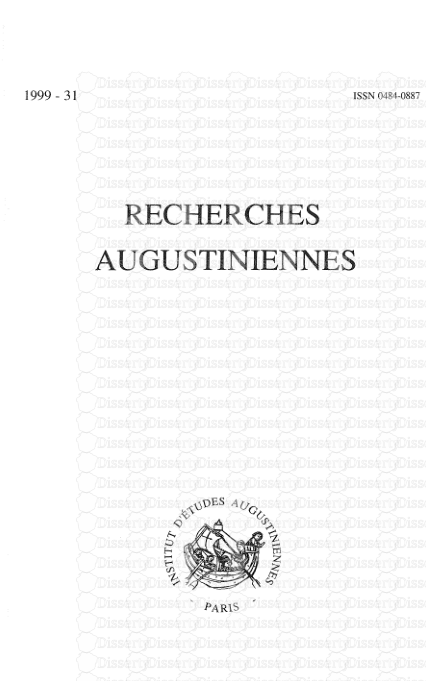1999 - 31 ISSN 0484-0887 RECHERCHES AUGUSTINIENNES PARIS SOMMAIRE Pierre DUFRAI
1999 - 31 ISSN 0484-0887 RECHERCHES AUGUSTINIENNES PARIS SOMMAIRE Pierre DUFRAIGNE, Quelques aspects de !' aduentus in mentem d'Hippo- lyte de Rome à Grégoire le Grand ................................................................ . Paul GÉHIN, Le dossier macarien de 1'Atheniensis gr. 2492 ........................ .. François J. LEROY, Les 22 inédits de la catéchèse donatiste de Vienne. Une édition provisoire ................................................................................ . Winrich LôHR, Pelagius' Schrift De natura : Rekonstruktion und Analyse ... . COMITÉ DE DIRECTION Jean-Claude FREDOUILLE, François DOLBEAU, Georges FOLLIET, Jacques FONTAINE, Claude LEPELLEY, André WARTELLE CONSEIL SCIENTIFIQUE Irena BACKUS, Jean-Denis BERGER, Anne DAGUET-GAGEY, Martine DULAEY, Yves-Marie DUVAL, Alain LE BOULLUEC, Goulven MADEC, Pierre PETITMENGIN, Hervé SA VON 3-87 89-147 149-234 235-294 Le secrétariat des Recherches est assuré par Anne DAGUET-GAGEY ; l'administration par Jean-Denis BERGER. Les manuscrits doivent être envoyés à l'Institut d'Études Augustiniennes, 3, rue de!' Abbaye, 75006 Paris. DIFFUSION EXCLUSIVE BREPOLS PUBLISHERS Steenweg op Tielen, 68, B-2300 Turnhout (Belgique) téléphone: OO 32 14 40 25 OO télécopie: OO 32 14 12 89 19 émail : publishers @ brepols. corn Compte bancaire Crédit du Nord, BP 569, 59023 Lille RIB: 30076 02906 168341 042 OO 17 Quelques aspects de l' aduentus in mentem d'Hippolyte de Rome à Grégoire le Grand L' aduentus du Christ apparaît dans les textes patristiques avec un sens bien particulier, qui ne correspond vraiment ni au premier aduentus dans l'Incar- nation et l'humilité, ni au second dans la gloire à la fin des temps. Il s'agit d'une acception essentiellement liée à la vie contemplative, et qui sera par la suite exploitée dans toute sa profondeur par les communautés monastiques mé- diévales, notamment par saint Bernard qui le qualifie d'ailleurs de medius aduentus 1. L' aduentus pris en ce sens n'est autre que la venue du Christ dans l'âme ou dans le cœur de l'homme, qui prend sa forme la plus intense et la plus profonde dans l'extase mystique du moine ou de la moniale, mais qui se manifeste, à des degrés divers, chez tous les croyants. On trouve la mention de cet aduentus dans divers textes scripturaires, no- tamment dans le Cantique des Cantiques interprété en ce sens par les Pères de l'Église, particulièrement depuis Origène, dont le commentaire a inspiré pres- que tous ses successeurs, et dans plusieurs péricopes du Nouveau Testament, comme Jn., 14, 23 ou Apoc., 3, 202. Nous nous proposons dans cette étude de montrer l'exploitation que les Pères ont faite de ces textes, depuis Hippolyte de Rome jusqu'à Grégoire le Grand, en laissant de côté les commentateurs médiévaux, dont beaucoup ont été déjà bien étudiés, par H. de Lubac notamment, et d'autres après lui. Une place impor- tante sera réservée aux commentateurs du Cantique des Cantiques, parmi les- quels Origène et Grégoire de Nysse occupent une place primordiale. Sans né- 1. C. STERCAL, Il "Medius Aduentus'', Saggio di littura degli scritti di Bernardo di Clairvaux, Editiones Cistercienses 9, Roma, 1992. 2. Jn., 14, 23: Èav nç àymr~ µE, TOY ÀÔyov µou Tf]ptjai::t, Kcù 6 IlaTtjp µou ciymrtjaEt CXÙTOV, l<CXÎ npàç CXÙTOV ÈÀEUOÔµE8a l<CXÎ µov~v 1l'txp' aùn;ï no1riaôµi::8a. Ap., 3, 20: iôoù foTf]l<CX Èn't T~v 8upav Kat J<pouw Mv nç à:J<ouail Tfjç cpwvfiç µou J<al. à:voîÇri T~v ei5pav, daEÀEUaoµm npoç aùTov J<a't ôi::rnvtjaw µET' mhoii J((Xt aÙTOÇ µET' ȵoii. 4 PIERRE DUFRAIGNE gliger ensuite totalement l'apport de certains auteurs grecs, nous nous attache- rons surtout à l'étude des auteurs latins. Depuis Origèn~, et sur son exemple, on a souvent traité à la fois de la venue du Christ dans l'Eglise et de sa venue dans l'âme individuelle. Nous avons l'in- tention de nous attacher exclusivement à la seconde. Il arrive parfois que le commentateur envisage l'existence d'une anima Ecclesiae3, ce qui peut entraîner quelques risques de confusion et ne facilite pas la tâche. I. - H!PPOL YTE DE ROME Si le verset 2, 8 du Cantique (ecce sororis filiolus saliens aduenit et uenit) suggère à Hippolyte la mission du Christ considérée dans son ensemble depuis l'Incarnation jusqu'à la Parousie4, c'est un autre aspect de sa venue que lui fait envisager Cant., 3, 1 : nocte quaerebam quem dilexit anima mea et non inueni. Il rapproche ce texte de Luc, 24, 1 : ierunt mulieres nocte quaerere in sepul- cro, qui évoque les saintes femmes se rendant au tombeau après la passion. Elles y trouvent le gardien qui leur révèle la résurrection du Seigneur. Sur le chemin du retour elles rencontrent le Christ. Est alors accompli Cant., 3, 4 : inueni quem dilexit anima mea. Elles se précipitent à ses pieds et cherchent à le retenir. Il leur demande alors de le laisser aller, car il doit retourner auprès de son Père. Mais l'une d'entre elles s'attache à lui en disant: non te relinquam donec te introducam et immittam in cors. Ainsi est suggérée l'entrée du Christ au coeur d'une âme individuelle, entrée ardemment souhaitée par cette âme, avec une passion toute spirituelle mais exprimée en des termes qui font penser à un attachement pour ainsi dire physique et charnel (in uentre est aggregata caritas Christi6, et dans la version arménienne du Commentaire, elle aussi tra- duite en latin par G. Garitte : quia haec omnimode horreum in uisceribus constituens confirmauit caritatem Christi). L'intimité du cœur est aussi assimi- lée à la pièce la plus profonde de la demeure familiale, celle où l'on enferme les richesses et le produit des récoltes (inueni et non dimittam donec eum per- 3. Sur cette expression chez Augustin, voir É. LAMIRANDE, Études sur l'ecclésiologie de saint Augustin, Ottawa, 1969, p. 33-35. Elle désignerait chez Augustin "l'Église dans sa réalité la plus élevée ei la plus complexe." 4. Quid est saliendi uerbum ? Desiluit de caelo in uuluam uirginis, insiluit e uentre sancto super lignum, saluit e ligna in infernum, sursum saluit inde in humana hac carne ad terram. 0 noua resurrecttio ! De inde insiluit a terra in caelum, hic sedens (est) a dextera Patris, et deinde desiliet in terram, ut commutationem retributionis rependat (De Cant., 21, 2). Repris en partie par Ambroise, in Ps. 118, 6, 5, CSEL 62, p. 111. Le commentaire du Cantique par Hippolyte est cité d'après: Hippolyte de Rome, Traité sur David et Goliath, sur le Cantique des Cantiques et sur l'Antéchrist, version géorgienne traduite en latin par G. GARITTE, Louvain, 1965. 5. De Cant., 25, 2, p.46. Texte cité par H. RAHNER, Symbole der Kirche, Salzburg, 1964, p.27, note 10. 6. Ibid. L'«ADVENTVS IN MENTEM» 5 uenire faciam in domum matris meae et in thesauros - horreum dans la version arménienne - eius quae concepit me). Cet accueil du Christ dans son cœur permettra au fidèle de l'accompagner dans son Ascension vers le Père : o beata mulier, quae adhaesit pedibus eius ut in aerem posset euolare7; arripe me ad caelum, o beata mulier quae a Christo semoueri non uolebat8. L'âme est exhortée à recevoir le Seigneur, à s'unir à l'Esprit afin que son corps puisse se joindre à celui du Christ dans le ciel : accipe, cor meum, per- miscere spiritui, confirma, perfice, ut corpori etiam caelesti adiungi possit ; permisce caelesti ( corpori) meum hoc corpus9. Ainsi l'union du chrétien au Christ et la participation de l'individu au corps mystique dans le ciel passe par la réception du Seigneur au fond du cœur. Il reste cependant que l'allégorie qui assimile la fiancée du Cantique à l'âme individuelle demeure passagère chez Hippolyte. Les personnages du dialogue sont généralement considérés comme la figure du Christ et de l'Église, ce qui revient à une christianisation attendue de la figuration hébraïque de Dieu et du peuple d'Israël. II. - ORIGÈNE Origène, en revanche, accorde une place primordiale à l' aduentus Domini in mentem. Il va de pair avec la venue du Christ en ce monde et nous purifie : per aduentum Christi, qui factus est ad animam nostram, praua quaeque directa sunt. Origène va jusqu'à voir en lui la véritable justification de l'Incarnation, qui, sans lui, demeurerait inutile à l'homme : quid enim tibi prodest, si Christus quondam uenit in carne, nisi ad tuam quoque animam uenerit ? Loin d'être exceptionnel, il doit devenir habituel et quotidien afin que le Christ vive vraiment en nous : oremus ut illius cotidie nabis aduentus fiat, et possimus dicere : Viuo, iam non ego, uiuit autem in me Christus (Gal., 2, 20). Il pré- pare d'ailleurs en nous la "marche" de Dieu le Père lui-même et l'intallation permanente du Père et du Fils : uenit ergo Dominus meus lesus et exaequauit asperitates tuas et incomposita quaeque uertit in uias planas, ut fieret in te iter sine offensione et leue atque purissimum gradereturque in te Deus Pater, et Christus Dominus mansionem apud te faceret diceretque : Ego et pater meus ueniemus et mansionem apud eumfaciemus (Jn., 14, 23)10. Aux deux aduentus du Christ, celui de l'Incarnation et celui de la fin des temps, Origène fait correspondre deux formes de l' aduentus in animam. Le premier concerne les nouveaux convertis, qui commencent seulement à con- 7. Ibid. 8. De Cant., 25, 3, p. 46. 9. Ibid., 25, 4, p. uploads/Litterature/ recherches-augustiniennes-volume-xxxi-1999-pdf.pdf
Documents similaires










-
79
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 15, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 16.4006MB