Sujet 1 Amérique du Nord, juin 2014 } Texte En 1942, le père Pons dirige un orp
Sujet 1 Amérique du Nord, juin 2014 } Texte En 1942, le père Pons dirige un orphelinat nommé La Villa Jaune... Lorsque j’avais dix ans, je faisais partie d’un groupe d’enfants que, tous les di- manches, on mettait aux enchères. On ne nous vendait pas : on nous demandait de défiler sur une estrade afin que nous trouvions preneur. Dans le public pouvaient se trouver aussi bien nos vrais parents enfin revenus de la guerre que des couples désireux de nous adopter. 5 Tous les dimanches, je montais sur les planches en espérant être reconnu, sinon choisi. Tous les dimanches, sous le préau de la Villa Jaune, j’avais dix pas pour me faire voir, dix pas pour obtenir une famille, dix pas pour cesser d’être orphelin. Les premières enjambées ne me coûtaient guère tant l’impatience me propulsait sur le 10 podium, mais je faiblissais à mi-parcours, et mes mollets arrachaient péniblement le dernier mètre. Au bout, comme au bout d’un plongeoir, m’attendait le vide. Un silence plus profond qu’un gouffre. De ces rangées de têtes, de ces chapeaux, crânes et chignons, une bouche devait s’ouvrir pour s’exclamer : « Mon fils ! » ou : « C’est lui ! C’est lui que je veux ! Je l’adopte ! » Les orteils crispés, le corps tendu vers cet 15 appel qui m’arracherait à l’abandon, je vérifiais que j’avais soigné mon apparence. [...] Certes, mes chaussures faisaient mauvais effet. Deux morceaux de carton vomi. Plus de trous que de matière. Des béances 1 ficelées par du raphia. Un modèle aéré, ouvert au froid, au vent et même à mes orteils. Deux godillots 2 qui ne résistaient 20 à la pluie que depuis que plusieurs couches de boue les avaient encrottés 3. Je ne pouvais me risquer à les nettoyer sous peine de les voir disparaître. Le seul indice qui permettait à mes chaussures de passer pour des chaussures, c’était que je les portais aux pieds. Si je les avais tenues à la main, sûr qu’on m’aurait gentiment désigné les poubelles. Peut-être aurais-je dû conserver mes sabots de semaine ? 25 Cependant, les visiteurs de la Villa Jaune ne pouvaient pas remarquer cela d’en bas ! Et même ! On n’allait pas me refuser pour des chaussures ! Léonard le rouquin n’avait-il pas récupéré ses parents alors qu’il avait paradé 4 pieds nus ? — Tu peux retourner au réfectoire, mon petit Joseph. 1. Béances : trous. 2. Godillots : grosses chaussures. 3. Encrottés : recouverts. 4. Paradé : défilé. Sujet 1 | Énoncé Tous les dimanches, mes espoirs mouraient sur cette phrase. Le père Pons suggérait 30 que ce ne serait pas pour cette fois non plus et que je devais quitter la scène. Demi-tour. Dix pas pour disparaître. Dix pas pour rentrer dans la douleur. Dix pas pour redevenir orphelin. Au bout de l’estrade, un autre enfant piétinait déjà. Éric-Emmanuel Schmitt, L’Enfant de Noé. Première partie : questions – réécriture – dictée Questions 15 points Toutes vos réponses devront être rédigées. 1 Qui est le narrateur ? Rappel : soit le narrateur est anonyme, extérieur à l’histoire (récit à la 3e personne) ; soit il est un personnage de l’histoire, principal ou secondaire (récit à la 1re per- sonne). Vous devez donc observer les verbes et les pronoms personnels sujets du texte. 2 En vous appuyant sur le passage de « On ne nous vendait pas » (l. 3) à « désireux de nous adopter » (l. 5), expliquez quelles sont les deux situations dans lesquelles se trouvent les enfants de la Villa Jaune. Relisez ce passage. Pour identifier les deux situations des enfants, relevez les ex- pressions qui évoquent les relations à leurs parents. 3 Dans la première moitié du texte, de « On ne nous vendait pas [...] » (l. 3) à « [...] mon apparence. [...] » (l. 17) : a) À quoi peut faire penser la manière dont les enfants se présentent aux adultes ? b) Relevez dans ce passage des mots ou expressions qui vous permettent de justifier votre réponse. c) À partir des passages au discours direct, commentez l’attitude des adultes et précisez les sentiments qu’ils peuvent éprouver. a) Relisez le passage. Observez les champs lexicaux. Lequel pourrait évoquer la présentation des enfants ? Quel titre donneriez-vous à ce champ lexical dominant ? b) Utilisez votre étude des champs lexicaux du passage et sélectionnez les mots ou expressions qui justifieront votre réponse. c) Observez les marques du discours direct : guillemets éventuels, verbes introduc- teurs, des paroles, temps des verbes, etc. Analysez le sens des paroles prononcées, Sujet 1 | Énoncé la façon de s’exprimer des adultes, les types de phrase. Expliquez l’attitude et les sentiments des adultes. 4 Dans le passage de « Certes, mes chaussures [...] » (l. 18) à « [...] les poubelles. » (l. 25) : a) Relevez les noms qui désignent les chaussures du narrateur : quelle caractéristique essentielle apparaît ? b) De « Deux morceaux de carton [...] (l. 18) » à « [...] mes orteils. » (l. 20) : quelle est la particularité grammaticale de ces phrases ? Quel est l’effet produit ? c) En quoi le ton adopté par le narrateur dans ce passage s’oppose-t-il à la tonalité du reste du récit ? a) Repérez et relevez les mots ou expressions qui désignent les chaussures du nar- rateur. Certains groupes de mots peuvent être très imagés. b) Observez la construction de ces phrases et comparez-la à la construction habi- tuelle (sujet + verbe + complément(s)). Que manque-t-il ? Expliquez l’effet recher- ché et produit sur le lecteur. Utilisez aussi votre réponse à la question 4. a). c) Définition de « tonalité » : sur le plan affectif, émotionnel, impression générale produite par un texte ou un passage. Interrogez-vous : que pensez-vous de la situa- tion du narrateur et de ses camarades ? Comment la qualifieriez-vous ? Comparez la tonalité du passage décrivant les chaussures et celle du reste du texte. Sont-elles identiques ou différentes ? Expliquez votre réponse. 5 De « Peut-être aurais-je [...] » (l. 25) à « [...] mon petit Joseph. » (l. 29) : à quelle conclusion en arrive le narrateur en ce qui concerne son apparence ? Relisez ce passage. Analysez la progression du raisonnement au sujet des chaussures du narrateur et de son apparence. Au début : « Certes, mes chaussures faisaient mauvais effet ». Ensuite... À la fin... 6 « [...] dix pas pour me faire voir, dix pas pour obtenir une famille, dix pas pour cesser d’être orphelin [...] » (l. 8) ; « Dix pas pour disparaître. Dix pas pour rentrer dans la douleur. Dix pas pour redevenir orphelin [...] » (l. 32). a) Quelle figure de style est ici utilisée ? b) Comparez précisément ces deux courts passages : quelle conclusion pouvez-vous en tirer ? a) Observez les mots et la construction de ces phrases. Déterminez si la figure de style employée repose sur la pensée (hyperbole, personnification, allégorie, etc.), la construction (chiasme, oxymore, antithèse, etc.), l’analogie (comparaison, mé- taphore, etc.) ou la répétition (allitération, assonance, parallélisme, etc.). Nommez cette figure. Sujet 1 | Énoncé b) Observez ces deux passages, les mots et les constructions utilisées. Interrogez- vous. Qu’est-ce qui est identique ? Qu’est-ce qui est différent ? Par exemple, com- parez « me faire voir » et « disparaître ». 7 Dans l’ensemble du texte, dites quels sont les sentiments successifs éprouvés par le narrateur. Vous justifierez chacune de vos réponses par des citations précises. Relisez le texte et repérez les mots ou groupes de mots (noms, verbes, adjectifs) qui expriment directement ou indirectement un sentiment. Nommez les sentiments du narrateur correspondant à ces mots. Réécriture 4 points Transposez les phrases suivantes, où les enfants sont désignés par le pronom « nous », à la troisième personne du pluriel et en utilisant le système du présent. Vous ferez toutes les modifications nécessaires. « On ne nous vendait pas ; on nous demandait de défiler sur une estrade afin que nous trouvions preneur. Dans le public pouvaient se trouver aussi bien nos vrais parents [...] ». Effectuez les deux transformations : – le passage de « nous » à « ils » implique de modifier l’accord du verbe, la personne du déterminant possessif (« nos vrais parents »), le pronom personnel « nous » sujet et complément d’objet direct, indirect ou second ; la forme du pronom per- sonnel de la 3e personne du pluriel change selon qu’il est sujet, complément direct, indirect ou second ; – le changement de temps des verbes de l’imparfait au présent implique de modifier la terminaison et parfois le radical, en respectant l’accord avec le nouveau sujet. Dictée 6 points Un grand crucifix accroché au mur complétait la décoration de ce réfectoire, dont la porte unique, nous croyons l’avoir dit, s’ouvrait sur le jardin. Deux tables étroites, côtoyées chacune de deux bancs de bois, faisaient deux longues lignes parallèles d’un bout à l’autre du réfectoire. Les murs étaient blancs, les tables étaient uploads/Litterature/ abre-sujets-de-francais.pdf
Documents similaires









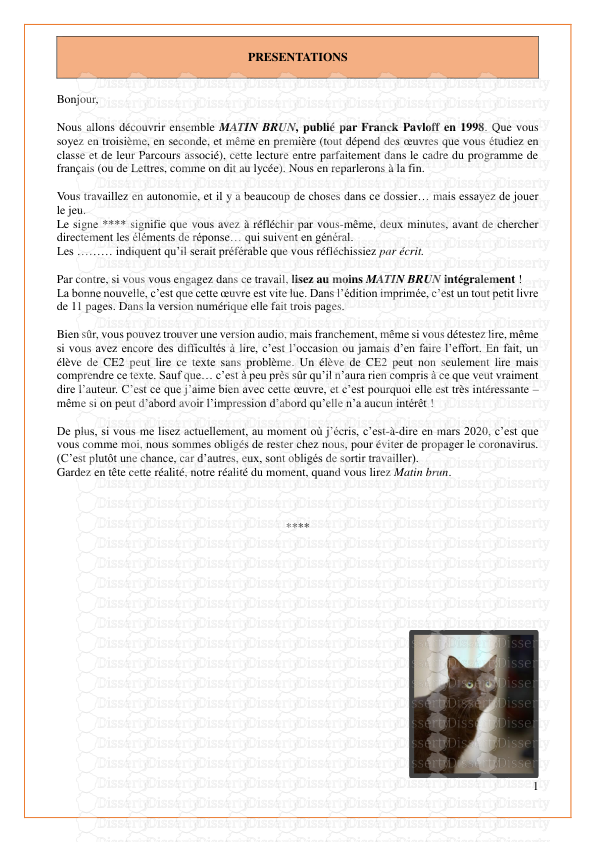
-
35
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 07, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 1.1098MB


