1 L’illustration dans la littérature alchimique (1550-1618) : du miroir au laby
1 L’illustration dans la littérature alchimique (1550-1618) : du miroir au labyrinthe version brouillon. La table des illustrations est en fin de document. La version illustrée et définitive est parue dans les Cahiers du Gadge, Droz, 2015, Les Détours de l'illustration sous l'Ancien Régime (dir. O. Leplâtre) Véronique ADAM L’illustration dans la « littérature alchimique » des années 1550 à la fin des années 1610, paraît d’emblée plurielle tant par sa forme que par le contexte qui la convoque : cette période est d’abord encadrée par la réédition des deux ouvrages du début du XVIe, le Rosarium philosophorum et le Spendor Solis1, et la publication des ouvrages de Michael Maier2 héritiers des premiers illustrés médiévaux alchimiques3. Les dessins sont présentés en série, et rythment chaque chapitre ou étape de la quête alchimique. Ils sont allégoriques et placés en regard d’un texte lui-même obscur et imagé, mystique ou philosophique. L’une de leurs particularités est d’intégrer dans l’allégorie des outils du laboratoire alchimique (vase, fourneau, outils distillation), reliant ainsi l’art symbolique et la technique, la fable et la mimesis4. Cette période voit aussi l’apparition d’ouvrages réinstaurant l’usage de figures géométriques5, comme le traité vénitien, le Voarchadumia6 disposant de schémas, figures géométriques, listes d’alphabets, dessins d’objets utiles aux expériences (fourneau, vases, appareils de 1 S.Trismosin, Splendor solis oder Sonne Glantz [1550], Aureum vellus oder Güldin Schatz und Kunstkammer, in La Toison d’or, Montélimar, « études maçonniques », 2006 (22 illustrations dont certains fragments empruntés à Dürer, Holbein et Cranach) ; Rosarium Philosophorum in J. Cyriacus, De alchimia opuscula complura veterum philosophorum, quorum catalogum sequens pagella indicabit, Frankfurt, Mense Lunio, 1550 (une vingtaine de gravures sur bois). 2 Atalanta fugiens, hoc est Emblemata nova de secretis naturae chymica Oppenheim, Hyeronimus Gallerus, 1618 ((une quarantaine d’emblèmes) ; Tripus Aureus Frankfurt, Paul Jacob, 1618 (avec notamment les douze planches illustrant les douze clés d’une œuvre de B. Valentin). 3 Par exemple, l’Aurora consurgens, datée du XVe siècle, et attribuée, sans doute à tort à Thomas d’Aquin ( Zürich, Zentralbibliothek, ms. Rh. 172), ou Le Livre des secrets de Ma Dame Alchimie de Constantinus, daté du XIIIe siècle. Sur ces ouvrages, voir B. Obrist, Les débuts de l'imagerie alchimique (XIVe-XVe siècles), Paris, Le Sycomore, 1982. 4 Ce type de mélange apparaît déjà au Moyen-Âge pour permettre de visualiser en partie le sens de l’allégorie. Voir B. Obrist, « Visualization in Medieval Alchemy », International Journal for Philosophy of Chemistry, Vol. 9, n°2, 2003, pp. 131-170 5 Ces figures sont utilisées dès les manuscrits alchimiques du Moyen-Âge, notamment par Constantinus, op.cit. Sur cet usage médiéval, voir B. Obrist, Les débuts de l'imagerie alchimique, op. cit. p. 106-111 et « La figure géométrique dans l’oeuvre de Joachim de Flore », Cahiers de civilisation médiévale, 31, 1988, p. 297-321. 6 J. A. Pantheus, Voarchadumia contra alchemiam ars distincta ab archemia, et sophia : cum additionibus, proportionibus : numeris, &figuris opportunis, Giovanni Tacuino, Venise, 1530. [avec frontispice des figures de savant] ; Paris, Vivant Gautherot, 1550 [avec 1 carte] ; Ars et theoria transmutationis metallicae […] illustrata, Ibid., 1566 [avec 2 cartes] 2 distillation), cartes géographiques. Enfin, plusieurs traités mathématiques, médicaux ou philosophiques sont précédés en regard d’un frontispice ou de planches intérieures qui représentent des doubles de l’auteur et des personnifications de son savoir7. L'image, d’une nature variée, ne permet pas de comprendre le texte, mais d’introduire et de signaler la présence de l’alchimie, de ses codes, de ses outils et de ses connaissances. Sa fonction figurative ne va pas de soi. La nature du dessin ou du schéma ne préjuge en rien de la rationalité ou du caractère imaginatif d’un livre puisque l’on peut trouver une figure allégorique dans un ouvrage savant et une image géométrique dans un texte philosophique8. Il y a donc une véritable difficulté à qualifier l’illustration alchimique et sa fonction même puisqu’elle n’explique pas toujours ni ne figure même le discours qu’elle accompagne. Cette variété formelle de l’image est accrue par l’essor des emblèmes des années 15709 qui ont recours aux motifs alchimiques qu’ils détournent notamment dans des scènes amoureuses10, et les ateliers de gravure, pour des raisons économiques, réutilisent les gravures alchimiques dans des ouvrages différents. diffusant les illustrés alchimiques 11 : l’atelier de Théodore de Bry bien connu pour avoir eu recours à Michael Mérian pour illustrer l’Atalante Fugiens de M. Maier, choisit pour des raisons économiques et commerciales, d’utiliser plusieurs fois la même gravure dans des ouvrages différents et étrangers à l’alchimie. L’image alchimique est donc comme objet, propice au détournement éditorial et auctorial, et comme sujet, elle propose d’une allégorie malléable par le texte qu’elle illustre, qui en énonce un sens sans pour autant les cerner tous. C’est cette image ou œuvre ouverte que nous voudrions analyser, notamment dans son détournement de fonction référentielle au sens large : refusant de renvoyer à un texte qu’elle jouxte, à un cadre réel, ou à un sens unique, elle prétend situer, figurer et codifier un savoir volontairement opaque, sans pour autant l’expliquer. L’illustration rendrait visible un univers sans souci de sa lisibilité, moins par goût du mystère que par une pratique constante de la polysémie12 et de l’illusion, anneaux d’un labyrinthe que nous allons parcourir. Polysémiques, les images allégoriques détournent deux cadres de référence, le réel et les mythes. Illusoires, les images géométriques ou scientifiques, les cartes prétendent se référer à un savoir douteux, invisible et peut-être inexistant. Toutes instaurent enfin une méthode de lecture non- linéaire, marquée elle aussi de détours, à contre-pied de la linéarité du texte. 7 C’est le cas notamment des éditions des œuvres complètes ou des collectifs, par exemple Opus Chryrurgicum de Paracelse, publié en 1565 à Frankfort et représentant un théologien, un barbier, un chirurgien, un théologien, un philosophe et un chimiste. 8 Par exemple, Gerard Dorn illustre de figures géométriques et d’allégories les traités médicaux et philosophiques de Paracelse, dans son De summis naturae, mysteriis commentarii, Bâle, Konrad von Waldkirch, 1584. de fig allégorique et fig mystique hors corpus 9 Voir A.-É. Spica, Symbolique humaniste et emblématique. L’évolution et les genres (1550-1700), Paris, Champion, 1996 10 C’est le cas par exemple d’Otto van Veen, Amorum Emblemata, 1608. Voir à ce sujet, Adams, Alyson, Linden Stanton, Emblems and alchemy, Glasgow Emblems Studies, n°3, Droz, 1998, p. 33-34. 11 Théodore de Bry emploie Matthaüs Merian dans son atelier et réutiliserait les gravures faites pour les ouvrages de M. Maier. C’est la thèse avancée par Etienne Perrot dans son édition de l’Atalante (op.cit.). voir aussi sur cet éditeur, Cornelia Kemp, « Vita Cornelia. Das emblematische Stammbuch von Theodor de Bry bis Peter Rollon », in Alison Adams, Anthony Harper (dir.), The Emblem in Renaissance and baroque Europe, Leyden-New-York, Brill, 1992, p. 53-69. 12 Cette idée est récurrente dans le regard critique sur l’alchimie. Voir Michel de Certeau, La Fable Mystique, XVIe-XVIIe siècle, Paris, Gallimard, 1982, vol. 1, p. 81 : « elle articule des signes ésotériques (visibles mais illisibles) sur des connaissances soigneusement cachées, elle sépare ainsi d’un non-savoir un savoir lire ». 3 L’allégorie et les outils mimétiques Le détournement de la fonction mimétique de l’illustration, de son cadre de référence et de son rôle de légitimation, dans les dessins allégoriques, peut se manifester historiquement, dans le passage des illustrés de la fin du Moyen-Âge à l’âge d’or des traités alchimiques illustrés (début XVIIe). Un cas exemplaire, la représentation du laboratoire de l’alchimiste nous servira de modèle. Certaines planches de la fin du Moyen-Âge13, représentent un savant isolé, possédant son propre laboratoire et utilisant des instruments spécifiques (notamment l’alambic, l’athanor, le fourneau ou le livre) [Fig. 1]. La représentation plutôt mimétique a une double fonction : donner un espace déterminé à une profession qui n’en a pas, en privilégiant un lieu expérimental visible et souvent rural, et montrer un alchimiste d’abord technicien et artisan, plutôt qu’artiste, vivant dans une réalité commune et quotidienne. L’image convoque métonymiquement, l’étendue des techniques alchimiques. En exposant des outils artisanaux et grâce à leur matérialité, elle conjure l’invisibilité des procédés de transmutation. Parmi eux, le livre est un élément présent mais non majeur. Le rôle fondateur et autorisant de l’image n’est pas en désaccord avec le texte chargé d’énoncer les techniques des métaux, d’exploitation des minerais, le mode d’emploi et la fonction des objets représentés. Une lecture allégorique reste possible : des miniatures présentant des figures de semeurs ou de forgerons incarnent à la fois une étape de l’expérience transmutatoire, un geste symbolique (semer, brûler), la présence de la nature et la revendication de la figure du paysan comme modèle14. On voit perdurer ces images mimétiques de la campagne artisanale jusqu'au XVIIIe siècle15. D’autres dessins inscrits dans des volumes plus mystiques, comme le Splendor Solis —où l’on voit aussi des semeurs— sont plus clairement allégoriques, mais on préserve cet usage métonymique des formes et des figures inscrites dans leur décor. Tout en introduisant des codes et des symboles, nommés et paraphrasés dans le discours écrit, on privilégie des sujets pseudo-naturels, tel le lion représentant le mercure et les autres animaux du bestiaire (dragon, serpent uploads/Litterature/ adam-veronique-l-x27-illustration-dans-la-litterature-alchimique-1550-1618-pdf.pdf
Documents similaires


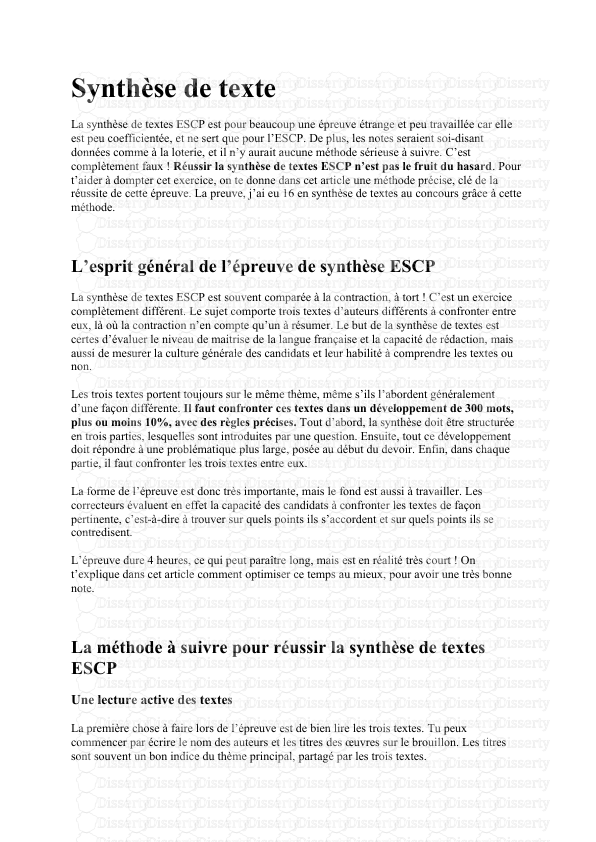







-
101
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 02, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2780MB


