L'auteur et le traducteur du Liber de causis () Jusqu'à ces dernières années on
L'auteur et le traducteur du Liber de causis () Jusqu'à ces dernières années on semblait avoir adopté les con clusions de l'ouvrage capital de Bardenhewer, paru en 1882, sur les origines du mystérieux et célèbre Liber de causis: il aurait été com posé par un musulman vivant par deçà l'Euphrate au IXe siècle, en tout cas pas plus tard que le milieu du Xe ; ce serait non point une version arabe d'une œuvre grecque, mais un écrit arabe original, dont l'auteur aurait utilisé, très probablement en traduction arabe, la Zxoiyeiuiaiç Bzoko^wA] de Proclus ; enfin, entre les années 1167 et 1187, il aurait été traduit en latin, à Tolède, par le fameux Gérard de Crémone, et c'est ce texte latin qu'auraient connu tous les scolastiques. Ces conclusions, on le savait, se heurtaient pourtant à une dif ficulté : au témoignage de Saint Albert le Grand qui attribuait la '*' Principaux travaux à consulter. Nous les énumérons dans l'ordre alpha bétique . des noms d'auteurs : O. BARDENHEWER, Die pseudo-aristoteliache Schrift ueber das reine Gute, bekannt tinter den Namen Liber de Causis, Fribourg (Bris- gau), 1882; A. Berthaud, Gilbert de la Porrée et sa philosophie, Poitiers, 1892; A. BONILLA Y SAN MARTIN, Historia de la filosofia espanola, t. I, Madrid, 1908; R. E. DODDS, Proclus. The Elements of Theology, Oxford, 1933; P. DuHEM, Le système du monde, t. IV, Paris, 1916; J. GUTTMANN, Die Scholastic des dreizehnten Jahrhunderts in ihren Beziehungen zum Judenthum und zur Jùdischen Literatur, Breslau, 1902; B. HaURÉAU, Histoire de la philosophie scolastique, t. I, Paris, 1872; Id., Mémoire sur la vraie source des erreurs attribuées à David de Dinan, dans Mém. de l'Acad. des Inscript, et Belles-Lettres, t. 29-2, Paris, 1879, pp. 319-330; A. JOURDAIN, Recherches critiques sur l'âge et l'origine des traductions latines d'Aristote, 2e éd., Paris, 1843; D. KAUFMANN, compte rendu < de l'ouvrage cité plus haut de O. Bardenhewer, dans Gottingische gelehrte Anzeigen, 1883, I, pp. 536-567; L. LECLERC, Histoire de la médecine arabe, Paris, 1876, 2 vol.; S. MUNK, • Mélanges de philosophie juive et arabe, Paris, 1859 — Réimprimé : Paris, 1927; Fr. PELSTER, Beitrage zur Aristotelesbenutzung Alberts des Grossen, dans Philosophisches Jahrbuch, 46 (1933), pp. 450-463; G. SaRTON, Introduction 520 H. Bêdoret composition de l'énigmatique ouvrage à un certain juif David. Or ce témoignage a été accepté et étayé de nouveaux arguments par deux savants, Kaufmann et Guttmann (1), qui, rejetant la thèse de Bardenhewer, reprirent une opinion déjà émise en 1852 par Stein- schneider <2) : ce juif David nommé par Albert a effectivement com posé le Liber de causis, et ce juif n'est autre que le célèbre Aven- dauth, auteur de nombreuses versions arabo-latines, cotraducteur avec l'archidiacre Dominique Gundisalvi au service de Raymond, archevêque de Tolède (c. 1 126- c. 1151). Comme les arguments présentés par Kaufmann et Guttmann ne semblent guère avoir été remarqués, signalons-les rapidement ici. Dans le ms. Oxford, Bodléenne, Selden, 24, affirmait Kauf mann, on trouve effectivement le Liber de causis sous le titre Metaphysica Avendauth : or c'est précisément ce titre Metaphy- sica que, d'après Albert, le juif David' a donné au Liber de caus is (3). Kaufmann relevait alors l'étonnante fin' de non recevoir que Bardenhewer avait opposée à la grosse objection suivante : de puis longtemps Munk et Hauréau (4) avaient, chacun de leur côté, signalé que dans plusieurs mss. de la Bibliothèque Nationale de Paris le texte du Liber de causis portait le nom de David. Or à ce double témoignage réplique surprenante de Bardenhewer : « Ich habe keine dieser Manuscripte eingesehen. Ich stehe aber nicht an, to the history of science, Baltimore, 1927-1931, 3 vol.; R: STEELE, Opera hac- tenus inedita Rogeri Baconi, fascic. XII, "Oxford, 1935; M. SteINSCHNEIDER, Cata- logus librorum hebraeorum in Bibliotheca Bodleiana, Berlin, 1852-1860 — Réim primé : Berlin, 1931, 3 vol.; Id., Die europaischen Uebersetzungen aus dem Ara- bischen bis Mitte des 17.' Jahrhunderts, dans Sitz. d. Akad. Wien, phil.-hist. Kl., 149 (1904) et 151 (1905); Id., Hebraeische Bibliographie, VI -VII (1863-1864), Ber lin; Id., Die hebra'ischen Uebersetzungen des Mittelalters und die Juden als Dol- metscher, Berlin, 1893, 2 vol.; P. WiiSTENFELD, Die Uebersetzungen arabischer Werke in das Lateinische, dans Abhandl. d. kpnigl. Gesell. d. Wiss. zu Got- tingen, XXII (1877). f1» Kaufmann, art. cit. ; Guttmann, op. cit., pp. 54-55. <2> STEINSCHNEIDER, Catalogua librorum hebraeorum in Bibliotheca Bodleiana, 1852, col. 742, 743, 1404; Id., Hebraeische Bibliographie, VI, p. 110. <3> KAUFMANN, art. cit., pp. 545-546. — Ce titre significatif avait été désigné à l'attention des érudits par LECLERC, op. cit., t. II, p. 376 ; i BARDENHEWER, op. cit., p. 130, s'était contenté de répondre qu'il n'y avait là qu'un titre, n'indiquant nullement la présence du Liber de causis. <4> MUNK, op. cit., 1859, p. 259; HAURÉAU, Histoire de la philosophie scolas- tique, 1872, t. I, p. 383. L'auteur et le traducteur du Liber de causis 521 mit Bestimmtheit zu behaupten, dass nicht ein einziges derselben unser Buch enthâlt avec le nom de David » (5). Et Kaufmann, ne pouvant naturellement pas admettre - cette réponse, concluait : Al bert le Grand a donc trouvé le juif David désigné par les mss. comme auteur du Liber de causis ; voilà connue une des sources de son information sur les origines de cet ouvrage (6). Il restait toutefois une difficulté : comment identifier, David avec Avendauth (= fils de David) ? Guttmann l'écarta en faisant remarquer qu'Albert le Grand citait un certain Avendavid (= fils de David) comme un personnage identique à David (7). Néanmoins, concédait, après tout, Kaufmann à Bardenhewer, Avendauth n'est pour rien dans le texte latin conservé : celui-ci est certainement l'œuvre de Gérard de Crémone (8). Steinschneider (9) faisait la même concession. De la sorte, Avendauth serait seulement l'auteur de l'original arabe, dont proviendrait ultérieurement la version latine. Comme on l'a dit plus haut, les historiens paraissent avoir ignoré les arguments de Kaufmann et de Guttmann eh faveur de l'opinion de Steinschneider, et avoir accepté la thèse de Barden hewer qui eut ainsi droit de cité exclusif pendant longtemps. Il a fallu attendre jusqu'en 1933 pour voir un article du R. P. Pelster remettre sérieusement la question sur le tapis (10). Pour comprendre l'apport de ce travail — deux hypothèses ingénieuses — , replaçons devant les yeux du lecteur le célèbre texte du De causis et processu universitatis où Albert le Grand s'explique sur l'origine du Liber de causis. <5> Bardenhewer. op. cit., p. 131. <6> Kaufmann, art. cit., pp. 546-547. (r) GUTTMANN, op. cit., pp. 54-55, L'auteur renvoie au De motibus animalium d'Albert, sans indication plus précise; nous n'avons pu retrouver le passage en question. (8> Kaufmann, art. cit., pp. 550-551. <9> STEINSCHNEIDER, Die europaischen Uebersetzungen, 68-c. (10) PELSTER, art. cit. — Contentons-nous de mentionner la thèse de BeRTHAUD, op. cit., qui, s'appuyant sur le témoignage d'un vieux ms. du Liber de causis (Bruges, Biblioth. publ., 463, XJIIe s.), attribue le traité à Gilbert de la Porrée. — Plus près de nous, BONILLA, op. cit., t. I, p. 330, reprend une hypothèse de JoUR- DAIN, op. cit., pp. 113-115, et d'HAURÉAU, Mémoire sur la vraie source..., p. 329, en mettant en avant le nom de l'archidiacre Dominique Gundisalvi comme tr aducteur du même ouvrage. — DUHEM, op. cit., t. IV, pp. 332-333, affirmait, sans 522 H. Bédoret De nomine quo antiqui appellaverunt librum de causis pri- mariis. Accipiemusvigitur ab antiquis quaecumque bene dicta sunt ab ipsis, quae ante nos David Judaeus quidam ex dictis Aristotelis, Avicennae, Algazelis et Alpharabii congregavit, per modum theo- rematum ordinans ea, quorum commentum ipsemet adhibuit, sicut et Euclides in geometricis fecisse videtur ; sicut enim Euclidis com- mento probatur theorema quodcumque ponitur, ita et David com mentum adhibuit, quod nihil aliud est nisi probatio theorematis propositi. Pervenit autem ad nos per eundem modum et physica ab eodem Philosopho perfecta : verum istum librum metaphysi- cam vocavit, subjungens eiusdem tituli quatuor rationes. Quarum prima est... Talem autem tractatum Alpharabius inscripsit de bonitate pura, quinque rationibus. . . Hujusmodi autem tractatum Algazel vocavit florem divinorum, tribus rationibus... Avicennam autem secuti, magis proprie de lumine luminum eum appellant, quatuor rationes assignantes... Aristotelem autem secuti, vocaverunt hune librum de causis causarum, inducentes quinque rationes... David autem, sicut ante jam diximus, hune librum collegit ex quadam Aristotelis epistola, quam de principio universi esse composuit, multa adjungens de dictis Avicennae et Alpharabii (111. Depuis longtemps on se demandait où Albert le Grand avait été puiser ces renseignements sur l'origine du Liber de causis. Le R. P. Pelster (12) propose cette solution : il les aura trouvés dans le prologue de cette Metaphysica de David - Avendauth ; ce pro logue, tout comme ceux qui précédaient diverses traductions dues à Avendauth, aura peu à peu disparu des mss. Dans ce cas, natu- toutefois apporter de preuves à l'appui, que le Liber de causia était déjà connu d'Avicenne et d' Algazel. — Enfin M. SARTON, op. cit., vol. I, p. 404,' et vol. H, part. 1, pp. 115 et 171, concluait uploads/Litterature/ bedoret-lauteur-et-le-traducteur-du-liber-de-causis-1938 1 .pdf
Documents similaires









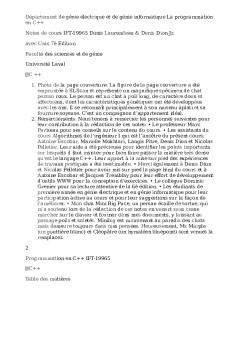
-
37
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 05, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.9900MB


