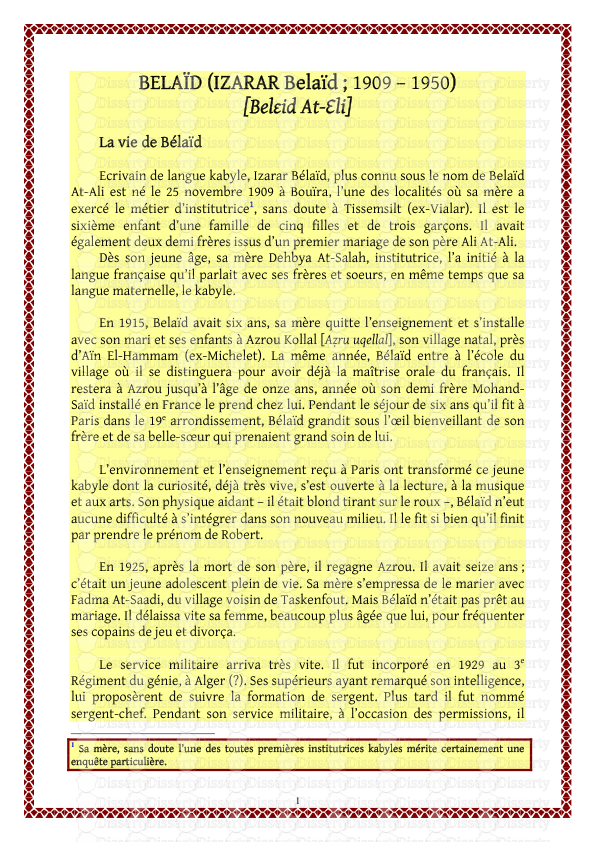1 BELAÏD (IZARAR Belaïd ; 1909 – 1950) [Belɛid At-Ɛli] La vie de Bélaïd Ecrivai
1 BELAÏD (IZARAR Belaïd ; 1909 – 1950) [Belɛid At-Ɛli] La vie de Bélaïd Ecrivain de langue kabyle, Izarar Bélaïd, plus connu sous le nom de Belaïd At-Ali est né le 25 novembre 1909 à Bouïra, l’une des localités où sa mère a exercé le métier d’institutrice1, sans doute à Tissemsilt (ex-Vialar). Il est le sixième enfant d’une famille de cinq filles et de trois garçons. Il avait également deux demi frères issus d’un premier mariage de son père Ali At-Ali. Dès son jeune âge, sa mère Dehbya At-Salah, institutrice, l’a initié à la langue française qu’il parlait avec ses frères et soeurs, en même temps que sa langue maternelle, le kabyle. En 1915, Belaïd avait six ans, sa mère quitte l’enseignement et s’installe avec son mari et ses enfants à Azrou Kollal [Aẓru uqellal], son village natal, près d’Aïn El-Hammam (ex-Michelet). La même année, Bélaïd entre à l’école du village où il se distinguera pour avoir déjà la maîtrise orale du français. Il restera à Azrou jusqu’à l’âge de onze ans, année où son demi frère Mohand- Saïd installé en France le prend chez lui. Pendant le séjour de six ans qu’il fit à Paris dans le 19e arrondissement, Bélaïd grandit sous l’œil bienveillant de son frère et de sa belle-sœur qui prenaient grand soin de lui. L’environnement et l’enseignement reçu à Paris ont transformé ce jeune kabyle dont la curiosité, déjà très vive, s’est ouverte à la lecture, à la musique et aux arts. Son physique aidant – il était blond tirant sur le roux –, Bélaïd n’eut aucune difficulté à s’intégrer dans son nouveau milieu. Il le fit si bien qu’il finit par prendre le prénom de Robert. En 1925, après la mort de son père, il regagne Azrou. Il avait seize ans ; c’était un jeune adolescent plein de vie. Sa mère s’empressa de le marier avec Fadma At-Saadi, du village voisin de Taskenfout. Mais Bélaïd n’était pas prêt au mariage. Il délaissa vite sa femme, beaucoup plus âgée que lui, pour fréquenter ses copains de jeu et divorça. Le service militaire arriva très vite. Il fut incorporé en 1929 au 3e Régiment du génie, à Alger (?). Ses supérieurs ayant remarqué son intelligence, lui proposèrent de suivre la formation de sergent. Plus tard il fut nommé sergent-chef. Pendant son service militaire, à l’occasion des permissions, il 1 Sa mère, sans doute l’une des toutes premières institutrices kabyles mérite certainement une enquête particulière. 2 fréquenta une jeune fille française. Celle-ci le présenta même à ses parents qui furent d’abord ravis. Un peu plus tard, elle s’aperçut que derrière Robert se cachait Bélaïd ; elle mit fin brusquement à leur liaison. Cette rupture fut mal vécue par Bélaïd qui prit conscience de sa double personnalité. Le service militaire terminé, Bélaïd tente sa chance en métropole pour trouver un emploi autre que celui d’ouvrier agricole qui l’attendait à Azrou. Il y exercera plusieurs métiers et fut notamment ouvrier d’usine. Il consacrait son temps et son argent à l’achat de livres et s’adonnait à la lecture de divers auteurs, de toutes disciplines. Vers 1934, il regagne Azrou. C’est un jeune homme expérimenté et mûr qui retrouve sa mère, ses frères et sœurs. Il charge sa mère et ses sœurs de lui trouver sa future épouse. Son choix se porte sur une fille du village, Fatima At- Chabane. Le couple est installé dans une chambre du rez-de-chaussée de la maison familiale. Ce mariage, voulu par Bélaïd et accepté par sa mère, allait vite tourner au cauchemar pour le couple. La vieille institutrice en retraite devenait de plus en plus difficile, exigeante et insupportable pour ses belles- filles. Le cadet de Bélaïd, Tayeb, en faisait une amère expérience. Il en était déjà à son deuxième mariage. Bientôt, Bélaïd est pris dans l’engrenage des disputes devenues quotidiennes entre sa mère et sa femme qu’il commençait juste à connaître. Leur relations vont vite s’envenimer. La naissance d’un garçon, Ramdane, va atténuer pendant quelques semaines la tension qui régnait à la maison. Mais ce n’était qu’une pause. Bélaïd, sans travail, avait intérêt à rester chez sa mère, qu’il adorait par ailleurs. Alors que sa femme souhaitait échapper à la tyrannie de sa belle-mère en créant son propre foyer. Dehbya, dont les ressources financières s’amenuisaient chaque mois, appliquait un régime de restrictions sévères à sa belle-fille. La situation devint explosive. Finalement Fatima céda et rejoignit sa mère à Alger avec son enfant. Cette séparation allait secouer durement Bélaïd. Il perdait d’un coup sa femme, son fils et l’estime de sa mère. Cet événement va déclencher le processus de déstabilisation de Bélaïd. Aussi il décide de rejoindre la France. Là il retrouve sa sœur aînée Fatima, installée à Saint-Denis avec son mari Lounas At-Aïssa. Mais son demi frère Mohand-Saïd était alors au Maroc où il occupait un poste important dans un ministère. Il va le rejoindre mais n’y restera pas longtemps. Il revient en France, trouve du travail mais le moral est brisé. Il se met à boire pour oublier ses problèmes familiaux. Il est complètement démoralisé par son échec. Plus il y pense, plus il sombre dans l’incertitude et l’indécision. Il tombe malade et se résigne à regagner son village. Les canons du début de la deuxième guerre mondiale commencent à tonner. Le sergent-chef Izarar est mobilisé. Bientôt, son bataillon participe à la campagne de Tunisie. A 30 ans, Bélaïd a perdu 3 l’enthousiasme de sa jeunesse. La boisson le conduit à l’ivrognerie et à l’indiscipline. Il perd ses galons et devient simple soldat. En 1941, il tombe malade. Le scorbut lui fait perdre ses dents une à une. Il réussit à obtenir une permission de quelques semaines. Il vient les passer à Azrou. Fin 1943, son bataillon est appelé à débarquer en Corse. La veille du départ, Bélaïd ne rentre pas à la caserne. Il entame une marche forcée à travers la Tunisie et l’Algérie et réussit à rentrer à Azrou. Déserteur, il vit dans la peur d’être arrêté par les gendarmes, auxquels il échappera de justesse à trois reprises. C’est ainsi qu’on le retrouve clochard à Saint-Eugène à la fin des années 1944 et 1945, pour se soustraire aux poursuites. Ces escapades dans la capitale ne dureront jamais longtemps. Azrou constituera son refuge jusqu’au début de l’année 1947 où il quitte son village pour chercher un peu de réconfort auprès de son frère Mohand-Saïd. Il le rejoindra, on ne sait par quel moyen, au Maroc. Mohand-Saïd comprend vite que son frère n’est plus fréquentable. Il lui paie un billet de chemin de fer jusqu'à Alger. Bélaïd descend à Maghnia, vend le reste du voyage pour se procurer à boire. La police l’arrête et l’expédie sur Tlemcen. Epuisé, malade, il est hospitalisé. Les médecins décèlent une tuberculose avancée et l’envoient à l’hôpital d’Oran. De là, il sera transféré à Saint-Denis du Sig, revient à Oran, puis sera transféré au pavillon des incurables de l’hôpital de Mascara où il mourut. Le Père Degezelle, l’ami de Bélaïd, reçut le 12 mai 1950 un télégramme du Directeur de l’hôpital annonçant sa mort. L’œuvre de Bélaïd En dehors de quelques textes non publiés, qui figurent dans le manuscrit original déposé au Centre de Recherche Berbère de l’INALCO, l’oeuvre de Belaïd tient entièrement dans les deux volumes édités par Dallet & Degezelle (Cf. Bibl.) et dont le sommaire est le suivant : I. Timucuha I. Contes – Tamacahut uwaɣzniw - L’ogre – Tamacahut uɛqqa yessawalen - Le caillou qui parle – Tamacahut n Bu-Yedmim - Aubépin – Tamacahut inisi d wuccen - Le Hérisson et le Chacal – Lɣani d lfaqir - Le riche et le pauvre – Tafunast igujilen - La vache des orphelins – Lwali n_wedrar - Le saint homme de la montagne – Aẓidan d umerẓagu - Le meilleur et le pire – Ayen tzerɛeḍ - Ce que l’on sème – D ayen d-ḥekkun - Des histoires que l’on raconte 4 II. Amexluḍ II. Mélanges – Afenjal n_lqahwa - Une tasse de café – Asmi hedd¨ent leíwayec - Au temps où les bêtes parlaient – Lexḍubegga - Démarches matrimoniales – Jeddi - Grand-père – D amezwaru unebdu - Premier jour d’été – At-zik - Nos anciens – Sut taddart - Nos villageoises III. Isefra III. Choix de poèmes Le Père Degezelle, installé dans la mission des Pères Blancs de Ouaghzen, située à quatre kilomètres au sud-est d’Azrou, venait souvent au village dispenser quelques soins élémentaires de médecine. A chacun de ses passages, il aimait échanger quelques amabilités avec l’ex-institutrice en retraite, Dehbya At-Salah. Pendant son séjour forcé à Azrou, Bélaïd fit la connaissance du Père. Celui-ci, dès les premiers échanges, se rendit compte qu’il avait à faire à un homme intelligent et exceptionnel. Au début de l’année 1945, il propose à Bélaïd d’écrire des contes kabyles en langue kabyle. Motivé par quelques pièces mais aussi par l’aide matérielle que le Père lui apportait, il se met, sans conviction d’abord, à écrire le conte d’Aubépin. Mais très vite, il découvre la profondeur de la culture berbère et uploads/Litterature/ belaid-ait-ali.pdf
Documents similaires










-
52
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 01, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2912MB